A Dakar, l’art contemporain africain se met à « l’heure rouge »
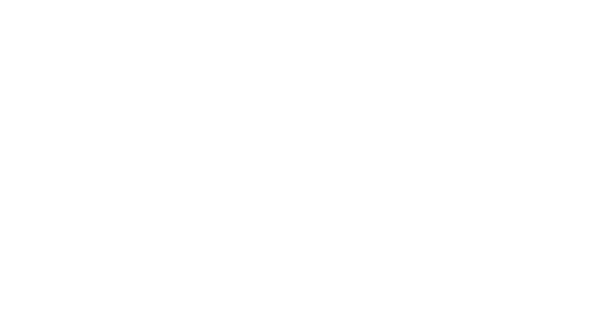
A Dakar, l’art contemporain africain se met à « l’heure rouge »
Par Roxana Azimi (Dakar, envoyée spéciale)
Pendant un mois, la biennale Dak’Art, placée cette année sous le sceau d’Aimé Césaire, s’installe dans divers lieux de la capitale sénégalaise.
Lunettes noires masquant des yeux rougis par trois nuits blanches, sourire de rigueur, Emo de Medeiros donne le change. Pourtant son installation composée de miroirs, de néons et d’une vingtaine de caméras de surveillance, qui promettait d’être l’un des points d’orgue de la Biennale de Dakar, n’est toujours pas visible le jour du vernissage, le 3 mai. « Il faut encore attendre vingt-quatre ou quarante-huit heures », glisse sa compagne, soulignant avec bienveillance « l’énergie folle des équipes », sur le pont depuis deux semaines. L’artiste franco-béninois n’est pas le seul à s’arracher les cheveux devant une organisation toujours aussi chaotique.
Cette année pourtant, la biennale, aussi appelée Dak’Art, semblait jouir d’un alignement des planètes : plus de temps de préparation (un an au lieu de quatre mois), d’argent (la contribution de l’Etat a doublé), de bras et d’espaces (700 m2 supplémentaires au sein de l’ancien palais de justice, dont un lieu pour les enfants). La manifestation pouvait aussi compter avec le soutien du nouveau ministre de la culture, Abdou Latif Coulibaly, ancien journaliste respecté, et l’arrivée d’une nouvelle secrétaire générale, Marième Ba, rompue à la gestion de crise.
Malgré tout, l’état d’avancement de l’accrochage à la veille du vernissage était tel qu’on peinait à en imaginer l’inauguration le lendemain. Pire : le jour J, les nombreuses vidéos n’ont pas fonctionné pendant près d’une heure. Et certaines œuvres, comme celles de l’Ivoirien Ouattara Watts, manquaient toujours à l’appel…
Chronique de la débrouillardise
Pour autant, personne ne veut gâcher la fête, pas même les commissaires d’exposition invités à l’Institut fondamental d’Afrique noire (IFAN), qui n’ont perçu aucune rétribution et ont dû lever eux-mêmes des fonds pour monter leurs expositions. Comme si tous ces hommes et femmes de bonne volonté s’étaient mis au diapason de « l’heure rouge », libellé de la biennale placée cette année sous le sceau d’Aimé Césaire.
« En 2016, c’était “la cité dans le jour bleu” de Senghor, l’espoir, le rêve. En 2018, c’est le “maintenant ou jamais” : on prend le train en marche ou on le regarde passer », résume Simon Njami, flegmatique commissaire de la biennale. Même mot d’ordre au pavillon du Sénégal, ouvert pour la première fois devant le Grand Théâtre. « Il faut avoir confiance en soi », martèle son organisateur, le peintre Viyé Diba. Aussi a-t-il accroché au mur quelques planches de Goorgoorlou, la bande dessinée culte des années 1980-1990, chronique de la débrouillardise du Sénégalais moyen en pleine crise.
Les artistes ont certes su faire preuve d’astuce. Difficile toutefois de ressentir le même souffle qu’en 2016. Les installations capables d’habiter l’espace fabuleux de l’ancien palais de justice sont plus rares. Les plus réussies sont empreintes de mélancolie, comme le Brise-Soleil des indépendances de Cheikh Ndiaye, traitant en filigrane des espoirs déçus des indépendances, ou la Casa Roja, poétique installation sur fond musical de Marcos Lora Read, composée d’un bateau ivre et d’une frêle maison rouge à deux doigts de s’envoler. Métaphore des pays « en développement » toujours prêts à décoller mais régulièrement lestés ? Tout aussi vacillant est l’olivier centenaire filmé par le Marocain Younès Rahmoun, vibrant de vie mais aussi de fragilité.
Pour comprendre les troubles actuels, plusieurs artistes se sont plongés dans l’histoire de leurs pays. Dans Last Dance Before Darkness, l’Algérienne Amina Zoubir a retrouvé des clips de danse des années 1980 avant la guerre civile. « On voyait dans les espaces publics des chorégraphies qu’on n’imaginerait plus aujourd’hui, des corps libres, en mouvement », rappelle-t-elle, nostalgique. En regard, la jeune femme présente des pochettes de disques vinyles de quelques « rossignols migrateurs » comme Mohamed Mazouni, exilé en France, et des références à des acteurs culturels assassinés par les islamistes, à l’instar du metteur en scène Azzedine Medjoubi.
Ali Tnani a quant à lui sondé la mémoire d’un fils de mineur de Gafsa, dans le sud-ouest de la Tunisie. A chaque souvenir évoqué en voix off s’ajoute le rappel des maux actuels, des incivilités à la pollution.
Un musée dédié à Ousmane Sow
La mémoire est aussi convoquée à l’IFAN, où le commissaire d’exposition Bonaventure Ndikung a exhumé la figure de Halim El-Dabh, compositeur égyptien pionnier de la musique électronique. Bien que contemporain du compositeur John Cage et de la chorégraphe Martha Graham, il fut oublié d’une histoire écrite par les Occidentaux. Le Nigérian Emeka Ogboh lui redonne magnifiquement vie dans une vidéo où l’envoûtante musique d’El-Dabh est restituée en cercles colorés qui, littéralement, font irradier le son.
Ce regard dans le rétroviseur n’exclut pas l’ici et le maintenant. Simon Njami a intégré au programme officiel un ambitieux projet communautaire, « Mon Super Kilomètre », qui entremêle des projets artistiques aux échoppes des commerçants le long de l’artère de la Gueule-Tapée. Manière d’unir l’art et la vie dans un unique bouillonnement. Cette ébullition s’est d’ailleurs propagée dans tout le pays, où se tiennent quelque 320 off.
Galeriste à Abidjan, Cécile Fakhoury a profité de la biennale pour inaugurer un grand espace à Dakar. La famille du sculpteur sénégalais Ousmane Sow, décédé en 2016, a aussi choisi ce moment pour ouvrir un musée d’une superficie de 1 500 m2 où sont déployées, dans des salles malheureusement trop chargées, ses célèbres œuvres monumentales, hommage aux guerriers africains. L’occasion de découvrir quelques travaux inachevés, comme la maquette du monument de la Renaissance africaine. Au lieu de la sculpture imaginée par Ousmane Sow, l’ancien président Abdoulaye Wade érigera un groupe grandiloquent tout en biceps réalisé par une usine nord-coréenne…
Dak’Art, jusqu’au 2 juin, www.biennaledakar.org







