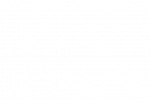« La Saison du diable » : la dictature de Marcos en opéra-rock

« La Saison du diable » : la dictature de Marcos en opéra-rock
Par Mathieu Macheret
Le cinéaste Lav Diaz évoque la répression sanglante des années 1970 aux Philippines par le biais d’une fiction chantée d’une sidérante beauté.
Célébrée dans les festivals et les centres d’art du monde entier (le Jeu de paume, à Paris, a reçu, en 2015, sa première rétrospective en France), mais réputée austère et exigeante, l’œuvre du Philippin Lav Diaz rencontre de plus en plus souvent le chemin des salles. Et il est toujours réjouissant de pouvoir tomber, même au creux de l’été, sur des films aussi bizarres et intrigants, aussi rétifs à toute norme que les siens.
Lav Diaz appartient à la famille des grands sculpteurs de durées, comme le Russe Andreï Tarkovski ou le Hongrois Bela Tarr, dont la mise en scène se préoccupe moins d’efficacité narrative que du souffle immanent qui la porte. Tout l’enjeu de ce cinéma est précisément de nous arracher à notre empressement quotidien, pour lui substituer une respiration méditative et un sens accru de l’espace.
La Saison du diable, présenté en compétition à la Berlinale, reprend à son compte l’un des grands motifs politiques du cinéma de Lav Diaz : la déploration des souffrances du peuple philippin, sous le joug des vagues de colonisation ou des régimes répressifs. Dédié « aux victimes de la loi martiale », le film nous plonge à la fin des années 1970, sous le règne sanglant du dictateur Ferdinand Marcos. Mais au lieu de ses habituels mélodrames d’inspiration dostoïevskienne, Diaz bifurque ici vers une sorte de comédie musicale d’agit-prop, ou plutôt d’« opéra-rock », comme il le définit lui-même, où les dialogues laissent place à un registre presque intégralement chanté.
Le récit tourne autour du personnage de Hugo Haniway (Piolo Pascual), poète activiste dont l’épouse, Lorena (Shaina Magdayao), part fonder un dispensaire dans un village de campagne défavorisé et réputé dangereux. C’est à cet endroit qu’une milice armée, aux ordres du tyran « Narciso », fait régner la terreur et l’obscurantisme parmi la population. Seuls quelques déshérités n’ayant plus rien à perdre osent encore s’opposer à ses nervis : le chef du village, vieillard boiteux qui ne mâche pas ses mots, ainsi qu’une vieille femme hirsute surnommée « la Chouette », qui vit dans la forêt et passe pour folle. Hugo, de son côté, se languit de sa femme, traverse une crise d’inspiration, puis décide de rejoindre Lorena au village, alors qu’elle semble dans le collimateur des militaires.
Bégaiement de l’Histoire
En pointant ainsi les exactions d’une force armée inique, Lav Diaz ne se contente pas de revenir sur un épisode tragique de l’histoire philippine, mais apostrophe aussi le présent. A travers la figure mythologique de Narciso, représenté comme un Janus aux deux visages (image frappante : le personnage arbore un second faciès à l’arrière de son crâne), le film vise non seulement Ferdinand Marcos, mais surtout sa réitération grotesque sous les traits de Rodrigo Duterte.
L’actuel président de l’archipel, Rodrigo Duterte, s’est signalé dernièrement par sa volonté de soumettre la mémoire du dictateur à une réhabilitation nationale.
Ainsi le basculement populiste du pays est-il évoqué, dans le film, comme un bégaiement de l’Histoire, un sinistre retour en arrière. L’une des premières scènes montre deux chefs militaires (une femme robuste et un homme à moitié défiguré) conspirer pour entretenir les villageois dans de lugubres superstitions, afin de dissimuler leurs malversations. La diffusion de mensonges, la manipulation des faits et l’usage usurpé de la force, qui définissent l’ensemble de leurs agissements, sont aussi les symptômes d’un pouvoir personnalisé et délirant (on y parle de « fonder une nouvelle Eglise »).
Lyrisme sec
Face à lui se dressent les fous, les artistes et les vieillards, réunis par la perte d’un ou de plusieurs proches, formant à la fois une communauté de souffrance et un chœur tragique. S’ils chantent, c’est pour délivrer leur complainte, mais aussi par confrontation avec l’ennemi, à la façon d’un répons. Son lyrisme sec s’avère ce que le film a de plus étonnant, les chants étant entonnés a cappella (en direct et sans doublage) par les comédiens. Des morceaux aux refrains entêtants, dont l’inspiration syncrétique oscille entre les syncopes du tagalog (la langue philippine) et la mélancolie du blues.
Fondés sur le lancinement et la répétition, ils s’imposent en d’enivrantes litanies contestataires. Par moments, une muse apparaît aux côtés de Hugo (Bituin Escalante, une chanteuse populaire célèbre aux Philippines) comme l’incarnation de l’inspiration musicale, faisant ponctuellement glisser le film dans le registre allégorique.
Ce film taillé dans la lenteur et la fixité est rendu captivant par la somptueuse composition de chacun de ses plans, au cœur desquels le regard plonge et s’aventure longuement. Devenu maître du noir et blanc numérique, Lav Diaz élabore de subtils dégradés de luminosités mouchetées, versant par moments dans des contrastes quasi expressionnistes.
Filmées à l’objectif grand angle, ses images sont soutenues par de profondes lignes de force, qui étendent le champ de vision. Chaque plan invente ainsi une scénographie particulière, théâtre de nature ou d’intérieurs, où le hiératisme des corps est compensé par un grand dynamisme plastique. C’est d’ailleurs l’un des points essentiels de cette Saison du diable que de définir la lutte contre le fascisme comme une quête éperdue de la beauté – qu’elle soit musicale, poétique, plastique ou tout cela à la fois.
Si le despotisme consiste à étendre toujours plus le règne de la laideur, la résistance passe par une fidélité décuplée aux splendeurs et à la sérénité du monde tellurique, où l’être humain et ses souffrances s’inscrivent de plain-pied.
LA SAISON DU DIABLE - Bande annonce
Durée : 01:14
Film philippin de Lav Diaz. Avec Piolo Pascual, Shaina Magdayao, Pinky Amador, Angel Aquino (3 h 54). Sur le web : www.arpselection.com/la-saison-du-diable,