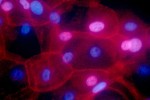Jeux vidéo : questions sur la reconnaissance de l’addiction par l’OMS
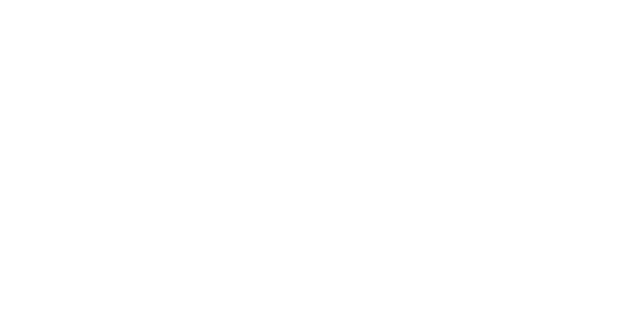
Jeux vidéo : questions sur la reconnaissance de l’addiction par l’OMS
Par Céline Mordant
La définition par l’Organisation mondiale de la santé d’un « trouble du jeu vidéo » fait débat : les jeux peuvent-ils vraiment être comparés à de la drogue ?
Au salon international du jeu vidéo E3 de Los Angeles en juin. / MIKE BLAKE / REUTERS
La décision de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) d’intégrer le « trouble du jeu vidéo » (gaming disorder) à la liste des addictions dans la future révision de la Classification internationale des maladies n’a pas fini de faire débat entre des psychiatres addictologues soucieux d’améliorer la prise en charge d’adolescents en souffrance et une communauté de joueurs qui se sent encore une fois stigmatisée et incomprise.
Quels sont les joueurs concernés ?
Selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, 5 % des jeunes Français de 17 ans joueraient entre cinq et dix heures par jour ; un adolescent sur huit aurait un usage « problématique » du jeu vidéo selon une enquête de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Pourtant, tous ces joueurs excessifs ne peuvent pas être qualifiés d’accros. « Toute habitude de jouer aux jeux vidéo n’est pas pathologique », a insisté fin juin le porte-parole de l’OMS.
La définition correspond à une « petite minorité » des joueurs, de l’ordre de 1 % selon certains addictologues. Une série de critères a été définie. Le seul temps de jeu ne suffit pas : l’incapacité à contrôler la fréquence, l’intensité et la durée du jeu sont aussi déterminants. Ainsi que l’impact de cette pratique sur les activités familiales, sociales, éducatives ou professionnelles, à condition qu’il soit ancien (au moins un an).
Pour la psychiatre addictologue de l’hôpital Paul-Brousse de Villejuif, Geneviève Lafaye, la décision de l’OMS va permettre de mieux identifier les malades pour lesquels cette pratique excessive est souvent la partie émergée de l’iceberg :
« Quand on a un enfant inhibé, avec des difficultés familiales, qui se met à jouer beaucoup, dans la durée, et qu’il y a des conséquences de plus en plus sévères sur sa vie quotidienne, il faut consulter. Même si on a un doute. »
Le problème n’est-il pas du ressort des parents ?
La psychologue clinicienne Vanessa Lalo craint que cette annonce de l’OMS ne cause plus de dommages que de bénéfices en alimentant encore davantage l’inquiétude et l’incompréhension des parents face aux usages numériques de leurs ados :
« Avec ce terme d’addiction, ils font peur à tout le monde. Le risque c’est que tout le monde croie que son enfant est accro. »
Alors que l’enfant manquerait juste de limites ? Dans sa consultation, Vanessa Lalo note que la plupart des problèmes sont dus « à un désarroi de parentalité » :
« Avec des productions aux terrains de jeu illimités, les parents peuvent vite être débordés s’ils ne sont pas fermes. »
Il faut que les parents s’intéressent aux jeux auxquels jouent leurs enfants, conseille-t-elle, pour fixer des limites adaptées :
« On peut se contenter de cinq minutes plusieurs fois par jour sur “Clash Royale” et avoir plutôt besoin d’une heure ou deux par jour sur “Fortnite”… »
Le docteur Geneviève Lafaye témoigne quant à elle de la souffrance de nombreux parents qu’elle voit arriver dans son service, après avoir vu divers spécialistes et obtenu des conseils contradictoires (entre « il faut lâcher la bride à votre ado » et « posez-lui plus de limites », difficile de s’y retrouver) :
« Il faudrait une prise en charge plus uniforme. »
Même si ce sont souvent les parents qui poussent la porte de l’unité pour jeunes adultes et adolescents qu’elle a fondée il y a cinq ans au sein du service addictologie de l’hôpital Paul-Brousse à Villejuif, moins de 5 % des patients refusent le programme de soins qui y est proposé : « Il n’y en a pas un qui dit qu’il n’a pas besoin d’être là. Au final ce programme de soins est à la hauteur de leur souffrance, ils se sentent reconnus. » Parmi les quelque deux cents nouveaux patients pris en charge par an dans l’unité, la plupart viennent pour dépendance à l’alcool ou au cannabis, ou pour toxicomanie. Un quart d’entre eux ont une pratique excessive des jeux vidéo. Pour le docteur Lafaye, les parents restent « de bons indicateurs » pour savoir quand leur enfant a un problème.
L’addiction aux jeux vidéos est-elle si particulière ?
« Le souci c’est le jeu vidéo ou la vie familiale ? », s’interroge Yann Leroux, qui se définit comme psychanalyste et geek. Pour lui, le jeu vidéo est encore une fois le « coupable idéal » et ce n’est pas nouveau : « Le débat sur l’addiction aux jeux vidéo a commencé dès les années 1970 avec les bancs d’arcade ! », rappelle-t-il. Les écrans sont plus des révélateurs que des fauteurs de trouble, insiste-t-il. « Quand on s’assoit en consultation avec les familles, on constate en fait des troubles classiques de l’adolescence : anxiété, dépression… Il n’y a pas besoin d’inventer une autre catégorie. »
Attention donc aux thérapies trop centrées sur le jeu lui-même et qui ne prendraient pas en compte l’ensemble des problèmes, souligne le psychanalyste. Et de s’inquiéter des conséquences catastrophiques en Corée du Sud ou en Chine de cette décision de l’OMS qui pourrait légitimer les prises en charge des adolescents accros aux jeux vidéo dans des centres spécialisés aux méthodes militaires…
Pour le psychanalyste Michael Stora, la question n’est pas de pathologiser des « crises d’ado virtuelles », mais bien de mieux aider ces « ermites vidéoludiques » qu’il voit en consultation depuis plus d’une décennie. « Rien de pire que le déni de souffrance », insiste-t-il, rappelant que la reconnaissance par le passé de la dépression avait grandement permis d’améliorer sa prise en charge. « Cette maladie, le gaming disorder, on la repère, elle existe. Ça ne va pas abîmer les jeux vidéo que de le reconnaître. Je suis joueur et je sais qu’à un moment donné, le jeu vidéo peut être un poison. »
Ce qui manque, dénonce Yann Leroux, lui aussi joueur invétéré, ce sont les preuves scientifiques. Selon lui, la pratique intensive des jeux vidéo n’entraîne ni rechute, ni syndrome de manque (le patient guérit spontanément dès qu’on lui coupe sa console), ne cause pas de dommages irréversibles dans le cerveau comme l’alcool… « Les gamers libèrent autant de dopamine que celle qui est libérée pendant la lecture d’un livre », dit-il.
« Cette décision de l’OMS n’est pas tombée du ciel », lui répond le docteur Bruno Rocher, psychiatre addictologue au CHU de Nantes, pour qui l’objectif de la classification est au contraire de favoriser et faire progresser la recherche, notamment sur l’impact du jeu excessif sur le cerveau, dont il ne doute pas qu’il pourra être proche de celui de l’alcool par exemple. En attendant, « la reconnaissance du gaming disorder va inciter de nouveaux patients à consulter, et c’est un plus en termes de santé publique ».
La décision de l’OMS va-t-elle changer le regard des pouvoirs publics sur le jeu vidéo ?
Début juillet, une députée La République en marche interpellait à l’Assemblée nationale le secrétaire d’Etat chargé du numérique pour qu’il clarifie « les intentions du gouvernement » en matière de prévention et de prise en charge des « addictions aux écrans et aux jeux vidéo ».
L’annonce de l’OMS incitera-t-elle les pouvoirs publics à se mêler d’un dossier jusque-là laissé entre les seules mains des éditeurs ? « Il faut que l’Etat reprenne en main la prévention », juge Vanessa Lalo, qui dénonce l’inefficacité de la classification PEGI, un système d’évaluation élaboré en 2003 par la Fédération européenne des logiciels de loisirs, lobby représentant l’intérêt des éditeurs. L’association PEGI s’est montrée par exemple réticente à avertir les joueurs contre la présence de loot boxes – des « pochettes-surprises » payantes qui permettent d’avancer plus facilement dans un jeu vidéo – et a refusé de les signaler comme des jeux d’argent.
Vanessa Lalo plaide pour la création d’une autorité de régulation indépendante, face à une industrie (la première industrie culturelle dans le monde) qui produit des jeux de plus en plus addictogènes. « Le jeu vidéo aujourd’hui, c’est comme si on avait Disneyland dans son salon, souligne le psychiatre Olivier Phan. Ouvrir un livre devient fastidieux quand, à côté, il y a les jeux vidéo qui savent capter l’attention instantanément. Un jeune ne pourra jamais s’autoréguler avec les écrans, la lutte est trop inégale. »