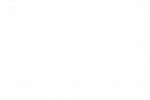« S’il se retire, Joseph Kabila deviendra l’une des personnalités les plus importantes de l’histoire congolaise »

« S’il se retire, Joseph Kabila deviendra l’une des personnalités les plus importantes de l’histoire congolaise »
Propos recueillis par Joan Tilouine
Le chercheur Jason Stearns, spécialiste de la RDC, décrypte les enjeux des élections prévues en décembre.
Des habitants de Kinshasa se retrouvent dans un bar pour regarder l’intervention du président congolais, Joseph Kabila, le 19 juillet 2018. / AFP
Situation exceptionnelle, le président Joseph Kabila dirige toujours la République démocratique du Congo (RDC) malgré la fin de son dernier mandat, le 19 décembre 2016. L’élection présidentielle a été reportée de nombreuses fois, au point d’être un temps devenue une chimère ou un mirage dans cet immense pays d’Afrique centrale.
Le pouvoir en place assure cette fois que le scrutin se tiendra le 23 décembre, en même temps que les législatives et provinciales. Joseph Kabila, 47 ans, a désigné au dernier moment son candidat. Il s’agit de l’ancien ministre de l’intérieur Emmanuel Ramazani Shadary, qui figure sur la liste de sanctions de l’Union européenne (UE), accusé d’avoir joué un rôle dans la répression des manifestations prodémocratiques.
Bien qu’encore incertaines, ces élections se préparent dans un contexte de profonde crise politique et de suspicions de fraudes renforcées par l’usage de la machine à voter électronique. Des personnalités de l’opposition comme l’ancien vice-président Jean-Pierre Bemba ou l’ex-gouverneur du Katanga Moïse Katumbi ont été empêchées de figurer sur la ligne de départ. Ce qui peut donner l’impression d’élections taillées sur mesure par le régime, qui refuse au nom de la souveraineté nationale tout financement étranger, de même que la présence d’observateurs électoraux.
Ces élections constituent un défi pour une nation grande comme l’Europe de l’Ouest et pourraient être un moment historique. Car jamais, depuis son indépendance, la RDC n’a pu vivre une alternance pacifique par les urnes. A la présidentielle de 1977, puis à celle de 1984, le pays s’appelait Zaïre et le candidat unique était Mobutu Sese Seko. Ce dernier sera renversé en 1997 par les rebelles de Laurent-Désiré Kabila, qui lui succède jusqu’à son assassinat en janvier 2001. Cette année-là, son fils Joseph, 29 ans, et devient l’un des présidents les plus jeunes au monde. Il est élu une première fois en 2006, puis de nouveau cinq ans plus tard, et s’accrochera au pouvoir jusqu’à la tenue de ces élections tant attendues.
Chercheur à la New York University, où il dirige le Groupe d’étude sur le Congo, Jason Stearns décrypte les enjeux de ce scrutin et la stratégie du régime en place.
Peut-il encore y avoir des élections considérées comme crédibles par les organisations régionales et les partenaires occidentaux ?
Jason Stearns Si l’on évalue ces élections selon la qualité des institutions qui les organisent, la réponse est non. Car le régime de Joseph Kabila contrôle nombre d’entre elles, de la Commission électorale nationale indépendante [CENI] à la Cour constitutionnelle, en passant par la police et les administrations locales. Toutes ont été impliquées dans des manipulations politiques visant à reporter les élections, à défavoriser l’opposition et à réprimer la contestation.
Sur le plan technique, il y a aussi des failles, notamment celle du fichier électoral : il y a potentiellement 13,8 millions de cartes d’électeurs défectueuses en circulation – soit plus d’un tiers de l’électorat –, dont 6,2 millions sont des doublons ou ont été distribués à des mineurs et 6,6 millions manquent des données biométriques nécessaires. Du coup, beaucoup de Congolais n’ont plus confiance en ces institutions et redoutent des irrégularités.
Mais les résultats importeront plus que ces détails techniques. D’un sondage national que nous avons mené en juillet, il ressort que seulement 15 % des personnes interrogées ont l’intention de voter pour un membre de la coalition de Kabila. Le mode de scrutin étant à un tour depuis la révision de la Constitution en 2011, Emmanuel Ramazani Shadary pourrait l’emporter avec très peu de voix. Ce qui sera difficile à accepter pour beaucoup de Congolais, même si le processus est jugé crédible. En revanche, si un candidat de l’opposition l’emporte, malgré les dysfonctionnements techniques, beaucoup considéreront ce scrutin comme crédible.
L’opposant congolais Jean-Pierre Bemba à Kinshasa, le 2 août 2018. / AFP
La Cour constitutionnelle a invalidé la candidature de Jean-Pierre Bemba. Cela risque-t-il de renforcer le clivage entre l’est du pays, dont est originaire M. Kabila, et l’ouest, fief de M. Bemba ?
Je ne crois pas. Si l’ethnicité compte indéniablement, c’est un paramètre situationnel. Ce clivage est-ouest a été artificiellement amplifié. Bien sûr, il y a des clichés, parfois nauséabonds, à propos des « swahiliphones » de l’est du pays et des « lingalaphones » de l’ouest.
Mais des sondages réalisés par notre Groupe d’étude sur le Congo apportent de la nuance. Ainsi, avant la libération de M. Bemba, le candidat le plus populaire dans la région de l’ex-Equateur [ouest] était Moïse Katumbi, un Katangais qui n’a aucun lien familial avec cette région. Et lors de la présidentielle de 2011, le leader de l’opposition Etienne Tshisekedi [décédé le 1er février 2017], originaire du Kasaï [centre], l’a emporté dans une grande partie des Kivus [est].
Beaucoup, dans l’opposition, critiquent la mainmise des « Katangais » aux postes stratégiques du régime…
Joseph Kabila n’a jamais été un idéologue ethnique. Il voit l’ethnie comme une éventuelle variable d’instrumentalisation, de même qu’un facteur pour organiser le pouvoir. Mais il n’a pas un attachement profond à une communauté. Il ne faut pas oublier qu’il n’avait pas vraiment vécu en RDC jusqu’à 25 ans et que la rébellion de son père, Laurent-Désiré Kabila, comptait dans ses rangs plus de miliciens des Kivus que du Katanga. Depuis son arrivée au pouvoir, Joseph Kabila s’est entouré de personnalités originaires de tout le pays, même si ceux du Maniema et du Katanga sont en effet très visibles.
Les marches organisées par l’Eglise, la société civile et l’opposition ont été systématiquement interdites ou réprimées et les poids lourds de l’opposition n’ont pas pu se présenter. Est-ce une stratégie du pouvoir ?
Je ne qualifierais pas cela de stratégie cohérente et pensée. Joseph Kabila est un bon tacticien mais pas un stratège. Lui et ses conseillers ont tâtonné ces dernières années, ont fait marche arrière lorsque leurs décisions ont provoqué de vives critiques de la part de leur population ou de leurs partenaires occidentaux et régionaux. Leur plan initial était, je pense, de maintenir Kabila à la tête de l’Etat en reportant sans cesse les élections ou en obtenant la possibilité de briguer un nouveau mandat. Ils ont changé d’approche suite aux grandes manifestations, aux sanctions ciblées des Etats-Unis et de l’UE et aux reproches formulés par les puissances régionales.
Leur tactique peut fonctionner, mais il y a beaucoup d’incertitudes. Si les élections se tiennent dans les conditions actuelles et que la coalition de Kabila l’emporte « à tous les niveaux », comme le martèlent ses leaders, il y aura sans doute des contestations, des manifestations. Mais si la population n’arrive pas à se mobiliser face à la répression souvent brutale, si les acteurs régionaux n’exercent pas une pression accentuée et si le cœur du système sécuritaire demeure loyal à Kabila, le régime pourrait bien se maintenir. Toutefois, compte tenu du manque de cohésion des élites au pouvoir et du niveau de frustration de la population, la situation est très volatile, ce qui rend toute prédiction difficile.
Le « dauphin » de Joseph Kabila, Emmanuel Ramazani Shadary, à Kinshasa, en août 2018. / AFP
En désignant Emmanuel Ramazani Shadary comme son « dauphin », Joseph Kabila va-t-il pouvoir continuer d’exercer indirectement le pouvoir en cas de victoire ?
Le choix de M. Shadary n’est pas anodin. Peu connu, il ne dispose pas de véritable base politique en dehors de sa petite province du Maniema, d’où est originaire la mère de Joseph Kabila, et il est visé par des sanctions européennes. Autant de caractéristiques qui font de lui un allié loyal de Kabila. Se contentera-t-il de rester fidèle ? Kabila aura-t-il toujours le dernier mot sur les nominations dans l’armée, sur les contrats miniers et sur les alliances géopolitiques ? Il est trop tôt pour répondre.
Là encore, il y a beaucoup de risques pour le chef de l’Etat. Depuis son arrivée au pouvoir, il a gouverné à travers la faiblesse plutôt que par la force. Fragmenter, diviser pour mieux régner ont été les clés de son pouvoir politique. Ainsi, pendant les élections de 2011, ses conseillers avaient par exemple encouragé la multiplication de partis politiques pour morceler le paysage et monter les rivaux les uns contre les autres. Désormais, Kabila a besoin de cohésion au sein de son équipe, ce qui n’est pas évident. Si le pays s’enfonce dans une crise profonde, ses alliés pourraient l’abandonner.
Comment analysez-vous les difficultés de l’opposition ?
La crédibilité de ses leaders est en cause. Nombre d’entre eux ont été fidèles à Kabila, qu’ils ont servi avec zèle. Certains, comme Moïse Katumbi, ont été très proches de lui et ont pu considérablement s’enrichir. La population a du mal à croire qu’ils seront différents une fois au pouvoir.
A ce problème de crédibilité s’ajoute la question des ressources. La coalition au pouvoir a un énorme avantage : l’argent et les moyens de l’Etat. Car, depuis la modification de la loi électorale en décembre 2017, il faut un million de dollars pour présenter des candidats à chaque scrutin [présidentielle, législatif et provincial]. D’autres millions de dollars sont nécessaires pour faire campagne dans tout le pays.
Mais il y a un problème plus général : le « factionnalisme ». Tant que les partis politiques seront perçus comme des vecteurs pour que les élites se propulsent au pouvoir, alors les divisions persisteront.
Quelles sont les principales incertitudes liées à ces scrutins ?
Primo : comment l’opposition va-t-elle réagir au fait que Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba ne peuvent pas se présenter ? Cela pourrait les contraindre à s’unir derrière un autre candidat – Félix Tshisekedi [le fils d’Etienne Tshisekedi] serait probablement leur choix naturel. D’autres pourraient appeler à une « transition sans Kabila ». Si une partie importante de l’opposition boycotte ces élections et se retrouve exclue du jeu, cela pourrait changer radicalement la situation politique.
Deuzio : comment la rue et les églises vont-t-elles réagir ? S’ils peuvent se mobiliser comme au début de cette année, cela rendra beaucoup plus difficile les fraudes électorales. Sinon, je doute que les diplomates étrangers fassent trop de bruit.
Tertio : la pression diplomatique étrangère. Si des manifestations d’ampleur sont déclenchées et qu’elles durent, il est probable que l’Angola et l’Afrique du Sud interviendront sous une forme ou une autre. L’Union africaine [UA] et les Nations unies seraient alors obligées de réagir.
Les Occidentaux ont-ils encore les moyens de peser sur l’évolution politique ?
La plupart des superpuissances ont finalement très peu d’intérêts stratégiques en RDC, à l’exception de l’accès au cuivre et au cobalt. La Chine et la plupart des pays occidentaux estiment qu’ils pourront continuer d’y bénéficier d’intérêts économiques, que Kabila ou un autre soit au pouvoir. Mais l’urgence humanitaire préoccupante, avec près de 4,5 millions de déplacés internes et 13 millions de personnes qui ont besoin d’assistance, explique en partie l’implication, voire l’ingérence, plus importante en RDC qu’au Burundi ou au Rwanda. Ce qui agace le pouvoir.
Les sanctions américaines ciblées ont eu un effet certain, compte tenu du pouvoir du dollar. Mais elles ont aussi contraint le cœur du régime à se durcir, voire à se radicaliser. L’impact de ces sanctions dépendra finalement de l’évolution politique. Si Kabila continue d’attirer des investisseurs et renforce ses alliances avec la Chine, la Russie et certains pays de la sous-région, et si les zones urbaines congolaises restent plus ou moins stables – Kinshasa se soucie peu du sort des ruraux –, alors les sanctions n’auront pas l’impact souhaité.
Un soldat de l’armée congolaise scrute l’horizon dans le Nord-Kivu, en mai 2018. / ALEX MCBRIDE / AFP
Une partie du territoire échappe au contrôle de l’Etat, comme dans les Kivus, où près de 140 groupes armés ont été identifiés. Les élections vont-elles pouvoir s’y tenir ?
L’enregistrement des électeurs a pu être mené à bien sans trop de difficultés dans la plupart des Kivus et les élections de 2006 et 2011 s’y sont déroulées sans incidents majeurs. Mais ces élections pourraient exacerber les dynamiques du conflit : des groupes armés vont être utilisés par certains politiciens pour intimider les opposants et renforcer l’impression d’indispensabilité.
Du Tanganyika au Kasaï, de l’Ituri au Nord-Kivu, des massacres ont été perpétrés ces dernières années et plusieurs conflits sont toujours en cours. Comment jugez-vous les accusations de l’opposition, qui a pris l’habitude de pointer la « main noire » du régime ?
Cette théorie de la « main noire » flirte avec le conspirationnisme. Il y a une tendance à voir Kabila comme le principal problème et à se dire que, s’il part, le pays ira mieux. Oui, il y a une culture de l’impunité dans l’armée, dans laquelle le racket et autres crimes sont pratiqués par des soldats qui sont contraints à survivre. Et le président Kabila est en fin de compte responsable. Mais cela ne veut pas dire qu’il a forgé à lui seul cette culture de l’impunité ou qu’il ordonne lui-même à ses soldats de piller et violer. Les dynamiques de la violence sont plus insidieuses et impliquent de nombreux acteurs.
Le problème est devenu structurel. Il est difficile pour les forces de sécurité de prospérer en l’absence de guerre. Car leurs recettes réelles dépendent essentiellement des paiements légaux ou extrajudiciaires liés aux opérations militaires. L’armée paie à peine ses soldats et ses officiers, les rendant complètement dépendants du patronage politique de leurs supérieurs. La commission chargée de gérer les démobilisations a quasiment disparu. Et il n’y a presque pas de pourparlers de paix entre le gouvernement et les 140 groupes armés actifs dans les Kivus.
Plus qu’un complot visant à instaurer le chaos, j’aurais tendance à pointer l’apathie du régime, qui n’a montré que peu d’intérêt à mettre fin aux guerres qui se déroulent loin de Kinshasa et ne menacent pas sa survie. Kabila a privilégié la continuité des réseaux de patronage plutôt que la sécurité de ses citoyens, la survie d’une élite plutôt que des réformes institutionnelles. Le pouvoir congolais récompense la fidélité au lieu d’instiller la discipline et n’a pas cherché à redonner à l’Etat le monopole de la force.
Ce n’est pas seulement le régime qui est coupable. Malgré les violences, le Parlement n’a jamais enquêté sur les forces de sécurité et n’a mené que des investigations rudimentaires sur les violences dans les Kivus. Oui, le gouvernement est responsable. Oui, Kabila est responsable. Mais la nature de leur responsabilité est complexe et changer de président n’est pas la solution miracle si le système en place demeure.
Comment Joseph Kabila est-il parvenu à garder le contrôle sur l’armée, estimée à près de 130 000 hommes ?
Les conditions de vie des soldats sont terribles. Des soldats blessés sur les lignes de front sont parfois transportés pendant des jours avant de bénéficier de soins et doivent souvent payer eux-mêmes les médicaments. Même les officiers reçoivent un salaire dérisoire – le général le plus élevé gagne moins de 100 dollars par mois.
Néanmoins, Kabila a été en mesure d’empêcher la dissidence au sein des forces de sécurité en les maintenant divisées, dépendantes du favoritisme et très loin de la capitale. La majorité des troupes sont dispersées dans l’est du pays et la capitale est contrôlée par la garde présidentielle, appuyée par quelques unités loyales de l’armée.
Enfin, il est difficile de contester le pouvoir central si l’armée est morcelée en une variété de réseaux de patronage. Des officiers supérieurs, qui ont beaucoup bénéficié de ce système, se démènent pour placer leurs hommes à des postes de commandement lucratifs et très prisés. Beaucoup pensent qu’ils seraient encore plus mal lotis si le système Kabila s’effondrait.
La mission des Nations unies en RDC semble se plier aux exigences du gouvernement congolais. N’est-ce pas un aveu d’échec de la part de l’ONU, présente depuis vingt ans et dont l’objectif était de rétablir la paix et la démocratie ?
Oui, mais je pense qu’il faut être réaliste avec les attentes de cette mission. La Monusco a énormément contribué à l’unification du pays en 2003 et à la transition démocratique qui a conduit à l’organisation des premières élections multipartites de l’histoire du pays, en 2006. Depuis lors, la Monusco a été marginalisée et confinée à ce qu’elle sait le moins bien faire : la protection des civils en danger immédiat.
Je pense que nous devons cesser de voir l’ONU comme un acteur essentiel. La Monusco est importante pour fournir des informations, faciliter un accès humanitaire et prévenir une escalade. Mais l’UA, les pays de la région, les Etats-unis et l’UE sont beaucoup plus importants politiquement. Et ce dont la RDC a besoin aujourd’hui, c’est d’une solution politique.
Présentation d’une machine à voter à Kinshasa, en février 2018. / JOHN WESSELS / AFP
Si les élections se tiennent le 23 décembre, Joseph Kabila quittera la présidence. Que retiendra l’histoire de ses dix-huit années à la tête du pays ?
S’il quitte le pouvoir à l’issue des élections, Joseph Kabila se retirera comme l’une des personnalités les plus importantes de l’histoire congolaise. Lorsqu’il est devenu président à 29 ans, la plupart des articles de presse sous-entendaient qu’il ne finirait pas l’année. Il apparaissait faible et le pays était en crise, avec une économie exsangue et huit armées étrangères présentes sur son sol. La moitié du pays était occupée par des rebelles. Il savait qu’il devait prendre des mesures drastiques pour survivre et mettre son pays sur la bonne voie.
Joseph Kabila a adopté une politique radicalement différente de celle de son père, libéralisant l’économie, collaborant avec la Monusco, ouvrant des pourparlers de paix avec ses ennemis et acceptant de nouveaux programmes avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Il a unifié le pays et a pu se présenter comme le grand artisan de la paix, remportant la présidentielle de 2006. L’économie a connu une croissance de près de 500 % entre 2001 et 2014 et une Constitution, la plus progressiste que le pays ait jamais eue, a été adoptée. Autant de réalisations importantes.
Mais il y a d’autres facettes qui éclipsent ce bilan positif. L’économie a connu un essor important grâce à la fuite des actifs miniers vers les sociétés étrangères, entraînant d’énormes profits pour certains membres de l’élite congolaise – dont Joseph Kabila lui-même et Moïse Katumbi – et des sociétés étrangères. Les Congolais, eux, n’en ont que très peu profité.
Le conflit dans les Kivus est devenu plus fragmenté et moins visible, mais non moins meurtrier : plus de 4,5 millions de personnes sont déplacées, plus que jamais dans l’histoire congolaise. Enfin, alors que de nouvelles institutions démocratiques ont été créées – des parlements aux niveaux provincial et national, un nouveau régime de droits civiques, des élections régulières –, elles ont été sapées par l’accaparement du pouvoir politique et économique par des élites. On attend encore l’émancipation des Congolais.