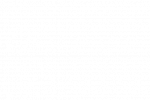Médecine : « J’ai vécu ma première année comme isolée dans une chambre noire »

Médecine : « J’ai vécu ma première année comme isolée dans une chambre noire »
Par Alice Raybaud
Alors qu’une réforme des études de santé doit être annoncée mardi, les futurs praticiens racontent l’angoisse de leur première année de médecine et les sacrifices qu’elle exigeait.
« L’année s’écoule, on rate les anniversaires, les repas de famille, le premier de l’an, Noël même », se souvient Pierre-Marie de sa Paces, aujourd’hui en fin de cursus de médecine. / David Darrault / Université de Tours via Campus
Les parents de Quentin s’en souviennent encore. Les appels incessants pour que leur fils vienne se joindre au repas familial, sa mine déconfite en s’asseyant autour de la table, ses cours encore bien calés sous le bras pour pouvoir les feuilleter entre deux bouchées. Quentin était alors en première année de médecine. Aujourd’hui, il entame la dernière ligne droite de son internat, mais il se rappelle très bien du stress quotidien qui l’a accompagné pendant cette première année commune aux études de santé (Paces), qu’il a dû doubler : « C’est simple, chaque espace visible de la chambre et des toilettes était recouvert par plusieurs feuilles de cours. Lorsque mon réveil sonnait, je prenais mes cours sur ma table de chevet et commençais à travailler sans même prendre le temps de petit-déjeuner. »
Hors de question de perdre la moindre minute de peur de baisser dans le classement, objet d’obsession et d’angoisse des quelque 60 000 inscrits en Paces chaque année. Ce stress, généré par un concours au numerus clausus (nombre maximal de places pour accéder en deuxième année fixé par le gouvernement, en vigueur depuis 1971) très restreint, pourrait être atténué lors de la réforme de la formation des professionnels de santé. Emmanuel Macron, qui au cours de sa campagne avait jugé le numerus clausus « injuste » et « inefficace », devrait se prononcer mardi sur son avenir ainsi que sur celui de l’ensemble du concours de première année.
Jusqu’à aujourd’hui, chaque année, moins d’un quart des aspirants aux métiers de la santé régis par numerus clausus (médecine, pharmacie, odontologie [dentaire] et maïeutique [sage-femme]) parvenaient à passer le couperet du concours, malgré les heures de travail abattues. La plupart des anciens étudiants en Paces qui ont répondu à notre appel à témoignage évoquent entre dix et quinze heures de travail quotidien, y compris le week-end.
A la sortie du lycée, la « quantité phénoménale de cours théoriques à apprendre par cœur » a été un choc pour Kostas, qui est aujourd’hui interne à Rennes. Pour tout engranger, il lui a fallu optimiser son temps au maximum. « Je ne faisais mes courses que dans l’absolue nécessité, et mes parents faisaient 100 km aller-retour tous les dix jours pour me livrer à manger, explique-t-il. Ce “temps de livraison” ne devait pas excéder trente minutes et se déroulait en début d’après-midi de façon à impacter le moins possible mon temps de travail. En retour, je leur donnais mon sac de linge sale. Un jour, je me suis même mis à pleurer face à ma mère parce qu’elle restait trop longtemps chez moi. »
« On s’isole socialement »
Cette intensité de travail est présentée par les étudiants comme une nécessité pour se maintenir dans le peloton de tête et être admis en 2e année en pouvant choisir sa filière (médecine étant la plus demandée). Un rythme qui impose de nombreux sacrifices. « L’année s’écoule, on rate les anniversaires, les repas de famille, le premier de l’An, Noël même puis vient le jour du concours du premier semestre », se remémore Pierre-Marie, aujourd’hui interne en fin de cursus d’oncologie à Lyon.
Après ce premier concours de mi-année, les échéances s’enchaînent, parfois traumatisantes pour des élèves pour la plupart habitués à décrocher de bonnes (voire d’excellentes) notes. « Les jours de résultats beaucoup pleuraient ou s’isolaient pour ne pas en parler, se souvient Antoine, interne en radiologie. J’ose à peine imaginer comme ça devait être dur à vivre de travailler autant et ne pas avoir les résultats attendus. »
Pour de nombreux étudiants s’ajoutent au stress du jour J et au travail en amont la violence de la concurrence et la difficulté à se faire sa place auprès de ses camarades. Laure, aujourd’hui interne en médecine générale à Bordeaux, évoque « l’ambiance exécrable en amphithéâtre », notamment les premières semaines, où elle dit avoir dû subir un « bizutage par des doublants ». « Puis, on s’isole socialement afin de ne pas perturber un emploi du temps sensible », raconte-t-elle. Même constat pour Améline, qui vient de réussir le concours à Lyon, après deux ans de ce qu’elle nomme un « cloisonnement social » : « J’ai vécu ma première année comme une immersion dans une chambre noire interminable. »
« Une sélection inadaptée »
Beaucoup s’enferment pendant un, voire deux ans, pour apprendre par cœur des centaines de fiches sur la biologie cellulaire ou sur le fonctionnement quantique d’un appareil à IRM. Un « bachotage » de plus en plus remis en question, y compris par les étudiants eux-mêmes. « Certaines matières comme la physique ne nous sont plus d’aucune utilité dans la suite de notre cursus et étaient présentes au concours uniquement dans le but de nous classer », assure Nils, en troisième année à Sorbonne Université (ex-Paris-VI ou université Pierre-et-Marie-Curie), qui continue à éprouver du stress au seul souvenir de la Paces. « Cette méthode de sélection est inadaptée, regrette Anna, en deuxième année à Paris-Descartes. Elle ne présente pas suffisamment aux étudiants le métier qu’ils pratiqueront et ne se base que sur une capacité à travailler toujours plus pour une profession qu’ils ne connaissent même pas. »
Cette réalité du métier, Claire s’y est confrontée une fois le concours passé, quand elle a commencé l’internat : « Personne ne m’avait parlé des drames quotidiens, de la souffrance ou tout simplement des corps de personnes très âgées, des odeurs… » L’étudiante parisienne en oncologie s’est « surprise » à apprécier l’hôpital et ses patients, mais tous ses camarades n’ont pas eu une chance semblable. Certains ont même changé de voie pour s’être rendu compte, a posteriori, des difficultés de cette profession. « C’est dommage quand on connaît l’investissement que demande le concours de première année, remarque Claire. Une solide et sélective formation scientifique est indispensable mais pourquoi ne pas prendre également en compte l’empathie et la relation de soin ? »
« Ce couperet a le mérite de la clarté »
Les apprentis médecins ne sont cependant pas unanimes à souhaiter une réforme. L’une des pistes évoque le déplacement du concours de fin de première année vers la fin de la troisième année. Une licence de santé serait ainsi créée de fait, au terme de laquelle la sélection s’effectuerait parmi les futurs pratiquants. Une fausse bonne idée pour certains étudiants comme Quentin, qui ne voit là que le transfert du problème dans le temps : « S’il y a sélection en troisième année, alors ça ne sera plus un an, voire deux, gâchés pour ceux qui échoueront. D’autant que l’ambiance de compétition que l’on connaît en Paces se reporterait naturellement sur la deuxième ou la troisième année. »
Pour d’autres, l’année de Paces, telle qu’elle existe aujourd’hui, représente même une expérience très formatrice qu’ils trouveraient absurde d’éliminer. « Malgré toutes les critiques que je peux entendre, je pense que ce concours permet de sélectionner des gens à la fois motivés, endurants et stables psychologiquement : des qualités essentielles pour le métier de médecin et surtout pour tenir durant toutes ces années d’études (très) laborieuses », assure Thomas, interne en chirurgie à Lille. Pour lui, le système est égalitaire : mêmes questions pour tous, temps de préparation et de rédaction identique, et pas d’oraux, « donc pas de favoritisme ! ».
Bruno, qui a réussi sa première année à Tours en 2007, loue également la cohérence de ce système : « Certes, on vit huit mois difficiles mais le couperet du concours a au moins le mérite de la clarté et les reçus sont sûrs d’être médecins à terme, explique-t-il. A choisir, je préfère ce système à celui vécu par plusieurs amis en psychologie, sociologie, biologie, histoire où il est censé ne pas y avoir de sélection mais où un pourcentage significatif des promotions est mis dehors sans diplôme chaque année parce qu’“il fallait 12 de moyenne pour s’inscrire en master 2”, ou encore parce qu’“il vous manque un stage validant”… »