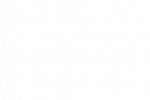« Phoenix » : revenu des camps, un fantôme dérange les vivants

« Phoenix » : revenu des camps, un fantôme dérange les vivants
Par Thomas Sotinel
Christian Petzold met en scène l’aveuglement des Allemands et la normalisation après la guerre.
Ronald Zehrfeld est Johnny, le mari de Nelly interprétée par Nina Hoss. / SCHRAMM FILM / CHRISTIAN SCHULZ
En 1945, les Allemands semblent employer toute leur énergie à survivre. Mais il leur faut fournir un autre effort, surhumain, pour fermer les yeux. Christian Petzold, né en Allemagne quinze ans après la destruction de Berlin, a entrepris un film impossible qui veut mettre en scène l’aveuglement qui vient après le crime, et la lutte des victimes survivantes pour ne pas être réduites à l’état de spectres invisibles. Comment le montrer ? Petzold sait bien qu’on ne peut mettre en scène ce qui s’est passé à l’intérieur du système concentrationnaire nazi. D’ailleurs, ce n’est pas le crime lui-même qui l’intéresse, mais ce moment où il a été nié, enfoui. Avec son coscénariste, Harun Farocki, ils ont choisi la voie du mélodrame, d’une histoire folle, paroxystique, pourtant contenue par la rigueur de la réflexion.
Nelly (Nina Hoss) a été laissée pour morte après qu’on lui a tiré une balle dans la tête juste avant l’arrivée des Alliés dans le camp d’extermination où elle attendait la mort. Elle a survécu sous un tas de cadavres. Quand son amie Lene (Nina Kunzendorf), berlinoise et juive comme elle, la prend en charge, elle est défigurée et riche de l’héritage de toute une famille assassinée. Lene veut l’emmener en Palestine, à Haïfa, mais Nelly veut retrouver son mari, Johnny (Ronald Zehrfeld). Elle le découvre en homme à tout faire dans un club fréquenté par les troupes d’occupation et les trafiquants.
Johnny ne reconnaît pas Nelly, dont le visage est encore meurtri. Il lui trouve une ressemblance extraordinaire avec son épouse et demande à celle qu’il prend pour l’une des créatures jetées à la dérive par la guerre de tenir le rôle de la disparue, afin de toucher son héritage. Johnny se fait metteur en scène et dirige Nelly dans un rôle qu’elle ne connaît que trop bien. La revenante, elle aussi aveuglée par le souvenir de l’amour qui fut, ne veut pas admettre l’évidence : la cupidité, la lâcheté, et peut-être la trahison, malgré les avertissements de Lene.
L’effacement de l’horreur
Il faut, pour toucher à la beauté de Phoenix, renoncer à se poser certaines questions qui relèvent de la logique du « ça ne se peut pas ». Nina Hoss est d’un grand secours. Le visage couvert de bandages puis à moitié défigurée, les cheveux filasse, avant de recouvrer sa beauté passée, elle laisse affleurer une vie entière de souffrances vécue en une année (elle a été arrêtée en 1944, nous dit le scénario) et l’espoir d’une autre vie qui ressemblerait au bonheur enfui. Ronald Zehrfeld, dans le rôle le plus ingrat que l’on puisse imaginer, explore toutes les stratégies qu’un lâche peut imaginer pour arriver à se regarder dans le miroir.
On sent bien que le spectacle que veut donner Petzold n’est pas celui de l’horreur qui vient d’arriver, mais celui de la normalité qui revient. Sa mise en scène, claire et précise, utilise les outils de la reconstitution historique sans y attacher une importance excessive. On voit brièvement les ruines, il n’y a pas de flash-back sur la déportation (juste un rêve, à la limite de l’abstraction), le reste du monde (les militaires alliés, les civils allemands) est tout juste suggéré.
Nelly résiste à cet effacement de l’horreur, dont elle devient le témoin unique. Elle voudrait garder l’amour de son homme et qu’au moins on l’écoute. Mais comme le dit Johnny quand elle s’inquiète de la réception que feront ses anciens amis à la vraie-fausse-vraie disparue : « Personne ne te demandera rien. »
Phoenix, de Christian Petzold avec Nina Hoss, Ronald Zehrfeld et Nina Kunzendorf (Allemagne, 2014, 98 min).