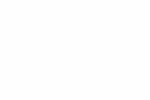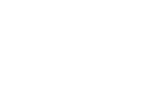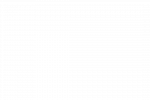Entre deux frontières, les interminables attentes d’un Ivoirien en route pour l’Allemagne

Entre deux frontières, les interminables attentes d’un Ivoirien en route pour l’Allemagne
Par Carolina Kobelinsky
Dix mois dans un campement au Maroc, huit dans un centre de séjour à Melilla, six en Espagne… Tout au long de leur parcours, les migrants apprennent à patienter.
Des migrants subsahariens à Boukhalef, près de Tanger, au Maroc, en septembre 2018. / FADEL SENNA / AFP
Dans un centre pour demandeurs d’asile dans la campagne bavaroise, en Allemagne, Adama Touré (nom fictif) attend des nouvelles de la procédure qu’il a entamée afin d’obtenir le statut de réfugié. Il attend surtout de pouvoir « passer à autre chose, reprendre la vie un peu ». Depuis bientôt deux ans, il attend. Non, « tout ça a commencé il y a bien plus longtemps, bien trop longtemps », me rappelait-il au téléphone la dernière fois que j’ai eu de ses nouvelles, en novembre 2017.
Tout au long de leurs parcours, les personnes migrantes sont soumises à différentes formes d’attente au cours desquelles elles apprennent que leur temps est jugé sans valeur. À travers cette dépréciation de leur temps, c’est le mépris pour la valeur sociale des personnes migrantes qui devient manifeste.
Trois ans auparavant à Melilla, enclave espagnole en territoire marocain où j’ai fait sa connaissance, Adama Touré attendait de poursuivre son chemin en Europe. Deux semaines plus tôt, il était encore de l’autre côté du triple grillage haut de 6 mètres qui matérialise la frontière terrestre entre l’Afrique et l’Europe. Au Maroc, il était resté un an. Avant l’attente ouverte par le dépôt de la demande d’asile en Allemagne, le parcours d’Adama Touré est ainsi fait de poches d’attente. Attente qui, à chaque fois, dans chaque endroit, prend une texture singulière.
Au début, la joie et l’optimisme
Né en Côte d’Ivoire il y a vingt-neuf ans, Adama Touré avait réussi le saut des clôtures deux semaines avant notre rencontre. Fier de cet exploit, mais surtout soulagé de se trouver en territoire européen, « même si Melilla c’est la petite Europe », il attendait alors la « salida », la « sortie » de l’enclave, qui s’incarnait tout d’abord par un document délivré par les autorités locales indiquant son transfert vers la péninsule ibérique.
Dans les premiers moments, cette attente était joyeuse et remplie d’optimisme. Il retrouvait des choses simples : « Qu’est-ce que ça fait du bien de se laver tous les jours ! » « Ici on a le ventre plein et ça fait du bien ! » S’il restait très discret par rapport à son passé ainsi qu’aux motivations qui l’avaient poussé à quitter son pays, Adama disait haut et fort qu’il était « tout près d’une nouvelle vie », « une vie sans violence, dans des conditions correctes ». Attendre et espérer étaient deux faces d’une même temporalité où l’attente était la condition de possibilité de cette nouvelle vie qu’il espérait de l’autre côté de la Méditerranée.
Migrants de Melilla : nouvelle tentative de passage en force
Durée : 00:50
Les semaines passant, l’attente prenait plus de place, elle était plus lourde à supporter. Les lundis et les mardis étaient critiques, angoisse et anxiété dans l’air, patienter devenait trop dur. C’étaient ces jours-là que l’administration du Centro de estancia temporal de inmigrantes (CETI, le centre de séjour temporaire des immigrés) annonçait les noms de celles et ceux qui auraient leur « salida » et quitteraient l’enclave avec le ferry du mercredi soir.
Au moment de l’arrivée dans la péninsule ibérique, les personnes migrantes apprenaient le sort que leur réservaient les autorités : enfermement dans un centre d’internement afin d’organiser leur expulsion vers leur pays d’origine ou prise en charge provisoire par une association quelque part en Espagne.
Après un mois à Melilla, sans argent et sans possibilité de travailler, Adama Touré avait l’impression de vivre une succession de journées interminables. « Ceux qui prient, au moins ils ont quelque chose à faire, moi je ne prie pas, ça fait bien trop longtemps, je ne vais pas m’y mettre maintenant, ça ne serait pas sérieux ! Je ne peux donc pas passer mon temps à la mosquée ! » Bien que sur un ton badin, Adama disait là combien il enviait ses compères pieux, pour qui les journées étaient rythmées par les temps des prières et non plus seulement par le temps creux de l’attente.
Ecouter de la musique, discuter avec les compagnons de fortune, fumer des cigarettes assis à l’ombre, sous un pont proche du CETI, étaient les occupations principales d’Adama Touré pendant sa vie dans l’enclave. Et jouer au foot. Les Maliens l’avaient coopté dans leur équipe puisqu’il n’y avait pas assez de joueurs ivoiriens et parce qu’il était « très bon ». « Un Eléphant devenu Aigle à cause de la situation », m’avait-il dit, un sourire sur les lèvres, en reprenant les symboles des deux équipes nationales, avant d’avouer que dans les tournois organisés sur le mont Gourougou, au Maroc, il faisait déjà partie des Aigles.
« On s’entraînait comme des soldats »
En effet, avant d’être bloqué à Melilla, Adama Touré l’a été au Maroc pendant un an, dont dix mois dans les campements du Gourougou, montagne du Rif située à quelques kilomètres de la barrière. Là où s’organise la vie dans l’attente de la traversée. Parmi les personnes migrantes qui s’y trouvent, nombreuses sont celles qui ont d’abord essayé de passer la frontière par voie maritime, et ce n’est qu’après plusieurs échecs qu’elles se résignent à tenter le saut des grillages.
Comme tous ceux qui essaient de franchir cette frontière, Adama Touré a vite compris que pour tenter sa chance, il fallait se préparer, devenir très agile, pour escalader avec promptitude, courir plus vite, mais aussi endurcir son corps pour mieux résister aux blessures causées par les barbelés, les chutes du haut des clôtures ou la confrontation violente avec les agents de la Gendarmerie royale marocaine et de la Guardia civil espagnole.
Adama s’est alors mis au rythme des camarades qui étaient au Gourougou depuis plus longtemps. Entraînement tous les jours, au même titre que la recherche de nourriture et de fourniture pour « survivre dans la brousse ». Ils marchaient plusieurs heures par jour en portant du bois, des bidons. « On s’entraînait comme des soldats. » Ils grimpaient sur des arbres, se chronométraient pour améliorer leur temps.
« Frapper la barrière » est une affaire collective bien étudiée. Adama m’explique ce que d’autres avant lui m’ont déjà raconté : réussir le franchissement de la frontière nécessite de l’organisation, du courage mais aussi de la rapidité. Sept minutes, c’est le temps maximal qu’ils peuvent accorder à la première étape, celle qui consiste à atteindre la première barrière côté marocain. Trois minutes, le temps maximal pour sauter les trois clôtures et se retrouver en territoire espagnol. Dépassé ce temps, ils seront immanquablement interceptés par les forces de l’ordre (marocaines ou espagnoles).
Adama Touré ne se souvient pas du nombre exact de fois où il a participé à ces tentatives, « dix, douze peut-être ». Mais il garde un souvenir précis du spectre de la mort qui hantait chaque nouvel essai, des blessures physiques qu’il fallait soigner de retour au campement, de la mortification morale d’avoir été chassés « comme des bêtes ». Il se souvient surtout que la fois où il s’est blessé à la jambe, un camarade est décédé.
Renvoi vers l’Espagne
Huit mois après avoir réussi le franchissement des clôtures, Adama Touré a pris le ferry du mercredi, peu avant minuit, avec une vingtaine de personnes qui, comme lui, se reprenaient à rêver de la suite de leur parcours. Depuis Malaga où le bateau a accosté, Adama a été conduit à Getafe, ville proche de Madrid. Il y a été pris en charge par une association pendant six mois, avant de décider qu’il était temps de continuer la route vers le nord. Une bénévole de l’association lui a acheté un billet de train et il est parti. Il n’avait qu’un petit sac avec son téléphone, deux ou trois habits et un peu plus de 200 euros en poche.
La frontière entre l’Espagne et la France, il l’a traversée en taxi, avec deux autres camarades de voyage. Il est ensuite monté dans un car en direction de Paris. Le jour même de son arrivée, il est reparti, toujours en car vers la frontière. Avec trois compagnons, il a partagé un taxi pour faire les derniers kilomètres.
Je ne connais pas les détails de son arrivée en Allemagne. Je sais juste qu’il y a déposé une demande d’asile et qu’il a été conduit dans un centre en Bavière. En raison des accords de Dublin, sa requête est renvoyée vers les autorités compétentes en Espagne, pays par lequel il est entré sur le territoire européen.
Lors d’une conversation par Skype, il me dira : « Si j’avais su tout ça… mais je ne savais pas. C’est d’une grande stupidité. On est pénalisé parce qu’on est noir, parce qu’on est pauvre, parce qu’on nous maltraite physiquement, à la frontière, au Maroc, on nous maltraite psychologiquement aussi, et en plus ils nous maltraitent avec ce Dublin et toutes ces règles qu’on ne comprend pas, qui embrouillent. On va maintenant m’envoyer en arrière, ce n’est pas logique. »
Après avoir quitté sa maison près d’Abidjan en mai 2013, Adama Touré a traversé le Mali, l’Algérie, le Maroc. Il a réussi à franchir la frontière européenne un an et demi plus tard. Après l’Espagne et la France, c’est en Allemagne qu’il a voulu « se poser ». En novembre 2017, il avait perdu tout espoir d’y rester et attendait son renvoi vers l’Espagne pour enfin « trouver un peu de stabilité ». Depuis, son téléphone ne répond plus et son compte Facebook est inactif.
Carolina Kobelinsky est anthropologue, chargée de recherches au CNRS et à l’université Paris-Nanterre.
Cet article a d’abord été publié par le site The Conversation, en collaboration avec le blog de la revue Terrain.