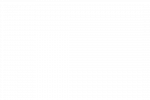Trump exacerbe la mortifère chasse aux boucs émissaires
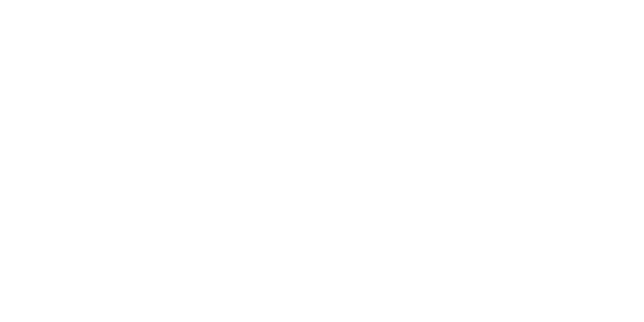
Trump exacerbe la mortifère chasse aux boucs émissaires
Editorial. Si le président américain ne peut bien sûr pas être tenu responsable de l’attentat de Pittsburgh, sa dénonciation permanente de coupables produit de terribles effets collatéraux.
Donald Trump, à Indaniapolis, le 27 octobre. / ALEXANDER DRAGO / REUTERS
Editorial du « Monde ». Le carnage perpétré le 27 octobre dans une synagogue de Pittsburgh (Pennsylvanie) par un antisémite viscéral, qui voit en outre les migrants comme des envahisseurs prêts à « massacrer [son] peuple », est un terrible révélateur pour les Etats-Unis. Il l’est aussi pour Donald Trump. Les tragédies nationales pèsent généralement sur ceux qui ont la charge d’un pays. Elles les enveloppent de leur gravité et de leur peine, au moins pour un temps. Dans les heures qui ont suivi celle de Pennsylvanie, Donald Trump est au contraire apparu tel qu’en lui-même, comme imperméable au drame, empreint de fatalisme.
Face à une telle montée de la violence politique, illustrée quelques jours plus tôt par la découverte de colis piégés visant ses adversaires, la tâche principale d’un président est ordinairement de rassembler. Donald Trump a choisi au contraire de diviser en dénonçant la « presse bidon », une formulation particulièrement vague dont on imagine qu’elle désigne celle qui exerce une liberté inscrite au cœur de la Constitution américaine.
A nouveau, il a accablé cette dernière du plus infâme des qualificatifs, celui d’« ennemi du peuple », pour mieux en faire l’unique responsable d’un climat pesant, moins d’une semaine avant des élections de mi-mandat qu’il veut transformer en référendum sur son nom. Au cours des jours précédents, Donald Trump a joué avec désinvolture avec d’autres mots piégés. « Je suis un nationaliste », avait-il déclaré le 22 octobre lors d’un meeting au Texas, avant de dénoncer quatre jours plus tard les « globalistes », un terme que certains de ses sympathisants accolent délibérément au philanthrope George Soros, milliardaire et de confession juive, le premier à recevoir un colis piégé.
Une ignorance paresseuse de l’histoire
Il ne faut sans doute voir aucun calcul machiavélique dans la manipulation hasardeuse de ces termes que revendiquent les suprémacistes blancs qui défilaient dans les rues de Charlottesville, en Virginie, en août 2017, en dénonçant pour certains les juifs. Elle est plus sûrement le produit d’une ignorance paresseuse de l’histoire, y compris américaine, d’une désinvolture érigée en audace, et d’un goût pour les énormités élevé en vertu. Le président ne peut pas être tenu responsable de ces actes, ne cesse d’assurer sa porte-parole. C’est factuellement exact. Mais Donald Trump est responsable de son pays.
Personne ne peut douter de l’ancienneté de la violence politique aux Etats-Unis. Ses braises n’ont pas attendu le magnat de l’immobilier pour être tisonnées, et régulièrement, de part et d’autre des lignes de front politiques. Les tensions raciales, les inégalités sociales et une transition démographique anxiogène pour une partie de l’ancienne majorité blanche sont de nature à exacerber cette violence. Et à ouvrir une mortifère chasse aux boucs émissaires.
Il se trouve que cette dénonciation permanente de coupables est au cœur du discours de Donald Trump depuis qu’il est officiellement entré en politique. Elle est le moteur d’un président en campagne permanente. Elle produit de terribles effets collatéraux. Car d’autres que le président arment à leur manière les mots qu’il prononce. Et Pittsburgh a montré combien ces mots, trafiqués et tordus, peuvent être dévastateurs.