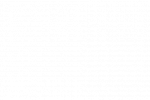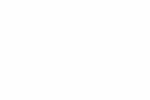En Algérie, partir étudier à l’étranger pour « peser plus lourd sur le marché du travail »

En Algérie, partir étudier à l’étranger pour « peser plus lourd sur le marché du travail »
Par Zahra Chenaoui (Alger, correspondance)
La hausse des frais d’inscription dans l’enseignement supérieur français inquiète les jeunes Algériens. Certains envisagent de postuler dans d’autres pays.
A l’université de Nanterre, en banlieue parisienne. / MARC WATTRELOT / AFP
Dans la médiathèque de l’Institut français d’Alger, ce samedi après-midi, Lina, 15 ans, ne cache pas son désarroi. « C’est vraiment injuste », soupire la lycéenne venue réviser ses cours. Elle est inscrite en 1ère dans un établissement privé qui suit le programme de l’éducation nationale française. « J’ai choisi d’y aller justement pour pouvoir présenter le bac en candidat libre et intégrer l’université française ensuite », explique-t-elle. Sa mère, enseignante à l’université, et son père, ingénieur, ont dépensé 190 000 dinars (environ 1 400 euros) par an pour son inscription dans un collège privé. Ils paient désormais 350 000 dinars l’année pour le lycée.
L’investissement est considérable, dans un pays où le salaire mensuel moyen est de 40 000 dinars et celui d’un enseignant d’université de 60 000 dinars. Alors l’annonce, le 19 novembre, par le premier ministre français, Edouard Philippe, d’une hausse des frais d’inscription pour les étudiants non européens a sidéré nombre de familles. Lina, qui comptait aller étudier en France en 2020, devra désormais payer 2 770 euros par an (le futur tarif en licence), en plus des frais de logement et de la vie quotidienne. « Ce n’est plus du tout certain que je puisse partir », se désole-t-elle. Son amie Tinhinane, 16 ans, dont les deux parents sont ingénieurs, espère un miracle : « Ma mère m’a promis qu’elle ferait de son mieux. On va demander de l’aide à mes oncles et mes tantes. »
18 % de chômage chez les diplômés du supérieur
L’Algérie est l’un des trois pays qui envoient le plus d’étudiants en France, derrière le Maroc et devant la Chine. En 2017-2018, on recensait 30 521 Algériens inscrits dans l’enseignement supérieur français, selon l’agence officielle Campus France. Leur profil type : un élève de master (c’est le cas de la moitié d’entre eux), inscrit à l’université (pour plus de 88 %) dans une filière de sciences ou de Staps (41 %), ou en lettres, sciences humaines et sociales (20 %). Le nombre d’étudiants algériens dans l’Hexagone a augmenté de 10 % depuis 2011.
« Cela va de pair avec l’augmentation du nombre total d’étudiants en Algérie », explique Yasmina Meddi, maître-assistante en géologie. Dans le quartier de Bab Ezzouar, à l’est de la capitale, l’université des sciences et de la technologie Houari-Boumediene (USTHB), où elle travaille, en accueille cette année plus de 42 000. L’enseignante, qui a elle-même bénéficié d’une bourse doctorale pour étudier en Espagne, est régulièrement sollicitée par des élèves qui constituent des dossiers pour la France. « Ceux qui veulent faire de la recherche partent à l’étranger car le niveau y est meilleur, explique-t-elle, mais le premier facteur de départ est ailleurs : les jeunes savent qu’ici ils ne trouveront pas de travail à la sortie de l’université. Mes étudiants de master vendent des vêtements dans les centres commerciaux. Le marché du travail est saturé, les grandes entreprises ne recrutent plus. »
En 2018, l’Algérie comptait 1,7 million d’étudiants, et ils seront 2 millions à la prochaine rentrée. Le taux de chômage global était officiellement de 11,7 % en 2017 mais celui des diplômés du supérieur grimpait à 18 %. Dans ce contexte, chacun essaie de mettre les meilleures chances de son côté. « Partir nous permet de peser plus lourd sur le marché du travail. Si je n’avais pas eu de diplôme français, je n’aurais jamais trouvé de stage dans une agence onusienne en Algérie », raconte Feriel, 30 ans, qui a obtenu un master 2 en gestion de projet de développement à Paris. A l’époque, pour financer ses études, elle travaillait deux jours entiers par semaine et donnait des cours de soutien scolaire. « La majorité des étudiants algériens n’a pas de bourse et doit travailler. Avec cette nouvelle mesure, et la dévaluation du dinar, la France va faire venir l’élite financière, mais ce n’est pas l’élite intellectuelle. Ceux qui auront accès à l’université ne sont pas forcément ceux qui auront les meilleurs résultats », critique-t-elle.
« Je ne veux pas rester ici »
Sur le site Internet de Campus France Algérie, les inscriptions doivent débuter ce lundi 26 novembre. Zaki Kessai, 21 ans, avait commencé à réunir les documents nécessaires pour poursuivre ses études d’administration des affaires en France. Il est inquiet. « Je vais voir si je peux obtenir un prêt étudiant, mais je commence à me renseigner sur les formations dans d’autres pays. La France est attractive parce que nous parlons la langue ; nous sommes donc capables de travailler en parallèle de nos études pour subvenir à nos besoins. » Il évoque la Lettonie et souligne qu’il pourrait aussi tenter de partir au Canada une fois son diplôme obtenu en Algérie. « Je ne veux pas rester ici », résume-t-il.
Alors que l’obtention de visas est de plus en plus difficile pour les Algériens, faire des études à l’étranger devient une voie de mobilité. Dans son rapport sur la fuite des cerveaux au Maghreb, le Centre de recherche appliquée pour le développement (Cread) estime que « les lourdeurs administratives, les blocages bureaucratiques, les difficultés socio-économiques et les limites d’épanouissement culturel motivent le départ de cadres et d’universitaires ». « Quand les étudiants partent jeunes à l’étranger, sans garantie d’emploi en Algérie et sans attache familiale, ils ne rentrent plus », prévient Yasmina Meddi, l’enseignante de l’USTHB. Zaki Kessai résume : « Je sais que c’est mauvais pour le pays, mais je veux penser à ma vie. »