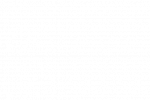Lettre à Issa Koné, tué lors d’un contrôle de police dans la nuit d’Abidjan

Lettre à Issa Koné, tué lors d’un contrôle de police dans la nuit d’Abidjan
Par Jean-Philippe Rémy (Johannesburg, correspondant régional)
Issa Koné a travaillé comme fixeur pour des dizaines de journalistes, du « Monde » mais aussi de RFI et d’autres médias en reportage en Côte d’Ivoire. Avec lui, Jean-Philippe Rémy avait traversé la crise électorale en 2011.
Issa Koné pose à l'entrée de l’Hôtel du Golf, le 8 avril 2011, à Abidjan. / MICHAEL ZUMSTEIN/AGENCE VU
Un barrage. Il a fallu un misérable barrage de policiers dans la nuit d’Abidjan pour avoir raison de ta vie. Toi, Issa. Issa-courage, Issa le tendre, Issa le rieur, le protecteur, invincible Issa qui passait les épreuves et les barrages de toute la Côte d’Ivoire à la seule force du verbe et de l’intelligence, par la seule grâce de la grâce. Ils pouvaient arrêter ta voiture, ils ne pouvaient t’arrêter. Rien ne semblait jamais pouvoir te faire renoncer. Certainement pas les hommes en uniforme qui prétendent assurer la sécurité de tous, dont la tienne.
Combien en avons-nous passé ensemble, de ces prétendus points de contrôle ? C’était en 2011, la crise électorale battait son plein en Côte d’Ivoire. Tout semblait se déliter, dans une accélération que plus personne ne voulait retenir. Cela se voyait au niveau de la rue, en particulier, sur ces barrages qui poussaient çà et là. Avec leurs rituels auxquels il fallait bien se plier. Les « corps habillés » s’y livraient à des « tracasseries », invraisemblables accusations et autres inventions – excès de vitesse invérifiables, essuie-glaces trop usés – dont la seule finalité, bien sûr, était l’extorsion. Encore fallait-il faire semblant de trouver tout cela normal et dire merci à la fin de la pitrerie. Il n’y avait pas plus de sécurité à assurer que de vitesse à surveiller. Mais il fallait jouer ce jeu, remballer sa fatigue, taire son exaspération. Te souviens-tu, Issa, de ces théâtres permanents qu’étaient devenues les rues d’Abidjan ? Il valait mieux en rire. Ce n’était au fond qu’un jeu, un simulacre. Et jusque-là, tu avais raison.
Mais la plaisanterie tournait à l’aigre. On voyait surgir des gens de plus en plus inquiétants. Civils, voyous, miliciens, on ne savait plus. Un jour à Angré, ce même quartier d’Angré où tu as été tué vendredi 14 décembre au soir lors d’un contrôle qui a mal tourné, on s’est fait contrôler par des gens armés de gourdins hérissés de clous, qu’ils balançaient en posant leurs questions. Ils n’ont pas réclamé d’argent. Nous n’avons pas ri en nous éloignant. L’augure était clair. Il était mauvais. La bataille d’Abidjan allait bientôt commencer.
Ton sang-froid était parfait
Au début de 2011, les premiers affrontements avaient eu lieu dans ton quartier, Abobo, que tu aimais avec autant de force que la Côte d’Ivoire. Les membres du « commando invisible », comme on les appelait, faisaient le coup de feu contre les forces loyalistes. Ce n’était pas tout à fait la guerre, mais déjà bien plus qu’une insurrection. Tous les jours, on se battait à Abobo. Mal. Un peu n’importe comment. C’était presque un motif d’espoir. Que tout cela, à la fin, se termine encore comme une mauvaise farce, un peu méchante, un peu lamentable. Les grands drames semblaient avoir lieu ailleurs. Le monde entier avait les yeux fixés sur l’Egypte, la Tunisie, dont les présidents venaient d’être poussés à la fuite, et sur la Libye, où la guerre avait commencé. Nous étions presque seuls à arpenter Abobo, chaque jour, et voir un autre feu s’étendre.
Des journées entières à sillonner les ruelles, presque plus besoin de se parler pour prendre des décisions. Ton sang-froid était parfait. Ton cœur battait. Tes rues, désormais, étaient le théâtre d’affrontements, le sang qui coulait était bien réel, le simulacre n’était plus qu’un souvenir. Eviter les grands axes où des convois du gouvernement passaient en ouvrant le feu aveuglément. Etre les témoins, effarés, de cette course vers l’abîme. Quelque chose, vraiment, ne tournait pas rond.
Te souviens-tu, Issa, quand nous sommes allés à Abobo, un jour, pour vider ta maison en toute hâte avant que les forces armées n’y parviennent et ne la pillent ? Les combats étaient tout proches, il fallait faire vite. Nous avons passé les lignes dans un sens, puis dans l’autre, pour arriver jusqu’à la maison dans la Mercedes, ta fameuse Mercedes. Celle dans laquelle nous avons tout traversé, les barrages, les épreuves, les menaces, le pays en guerre.
Ce jour-là, donc, on a sauvé ce qui pouvait l’être, les pagnes de ton épouse, l’électroménager qu’on pouvait tasser dans le coffre, la télévision, le home cinéma, tout ce vers quoi se ruent les pillards. Une toute petite victoire sur l’adversité. Tu étais un combattant, Issa, comme aucun de ces hommes en armes ne saurait jamais l’être. Un combattant des choses meilleures, de la vie plus large, un combattant pour des mondes prospères, où un homme a de l’avenir s’il a de la volonté et de l’espoir.
Dans la Mercedes, on faisait des crochets pour aller distribuer des produits pharmaceutiques, livrer des chaussures (Sebago Dockside, bien sûr, le classique des classiques d’Abidjan), aller voir si les footballeurs de ton petit centre d’entraînement continuaient de travailler malgré la crise. Un jour ils joueraient peut-être dans de grands clubs. Il ne fallait jamais renoncer, jamais s’avouer vaincu.
Pas besoin de se parler
Mais alors que faisait-on, ensemble, sur ces routes, dans cette crise ? Issa, toi qui avais mille projets, toi l’entrepreneur en série, fallait-il vraiment que tu fasses route commune avec un journaliste au milieu de la crise électorale ? Les risques se faisaient, au fil du temps, plus nets, plus brûlants. Alors tu disais que c’était intéressant, que le sort du pays se déroulait là. Et tu l’aimais, ce pays. Comme tu l’aimais, cette nation en danger, la Côte d’Ivoire. Tu voulais aussi sonder, sans détourner les yeux, la profondeur de ses vieilles blessures infectées. Tout cela était en train d’éclater. Quand il a été question d’aller voir à Yamoussoukro si la ville tomberait, tu as voulu être là. Quand les rebelles sont entrés, tu étais là. Quand nous sommes redescendus pied au plancher vers Abidjan, tu étais au volant de la Mercedes.
C’est un moment que rien ne peut effacer. Où plusieurs choses se mêlent. Nous sommes arrivés là ensemble à cause de l’amitié, du respect, de la soif de comprendre les choses, et puis tout à coup l’histoire s’est emballée. Dans un coin désert, on a échappé à un groupe de miliciens avec des machettes qui nous ont coincés dans un tournant. Ce n’étaient plus les barrages d’Abidjan. On était en pleine campagne. Ils étaient brutaux, sales, ils avaient les yeux rouges, ils nous ont fait sortir de la voiture avec de grandes claques, emmenés quelque part au milieu d’une zone de roseaux, brandissant leur colère et leurs machettes. On a joué la comédie, on était tellement bien rodés dans nos numéros. Cette fois, on a prétendu être en mission secrète, pour leur bord, pour leurs chefs. Et ils y ont cru, nous ont laissé repartir, nous rendant tout de même nos affaires à regret.
A présent, c’est juste après, on roule à la vitesse maximale de la Mercedes, notre bonne vieille copine, sur l’autoroute du nord, pour arriver enfin à Abidjan où va commencer la bataille – mais cela, on l’ignore. Plus âme qui vive sur la route. Juste le bruit du moteur. Puis les détonations. Pas besoin de se parler, ça va mal. Impossible de quitter le ruban d’asphalte. Impossible de s’arrêter. Depuis les immeubles qui bordent l’autoroute à l’entrée de Yopougon, il y a des tireurs embusqués, et c’est sur nous qu’ils ouvrent à présent le feu, cible mouvante et évidente, notre Mercedes poussée à bout de puissance.
Et nous passons au travers, comme un avion descend à travers les nuages, dans l’orage, vers l’aéroport si petit, si loin. On ne s’en rend pas compte, il y a des trous dans la carrosserie de la Mercedes, plus tard je retrouverai une balle fichée, le bout tout tordu, dans mon ordinateur. Ce moment n’en finit pas. L’asphalte semble brûler sous la voiture, on ne peut pas aller plus vite, on voudrait rétrécir. Il ne faut pas trembler, pas un seul instant. Tu ne trembles pas. Il y a un soldat qui saute sur la route, devant nous, nous met en joue, posément, face au pare-brise. On ne ralentit pas, on ne dévie pas. Au dernier moment, il s’écarte, essaye de nous rafaler au passage. Nous rate. Ce con. Pour une fois, on ne dit pas : « ce con ».
Des hommes vont mourir
Après, quand on recommence à respirer, tu me dis que j’ai crié « mon dieu ». Cela t’a paru de bon augure, que je fasse comme ça des progrès en termes de juron, et enfin tu rigoles un bon coup. Nous sommes dans Abidjan. Les passants courent en file dans les rues en levant les bras. Il faut s’arrêter quelque part. Ce sera le parking du Novotel. Un instant, nous nous figurons que c’est la fin de cette histoire. Or c’est tout l’inverse : le pire est devant. Il va se passer, au Novotel où nous sommes bloqués pendant des semaines, puis ailleurs, des choses terribles. Des hommes vont mourir.
Pendant des jours, nous peaufinons des stratégies pour nous enfuir, à pied, la nuit, calculant combien il faudra d’argent pour acheter notre passage aux barrages et gagner le sud de la ville. En réalité, c’est impossible. Nous ne sommes plus qu’une poignée dans ce Novotel, et cela promet de mal se terminer, quand les Nations unies, subitement, offrent de nous emmener dans un véhicule blindé. C’est un petit miracle. Au moment de monter dans la grosse boîte d’acier, tu recules. Tu ne veux pas laisser la Mercedes. Et à la stupéfaction générale, tu vas prendre le volant, avec un casque et un gilet pare-balles qu’un type de l’ONU t’a tendus, sans voix devant ce que tu es en train de tenter : passer, en seigneur, à travers les rues où personne ne passe. C’est ainsi que la Mercedes, malgré ses trous, a survécu elle aussi à la bataille.
Quelques semaines plus tard, nous sortirons indemnes de cette ville meurtrie. La paix est revenue. Elle est bancale. Mais le pire a été évité de justesse. Puis c’est le 31 décembre de cette année 2011, la première Saint-Sylvestre après la bataille. Un feu d’artifice est tiré au-dessus de la lagune à Abidjan. Tu es si heureux. Ta ville resplendit. Quelque chose de toi a triomphé en Côte d’Ivoire. C’est ce quelque chose qu’une bande d’hommes en uniforme a tué, cette nuit de paix, tout récemment, à Abidjan. C’est ce quelque chose dont nous sommes tous, aujourd’hui, orphelins.