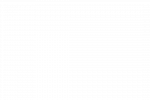Une farce dystopique, un amour à Harlem et « Les Estivants » : une semaine au cinéma

Une farce dystopique, un amour à Harlem et « Les Estivants » : une semaine au cinéma
Chaque mercredi dans « La Matinale », les critiques du « Monde » présentent les meilleurs films à découvrir sur grand écran.
LES CHOIX DE LA MATINALE
Un programme bien éclectique cette semaine avec une comédie de science-fiction fantasque et drôle sur le capitalisme, l’histoire d’un amour cerné par les injustices et le racisme, une championne de culturisme face à la maternité et le portrait d’une famille dysfonctionnelle.
« Sorry to Bother You » : feu d’artifice pop
Sorry to Bother You / Bande-annonce [Au cinéma le 30 janvier]
Durée : 02:28
Qui eût dit que la pensée marxiste nous reviendrait au cinéma par les Etats-Unis, terre pourtant peu hospitalière à ce brandon révolutionnaire. C’est pourtant bien ce qui se produit avec le premier long-métrage de Boots Riley, qui doit autant, précisons-le d’emblée, à Karl qu’à Groucho. Soit une conception du divertissement à l’intelligence tranchante, au sens aigu de l’absurde, mené sans subtilité superflue, pour ne pas dire sciemment à la truelle, droit au but et dans ses bottes. Son auteur, hip-hopeur et activiste afro-américain d’Oakland (Californie), reste ainsi fidèle tant à l’humour au vitriol qu’à la conscience politique qui marquent son parcours musical, inauguré avec l’excellentissime groupe The Coup dans les années 1990.
Le musicien de 47 ans livre donc son premier film sous le signe d’une comédie de science-fiction, dystopie farcesque et radicale qui se paie le luxe de mettre, au pays de l’Oncle Sam, le capitalisme six pieds sous terre. L’acteur Lakeith Stanfield y incarne Cassius Green, jeune galérien afro-américain d’Oakland, qui vit dans le garage de son oncle, et encore à crédit, poursuit une relation entachée d’incertitude avec Detroit, une performeuse politiquement engagée, cherche à se sortir de la mouise par tous les moyens. Jacques Mandelbaum
Film américain de Boots Riley. Avec Lakeith Stanfield, Tessa Thompson, Jermaine Fowler (1 h 51).
« Si Beale Street pouvait parler » : amour absolu, à Harlem
SI BEALE STREET POUVAIT PARLER Bande Annonce (2019) Drame
Durée : 02:35
Le précédent et deuxième long-métrage de Barry Jenkins, Moonlight (Oscar du meilleur film en 2017), avait saisi par sa beauté formelle qui rendait grâce et dignité à l’histoire écrite par le dramaturge Tarell McCraney, sur l’itinéraire d’un Noir homosexuel aux prises avec la solitude, la cruauté et le crack, dans un ghetto de Miami. Le troisième film du cinéaste américain, Si Beale Street pouvait parler, qui s’inspire cette fois du roman de James Baldwin (Stock, 1997), atteint de la même façon par la beauté d’une image dont le grain, la patine et la couleur diffusent immédiatement une sensualité qui touche les sens. Cette esthétique, qui agit comme un fluide, n’a cependant pas pour seule finalité de provoquer les émotions. Elle célèbre aussi le propos d’un roman qui fait triompher l’amour contre les forces visant à le détruire.
Car, dans le Harlem des années 1970, Tish (KiKi Layne) et Fonny (Stephan James), inséparables depuis l’enfance, s’aiment d’un amour absolu. Ils n’ont pas 20 ans, mais sont prêts pour le mariage, les enfants, toute une vie ensemble. L’Amérique de cette époque, elle, ne l’est pas. Fonny est accusé d’avoir violé une Portoricaine qu’il n’a jamais rencontrée. Il est incarcéré. Tish est enceinte. Alors qu’il résiste entre quatre murs, porté par l’espoir de voir naître son enfant, elle entreprend un combat pour innocenter son amoureux et le faire sortir de prison. Véronique Cauhapé
Film américain de Barry Jenkins. Avec Kiki Layne, Stephan James, Regina King (1 h 59).
« Pearl » : sous les muscles, la mère
PEARL - Bande annonce
Durée : 01:38
Sur le pont, immensément long, qui relie le féminin au masculin, une multitude de corps et d’identités habitent le cinéma et le peuplent de nouveaux récits. Avec Pearl, premier long-métrage d’Elsa Amiel, voici les créatures bodybuildées, inclassables montagnes de muscles, torrents de douleurs ployant sous les altères comme Sisyphe poussant ad vitam son rocher. Il y a du monstre, du cyborg, du freak et du fric dans cet étrange milieu sportif où les sponsors font la loi. Née en 1979, fille du mime Jean-Pierre Amiel, la réalisatrice a grandi dans les coulisses des théâtres avant de devenir l’assistante de cinéastes (Raoul Ruiz, Mathieu Amalric, Bertrand Bonello, Noémie Lvovsky…). C’est en découvrant les images du photographe Martin Schoeller, Female Bodybuilders, qu’Elsa Amiel a eu l’idée de Pearl.
Julia a fui sa vie d’épouse et de mère pour se construire un corps, un destin et une nouvelle identité : voici Léa Pearl, Hulk en talons aiguilles ou Barbie à la mâchoire carrée – incarnée par la championne de bodybuilding Julia Föry. Le jour tant attendu de la compétition, tout bascule : Pearl voit débarquer son mari, Ben (Arieh Worthalter), avec son petit garçon qu’elle n’a pas vu depuis quatre ans. Son « ex » est au bout du rouleau – Arieh Worthalter est aussi convaincant en loser qu’il l’était en père idéal dans Girl (2018) de Lukas Dhont.
Pearl se concentre sur les vingt-quatre heures d’une femme confrontée à sa double identité, de championne et de mère. Un film atmosphérique et lynchien, où le grain de la peau en sueur, sous la fonte, est inlassablement exploré, entre champ de ruines et dune irisée. Où les corps fracassés des athlètes tiennent encore sur des attelles... Clarisse Fabre
Film franco-suisse d’Elsa Amiel. Avec Julia Föry, Peter Mullan, Ariel Whorthalter (1 h 20).
« Les Estivants » : chronique d’un été calamiteux
LES ESTIVANTS Bande Annonce VF 2019 HD
Durée : 02:19
Closer et Tchekhov, le jeu des petits potins et la marche à la mort (des êtres, des classes sociales) : Valeria Bruni Tedeschi combine des ingrédients destinés à produire un brouet infâme. Et par quelque miracle, ces Estivants, inspirés-de-faits-réels pour employer le label certifié, s’élèvent au-dessus des considérations mondaines, laissent loin derrière leurs modèles pour devenir une célébration intime de la vie et de la création.
Témoignant d’un grand sens pratique, Valeria Bruni Tedeschi offre la clé du film dès la première séquence. Elle est Anna, cinéaste italienne établie en France, qui, dans une rue du 16e arrondissement, s’apprête à franchir la porte du Centre national du cinéma (CNC) pour soumettre son nouveau projet à la commission de l’avance sur recettes. Elle est encadrée d’un producteur ronchon (Xavier Beauvois) et de son compagnon, un acteur italien, Luca (Riccardo Scamarcio), avec qui elle doit prendre la route des vacances juste après son audition. Mais Luca préfère rester à Paris, et il n’y a pas besoin de beaucoup le cuisiner pour savoir que ce qui le retient, c’est une autre femme.
La suite des Estivants, située dans une villa palatiale de la Côte d’Azur, dévoilera un peu plus de la substance du projet né sous de si tristes auspices ; on y reconnaîtra Un château en Italie, le précédent long-métrage de la réalisatrice. Autant que la chronique d’un été calamiteux dans un cadre paradisiaque, Valeria Bruni Tedeschi met en scène le processus de distillation par lequel la vie se fait fiction. Et comme dans un alambic complexe dont les serpentins s’entrecroisent, on assiste à une double condensation : dans la fiction, le scénario d’un film qui ressemble à Un château en Italie naît dans la douleur ; sur l’écran bien réel auquel vous faites face, se forme une œuvre nouvelle – Les Estivants. Thomas Sotinel
Film français de et avec Valeria Bruni Tedeschi. Avec Valeria Golino, Pierre Arditi, Riccardo Scamarcio, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky (2 h 08).