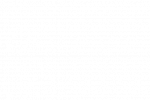En Algérie, la crainte de voir le mouvement échouer est grande
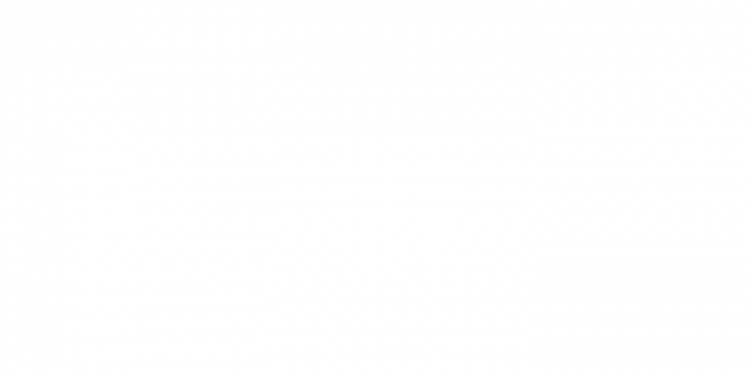
En Algérie, la crainte de voir le mouvement échouer est grande
Par Zahra Chenaoui (Alger, correspondance)
Alors que le mouvement entame son sixième vendredi de mobilisation, les contestataires craignent que leurs aspirations soient instrumentalisées ou mises de côté.
A Alger, mercredi 27 mars. / RAMZI BOUDINA / REUTERS
« Il faut qu’on s’organise. Manifester, ça ne suffit pas. » Adam, 27 ans, a de nouvelles idées chaque jour : il aimerait se lancer dans un tutoriel avec quelques techniques de base pour organiser un débat à diffuser sur les réseaux sociaux et aussi mettre sur pied un comparateur des propositions pour la transition publiées jusqu’à aujourd’hui. Pourtant, cinq semaines après le début des manifestations contre un cinquième mandat du président Bouteflika et pour un changement de régime, ce jeune militant a peur de « rater le coche ». « Le pouvoir est fort. On peut défiler pendant des semaines, mais si on ne structure pas des revendications précises, on n’obtiendra rien du tout », poursuit-il. Le débat fait rage parmi les contestataires : faut-il, ou non, des représentants pour discuter avec les autorités algériennes ?
Sur les réseaux sociaux, des sondages ont été lancés pour savoir qui serait le meilleur représentant. Sur Facebook, une page a recueilli près de 10 000 votes, donnant l’avocat Mustapha Bouchachi et Karim Tabbou, l’ancien leader du Front des forces socialistes (FFS), en tête des préférences des internautes ayant participé. L’avocat, qui avait déjà fait savoir qu’il n’était pas intéressé, a déclaré mercredi soir 27 mars, lors d’une réunion avec des jeunes, qu’il fallait « éviter de choisir des représentants » pour « préserver le mouvement populaire ».
Des organisations de la société civile, rassemblées en une coalition pour « une sortie pacifique de la crise », dont la Ligue algérienne de défense des droits de l’homme, SOS Disparus ou encore le Rassemblement action jeunesse, ont mené une série de consultations politiques au cours de la semaine auprès de responsables de partis, pour présenter la feuille de route qu’ils ont mise sur pied. « Certains pensent qu’il faut une élite pour gérer. Je ne préfère pas. Si on a une base de personnes compétentes qui analysent la Constitution et qui expliquent les lois, ça reste suffisant pour que les gens décident seuls de ce qu’ils vont faire », estime Youcef, artiste.
Lui aussi admet qu’une forme d’inquiétude l’a un temps envahi : « Chaque semaine, il y avait des dizaines ou des centaines de milliers de personnes dehors et je ne voyais pas de répercussion. Mon inquiétude a commencé à disparaître lorsque les autorités ont réagi : plus de 5e mandat, plus de 4e mandat à rallonge. Les gens ont compris qu’ils peuvent avoir de l’influence. »
Inexpérience politique des militants
La « fraîcheur » des manifestants, leur jeunesse, leur inexpérience politique dans un pays où il n’y a pas eu d’alternance : toutes ces caractéristiques sont présentées comme des faiblesses. « Vous prenez les gens pour des idiots, s’emporte Imène, 27 ans. Qui est sorti le premier jour ? Les gens sont conscients de ce qu’il se passe ! » La jeune médecin raconte avoir participé à une réunion où des jeunes Algériens affirmaient que « l’élite » devait « guider le peuple ». « Voilà ce qui m’inquiète : que des gens reproduisent ce que l’Etat a fait pendant vingt ans », explique-t-elle.
Après la manifestation du 22 mars, des simples feuilles de papier avec cette inscription « On a dit pacifique, pas festif » (en référence aux slogans) ont été collées dans plusieurs rues du centre-ville de la capitale. « Manifester, ce n’est pas chanter et danser, non ? » Amina, la trentaine, hésite un peu : « Je ne sais pas trop comment l’expliquer, mais j’ai eu l’impression, depuis le 8 mars, que les gens étaient là pour s’amuser, pas pour faire de la politique. »
L’atmosphère est au questionnement. Et pour cause : l’appréhension de voir le mouvement de protestation échouer est grande. « Pourquoi le chef d’état-major se met à se préoccuper de l’article 102 de la Constitution ? Est-ce qu’il veut s’attirer la sympathie du peuple ? », s’inquiète Abdelghani, la trentaine – par peur de la récupération, souvenir de la décennie de terrorisme des années 1990 qui est arrivée après une période de combats militants et d’ouverture politique, mais aussi exemples plus contemporains de l’Egypte et de la Syrie où la contestation populaire, bien que très importante, s’est transformée en crise. « Au fond de nous, on ne fait pas confiance à ce qu’il se passe, même si on veut y croire. On ne sait toujours pas qui a lancé le 22 février, analyse Abdelhafid, ingénieur. Et puis, c’est nouveau pour nous. Un peu comme quand tu es parent pour la première fois, tu es toujours inquiet. »