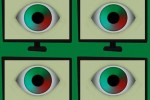Les jeux vidéo peuvent-il sensibiliser à la cause écologique ?

Les jeux vidéo peuvent-il sensibiliser à la cause écologique ?
Par William Audureau, Corentin Lamy
« Final Fantasy VII », réédité en mars sur Switch, rappelle que l’industrie de la manette s’était emparée de la question environnementale dès les années 1990. Mais son traitement a souvent été naïf, cynique ou maladroit.
« La planète meurt, Cloud ! », s’égosille Barret, l’un des compagnons du joueur. La petite troupe de héros s’apprête à faire exploser une usine de la Shinra Electric Power Power, sorte d’équivalent virtuel d’Areva. Un acte écologique fort, qui ouvre Final Fantasy VII, un jeu de rôles réédité le 26 mars sur Switch, initialement sorti sur PlayStation en… 1997.
Le retour de ce monument du jeu vidéo souligne une vérité méconnue : alors qu’on le réduit volontiers à un média consumériste peu politisé, le monde des pixels est traversé de longue date par les questions environnementales. Un point sur lequel insiste Alenda Chang, professeure associée en cinéma et médias à l’université de Santa Barbara (Californie), autrice de Playing Nature (à paraître en 2019) :
« Pour les générations précédentes, les jeux vidéo sont une sous-culture plus qu’une culture, mais nous sommes entrés dans une ère où ils ont dépassé la littérature, le cinéma ou encore la télévision. Or comme n’importe quel objet culturel, les jeux nous donnent des indications sur nos avancées, que ce soit sur le rôle des hommes et des femmes dans la société ou sur la visibilité des problèmes écologiques. »
Deux décennies pour un rapprochement
Le jeu vidéo commercial et l’écologie politique moderne partagent une même date de naissance, 1971. Mais il a fallu deux décennies pour que le premier s’intéresse au second. Le tournant a lieu après la chute du Mur de Berlin. Dans un contexte de fin de guerre froide, la prise de conscience liée à la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, les débats sur la couche d’ozone et les premières conférences internationales sur la planète suscitent une mobilisation générale. « La période entre la fin des années 1980 et le début des années 1990 est un moment analogue à celui que nous traversons », resitue Alexis Vrignon, chercheur associé au Centre de recherches en histoire internationale et Atlantique et auteur de La Naissance de l’écologie politique en France (PUF, 2017).
Mega Drive Longplay [011] Ecco the Dolphin
Durée : 01:19:03
Presque du jour au lendemain, les jeux d’action habituellement très innocents se colorent d’inquiétudes environnementales. Ainsi de Sonic the Hedgehog, en 1991. Son scénario initial reprenait la bonne vieille ficelle de la princesse à sauver. Mais sous l’influence de deux de ses dirigeantes, Diane Fornasier et Michealene Cristini-Risley, le studio Sega of America redirige le scénario vers un thème écologique : la protection des animaux.
Les problématiques vertes traversent à l’époque de nombreuses autres productions : protection des fonds marins dans Ecco the Dolphin (1992), défense des pôles et de la forêt tropicale dans Awesome Possum (1993), chasse aux touristes saccageant la planète dans ToeJam & Earl in Panic on Funkotron (1993), réparation d’une machine à aspirer la pollution dans Boogerman (1994), etc.
Certaines productions font même d’un art inattendu de la subversion. Comme Global Gladiators, un jeu publicitaire de 1993 estampillé du logo Mc Donald’s, qui confronte les héros à des machines polluantes, des mutants de mazouts ou encore des épreuves de tri sélectif. « Green washing » ? Pas vraiment. Ce positionnement vert est l’idée de son concepteur David Perry, déjà auteur du bien nommé Captain Planet, qui le glisse dans le jeu à l’insu du géant du burger, alors englué dans un procès contre des militants écologistes. « Les pontes de Mc Do étaient fous de rage en découvrant Global Gladiators », relate Régis Monterrin, coauteur de plusieurs livres d’histoires du jeu vidéo aux éditions Pix’n Love et Omake Books.
Une vague sans lendemain
La popularité de ces premiers jeux « verts » s’épuise progressivement au milieu de la décennie, avant de quasi disparaître à l’orée du nouveau millénaire. En 2002, Super Mario Sunshine, dans lequel le plombier se mue en nettoyeur de taches évoquant du goudron, est le dernier d’entre eux. Il est considéré à sa sortie comme un jeu trop coloré, trop moralisateur, loin des nouvelles préoccupations des joueurs, devenus adultes et moins réceptifs à des discours écologiques perçus comme infantilisants.
Il est vrai qu’en une douzaine d’années, ces jeux d’action bondissants, légers et consensuels n’ont fait que survoler le problème. « Rétrospectivement, ces titres sont divertissants et leur intérêt pour l’environnement est louable. Mais il faut admettre que leur point de vue sur le développement durable et les politiques environnementales est assez simpliste », regrette Colin Milburn, auteur de Respawn : Gamers, Hackers, and Technogenic Life (Joueurs, hackeurs et vie technogénique, non traduit)
« Quand ces premiers jeux écologiques apparaissent, on est dans l’idée de protéger ou réparer la nature, comme si la pollution venait de l’extérieur. Il y a par ailleurs des méchants pollueurs très identifiés, qu’il suffit de battre pour résoudre le problème. Il n’y a aucune analyse du caractère systémique de la question environnementale », corrobore Alexis Vrignon. Cette dimension-là n’est pourtant pas absente de la production « vidéoludique ». Mais c’est dans un autre registre – la gestion, et sur d’autres types de plates-formes – les ordinateurs personnels, qu’on la retrouve exploitée.
Les jeux de gestion, une approche systémique du problème
« Le niveau de pollution est très haut ! » s’enflamme le docteur Wright, comme si la couleur verte de sa chevelure dressée laissait planer un quelconque doute sur la qualité de l’air. Depuis 1989, le joueur des Sim City doit, pour tenter de satisfaire les administrés de sa ville, surveiller de très près le niveau de pollution de celle-ci.
« Les jeux de Will Wright [son créateur] reflètent son intérêt pour le fonctionnement de systèmes. Il s’est penché de lui-même sur des hypothèses scientifiques populaires à l’époque », rappelle Alenda Chang. Comme l’hypothèse de Gaia – l’idée que la planète soit semblable à un organisme qui s’autorégule.
Cette curiosité traverse alors plusieurs simulations vidéoludiques complexes, comme SimEarth et Balance of Planet (développé à l’occasion de la journée mondiale de la Terre), ou encore la célèbre série Civilization, dans laquelle le choix d’une économie trop productiviste va par exemple renforcer l’effet de serre, rendant presque inutilisables certaines cases de la carte du monde.
Balance of the Planet
« Ce qui est intéressant dans ces jeux, c’est qu’on est sur ordinateur et non sur console : le public est considéré comme plus adulte, plus mature, relève Alexis Vrignon. Mais cette maturité n’implique pas une approche politique ou militante : on s’empare de la pollution de manière presque rigolarde. C’est un élément que l’on intègre dans le jeu, parmi d’autres. »
Elle devient ainsi un allié, dans Starcraft (1998), où les déchets organiques générés par les aliens zergs permettent d’étendre sa base. Dans Civilization : Call to Power (1999), le joueur peut polluer des villes ennemies afin de tenter de les déstabiliser politiquement ou de les détruire. La même année, Alpha Centauri permet une stratégie plus veule encore : provoquer volontairement un effet de serre… qui fera monter le niveau de la mer, et éliminera les civilisations concurrentes installées sur les côtes.
Ce cynisme ne les empêche pas d’être intéressants, souligne Colin Milburn :
« De nombreux titres postapocalyptiques comme la série des Fallout pointent les problèmes environnementaux des mondes endommagés, en même temps que d’autres problèmes politiques et technologiques. Ils montrent ainsi à quel point tout est interconnecté. »
« Fallout » et son point de départ, les vestiges d’une guerre nucléaire, en 1997. / Fallout
L’anti-héroïsme des années 2000
Les années 2000 voient la question du sort de la planète presque complètement disparaître des productions grand public. Si elle subsiste, c’est de manière plus voilée, à travers de nouvelles propositions iconoclastes.
« Katamari Damacy », où le bousier-extraterrestre qui détruit tout en ramassant ce qui passe. / Namco
Dans Katamari Damacy (2004), dans un détournement de la société de surconsommation, le joueur amasse objets et débris en une boule ravageant tout sur son passage. Dans Shadow of the Colossus (2005), pour ressusciter son aimée, un chevalier faustien met à mort des géants faisant corps avec la nature. Ces titres sont rarement considérés comme écologiques, mais pour Colin Milburn, ils sont redoutablement puissants en termes de sensibilisation :
« De manière assez perverse, ils rendent le joueur responsable de la destruction du monde naturel. Ils suggèrent que nous autres, joueurs de jeu vidéo, sommes partie prenante du problème environnemental – comme n’importe qui d’autre. Ces jeux ne s’appuient pas sur des clichés comme le fait de sauver le monde par des actions héroïques, à la place, ils montrent que nos décisions peuvent mener à la dévastation et à la ruine. »
Omerta et contre-discours dans l’industrie
Les géants du secteur comme Sony sont toutefois très réticents à mettre en avant ce niveau de lecture. Il faut dire que sa gamme de consoles PlayStation a donné son nom au conflit meurtrier qui se joue en République démocratique du Congo autour de l’accès aux mines d’or, de coltan, de cobalt ou encore de tantalum, nécessaires à leur construction comme à celle de nombreux produits de haute technologie.
« Clim’ City » (2008), un SimCity écologique. / CCSTI Aquitaine
Alors, c’est une nouvelle branche du jeu vidéo, le serious gaming, qui assume le rôle de pédagogie. Produits par des ONG, des institutions publiques, des studios militants ou encore des entreprises engagées, Energyville (2008), Clim’City (2008) ou encore Power Planets (2011). tentent de sensibiliser à l’économie d’énergie et à la gestion urbaine « verte » quand les industriels du jeu vidéo s’en sont détournés.
Certains versaient dans le « green washing », comme Planet Green Game, financé par Starbucks, enseigne prompte à communiquer sur son sens des responsabilités mais accusée par l’ONG Stand. earth de faire abattre un million d’arbres par année pour produire ses gobelets non recyclables. A l’inverse, d’autres se sont emparés des non-dits du secteur, comme le mémorable Phone Story (2011) : l’un des mini-jeux consiste à faire extraire du coltan, un minerai utilisé dans la fabrication de smartphones, par des enfants d’un pays sous-développé. Critique au vitriol d’Apple, il n’est plus disponible sur l’AppStore.
Phone Story : An iPhone educational game. Now banned from the AppStore
Durée : 05:35
« Ces jeux ont reflété l’inquiétude grandissante pour le développement durable – même si leurs intentions étaient peut-être un peu trop didactiques », nuance Colin Milburn. Pas assez ludiques, ils sont souvent passés inaperçus.
Un rapport ambivalent à la nature
Depuis le milieu des années 2010, à la faveur de la prise de conscience de la réalité du réchauffement climatique, des développeurs indépendants ont finalement repris le flambeau.
Paradoxe d’un chef-d’oeuvre immersif comme « Subnautica » : il met en valeur les fonds marins et leur écosystème, mais oblige le joueur à se comporter en pilleur pour survivre. / Unknown Worlds
Mais le rapport du jeu vidéo à l’environnement demeure ambigu. Dans la plupart des productions populaires mettant le joueur en prise avec la nature, il s’agit avant tout de survivre, que ce soit dans Dont’s Starve (2013), No Man’s Sky (2016) ou Subnautica (2018). L’appropriation des ressources demeure alors l’unique manière de prolonger sa partie, même si elles sont rares, regrette Alexis Vrignon.
« C’est le cliché américain classique de l’homme authentique qui se forme auprès de la nature brute, la wildness. Les jeux de survie s’inscrivent dans cette tendance : le joueur doit aimer cette nature, s’extasier, mais aussi se méfier de ses dangers, et sinon la dominer, du moins en tirer profit. On est autant dans un rapport de coopération que d’antagonisme. Mais peut-être est-ce le seul possible… »
« Green games »
Ces dernières années, d’authentiques « green games », comme les surnomment déjà certains chercheurs américains, sont néanmoins apparus, toujours sur la scène indépendante. Ils explorent les relations de l’homme à la planète dans Fate of the World (2011), Little Inferno (2012), Mountain (2014), et surtout le plus cité d’entre eux, Eco (2018), un jeu de construction écolo.
Certains proposent des interactions à la fois originales, ludiques et pédagogiques. A l’image de Factorio (2014), jeu indépendant dans lequel le niveau de pollution est indexé la vitesse d’apparition des ennemis. Le message écologiste est d’une efficacité redoutable : en polluant, l’homme choisit lui-même de relever la difficulté. Dans Oxygen Not Included (2017), la question de la pureté de l’air est également cruciale : à la tête d’une colonie humaine ayant trouvé refuge à l’intérieur d’un corps astral à la dérive, le joueur doit veiller à ne pas laisser étouffer son petit peuple sous le poids de sa propre production de CO2.
« Eco » (2018) promeut une approche écologique du rapport entre le joueur et la nature. / Strange Loop Games
« Un certain nombre de développeurs continue d’imaginer des manières de véhiculer des idées vertes via le jeu vidéo, décrypte Colin Milburn. Et même si les produits électroniques font grandement partie de notre pétroculture aujourd’hui, ce qui n’est pas soutenable, certains jeux reconnaissent cette ironie et essaient de défendre quelque chose de meilleur, nous encourageant à penser que le changement est possible. »
Le jeu vidéo s’avère un loisir à l’impact lourd. D’après une étude du Journal of Industrial Ecology datant de 2014, le bilan carbone de la vente de jeu vidéo est catastrophique : chaque exemplaire écoulé générait l’équivalent de 21 à 27,5 kg de CO2. L’industrie aurait généré, en 2013, huit millions de kilos de plastique.