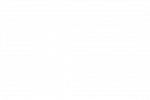« En poste dans l’humanitaire, j’avais perdu le sens de mon travail »
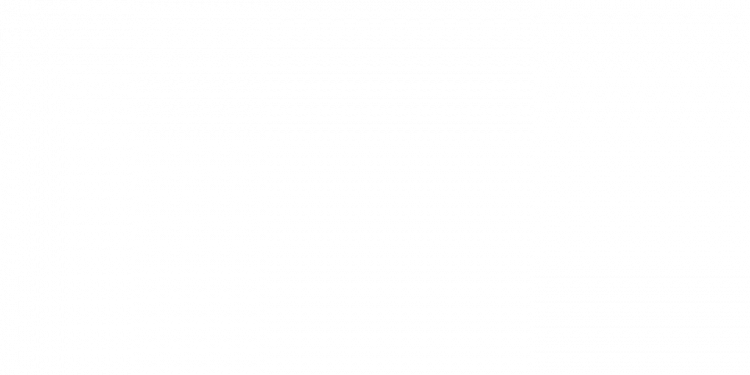
« En poste dans l’humanitaire, j’avais perdu le sens de mon travail »
Après un master en relations internationales, Sarah a travaillé cinq ans dans l’humanitaire, dans une ONG puis dans une société de conseil. Avant de démissionner, amère, et de chercher une nouvelle voie.
Voix d’orientation. Le Monde Campus et La ZEP, média jeune et participatif, s’associent pour faire témoigner lycéens et étudiants sur leurs parcours d’orientation. Aujourd’hui, Sarah, 28 ans. Elle a quitté le monde de l’humanitaire après une expérience où elle a perdu le sens de son engagement.
« 11 décembre 2018, 9 h 21 : je clique, et voilà, e-mail envoyé. Je viens de démissionner de mon job dans l’humanitaire. Alors que j’en avais tant rêvé ! Le problème, c’est que travailler dans l’humanitaire de cette façon, cela n’a pour moi plus grand-chose d’humain. J’y ai travaillé pendant presque cinq ans. Petite expérience, mais assez pour que je perde le sens d’un boulot pourtant censé en avoir tant.
A 21 ans, quand il a fallu choisir un master – après une licence et un service civique –, je me suis demandé le sens de mon futur travail. Critères incontournables à mon choix : son impact social et sa capacité à changer la vie de personnes vulnérables. L’humanitaire m’est apparu comme une évidence. Je fantasmais ce domaine : partir à l’aventure, me dépasser, être sur le terrain, sauver des vies… Master en relations internationales, spécialisation conflits et développement en poche, je pars faire un stage de fin d’études en Turquie, dans une ONG où je bosse sur des projets liés à la crise syrienne. Il y était question de sécurité alimentaire et de protection des réfugiés dans un contexte urbain. Le stage de six mois est devenu une expérience de quatre ans : missions de terrain, spécialisation en suivi et évaluation, promotion rapide à des postes à responsabilité, puis retour en France en tant que spécialiste dans une entreprise privée de consultance dans l’humanitaire.
Au moment où j’écris, je prends la mesure du décalage entre mes idéaux d’il y a cinq ans et la réalité de mon expérience. Certes, tout n’est pas à jeter et je ne remets pas en question toute l’action des ONG. Beaucoup font un travail remarquable et nécessaire. Mais dans mon monde humanitaire à moi, on se retrouve confrontés à la perte de sens : course à la promotion, ambitions démesurées, compétition entre les gens, harcèlement, heures de travail interminables, pression…
Il y avait presque un culte du surmenage : compétition officieuse entre celui qui restera le plus longtemps, prendra le moins de pauses et dira qu’il est “overbooké”. Autour de moi, on admirait certaines personnes “brillantes” ou “fantastiques”, juste parce qu’elles avaient accumulé les postes à responsabilités dans les plus grandes organisations, où elles avaient passé plus de temps derrière un ordi que sur le terrain. Bien évidemment, je les admirais aussi et ne remettais rien en question : notre travail sauvait le monde et j’y contribuais certainement. Point barre. Déconnexion ultime.
Burn-out
Sans m’en rendre compte, je me suis retrouvée à vouloir plus de responsabilités, toujours plus de réussite, comme beaucoup d’autres de mes collègues. Je voulais faire une grande carrière internationale, aux Nations unies. Par ambition, j’étais prête à accepter n’importe quoi. J’ai travaillé des semaines entières jusqu’à 3 heures du matin, week-ends inclus. Je voulais être promue manager et ça a marché : je suis devenue la plus jeune manageuse de l’ONG, alors que je n’en avais pas les épaules. Cela m’a conduite au burn-out deux mois plus tard.
L’observation de certaines dérives m’a achevée : des réunions des Nations unies dans de beaux hôtels cinq étoiles, des heures à débattre de grands principes, à faire des réunions de coordination inutiles, ou à participer à des formations déjà reçues bon nombre de fois. Pis, j’ai eu parfois la sensation de faire face à une posture dominatrice de certaines organisations.
Voici cette grande ONG internationale débarquer dans un pays “sous-développé”, ne mettre que des expatriés à des postes à responsabilité, leur offrir un salaire et des avantages déconnectés de la réalité locale et du staff national… Et imposer sa manière de faire sans s’adapter au contexte. L’exemple le plus frappant remonte à janvier 2016 : je représentais mon ONG dans une réunion pour préparer la réponse à la crise syrienne, dans un pays annexe. Je ne sais pas ce qui m’a le plus choquée : les “goodies” à foison sur les tables ? L’absence de Syriens parmi les nombreux Européens et Américains qui s’y trouvaient ? La vacuité des discussions et l’absence de mesures concrètes prises à la fin de cette journée ? Ou encore l’attitude hautaine de certaines personnes aux postes à responsabilité ? Ce n’était qu’un premier aperçu des réunions récurrentes de coordination, ou de stratégies très coûteuses et sans impact concret.
Un modèle de réussite bien établi
Un burn-out, des discussions avec des collègues, des lectures, et l’arrière-goût dérangeant de ces situations qui s’accumulent : la prise de conscience a été un processus de plusieurs mois. Je suis devenue critique de la notion de développement, qui implique que des pays, organisations ou riches individus, aillent en développer d’autres. Comme s’ils ne pouvaient pas le faire par eux-mêmes ! Critique des gros projets humanitaires coûteux, aux impacts limités. Critique d’un système qui ressemble parfois à une grosse machine, avec une hiérarchie bien établie, des salaires exorbitants et ce fameux culte du surmenage. Le plus dur, mais le plus intéressant aussi, a été de réaliser que j’essayais de coller à un modèle de réussite bien établi et que je ne faisais plus de l’humanitaire pour les bonnes raisons.
Je ne critique pas l’idée de fond derrière l’humanitaire ; je remets en cause certaines dynamiques nuisibles. Tout cela m’a laissée avec du vide et une question angoissante : si pour moi l’humanitaire a perdu son sens, où est-ce que je vais en trouver ? Comment faire quelque chose qui aide vraiment les gens, dans un environnement respectueux et bienveillant, sans repartir dans une course ambitieuse et déshumanisante ? Je n’y ai pas encore répondu, mais j’explore des pistes. J’aimerais monter un projet local, hors du système international. En octobre 2018, j’ai rejoint la communauté MakeSense des Paumé·e·s. Cela m’a permis de réaliser que je n’étais pas la seule à remettre en question ma vie professionnelle. »
La zone d’expression prioritaire (ZEP) accompagne la prise de parole des 15-25 ans
La zone d’expression prioritaire (ZEP) est un dispositif d’accompagnement à l’expression des jeunes de 15 à 25 ans par des journalistes professionnels. Par l’intermédiaire d’ateliers d’écriture dans des lycées, universités, associations étudiantes ou encore dans des structures d’insertion, ils témoignent de leur quotidien et de l’actualité qui les concernent.
Tous leurs récits sont à retrouver sur Le Monde Campus et sur la-zep.fr.
La zone d’expression prioritaire (ZEP) est un dispositif d’accompagnement à l’expression des jeunes de 15 à 25 ans par des journalistes professionnels. / ZEP