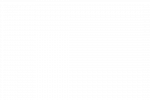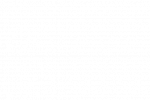Au Cameroun, l’appel de paix du cardinal Christian Tumi

Au Cameroun, l’appel de paix du cardinal Christian Tumi
Par Josiane Kouagheu (Douala, correspondance)
Le conflit au Cameroun anglophone (2/5). Pour l’homme d’église, seul un dialogue inclusif associant les indépendantistes pourra résoudre la crise qui dure depuis trois ans.
Portrait non daté du cardinal Christian Tumi, à Douala, au Cameroun. / AFP
Depuis le début de la crise au Cameroun anglophone, le cardinal Christian Tumi dort peu. « Trois ans, c’est beaucoup », s’attriste-t-il, assis derrière son bureau situé dans l’enceinte de la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Douala. Lorsque la crise éclate, en octobre 2016, sur des revendications portées par des avocats et des enseignants, il a « conscience » que le sentiment de marginalisation des anglophones au Cameroun dure depuis « trop longtemps ». Un an plus tard, les tensions se transforment en une guerre civile qui ne dit pas son nom dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les milices indépendantistes d’un côté, les forces de défense et de sécurité camerounaises de l’autre.
Né en 1930 dans le village de Kikaikelaki, l’un des points chauds de la crise, dans la région du Nord-Ouest, Christian Tumi est une figure dont la voix porte au-delà des églises. L’homme, ordonné prêtre en 1966, a connu les deux présidents du Cameroun : Ahmadou Ahidjo (1960-1982) et Paul Biya, au pouvoir depuis trente-sept ans. Il a vécu tous les moments historiques du pays : l’indépendance en 1960, la naissance de la République fédérale du Cameroun après la réunification du Southern Cameroon britannique et du Cameroun français le 1er octobre 1961, la fin de l’Etat fédéral et la création de la République unie du Cameroun le 20 mai 1972, à la suite d’un référendum.
Selon lui, « l’infidélité à l’histoire » est l’une des principales causes de la crise actuelle. « En 1972, j’ai voté pour le fédéralisme. Je suis fédéraliste depuis toujours, c’est ma conviction, dit-il. Le référendum aurait dû se tenir uniquement dans les régions anglophones, pas sur l’ensemble du Cameroun. Cela a faussé les résultats. Si les autorités avaient respecté ce système fédéraliste, on n’en serait pas là. »
Plus de 1 850 morts
Dès les premières manifestations, en 2016, une partie des anglophones réclament le retour au fédéralisme. Leurs leaders dits « modérés », à l’instar de l’avocat Félix Agbor Nkongho, président du Cameroon Anglophone Civil Society Consortium, seront arrêtés le 17 janvier 2017 et emprisonnés pendant près de huit mois. Ce qui ouvrira la voie aux indépendantistes qui combattent désormais les forces de défense et de sécurité de « la République », comme ils la nomment.
Plus de 1 850 personnes ont été tuées en vingt mois de conflit, d’après l’ONG International Crisis Group (ICG). Des morts de trop, pour le cardinal, qui, dès 2018, a pris l’initiative d’organiser une Conférence générale anglophone (CGA) en réunissant autour de lui d’autres leaders religieux afin de trouver une solution rapide à la crise. Mais l’idée a été mal accueillie par le pouvoir, qui a longtemps nié l’existence d’un problème anglophone et voit d’un très mauvais œil le fédéralisme assumé du prélat. Certains vont jusqu’à le taxer de séparatiste, « voire de terroriste », s’étrangle Elie Smith, le coordonnateur et porte-parole de la CGA.
D’après l’institut américain Pew Research Center, le Cameroun comptait 38,3 % de catholiques en 2010, contre 31,4 % de protestants et 18,3 % de musulmans. Cette forte communauté catholique a toujours suscité des craintes au sein du pouvoir. L’Eglise est elle-même divisée. Certains évêques sont proches des thèses du gouvernement, d’autres sont très critiques. Le cardinal Christian Tumi, sûrement la voix la plus forte du clergé, a toujours dénoncé les abus du pouvoir, les injustices, les violations des droits humains. Menacé de mort, objet de campagnes de dénigrement, il n’a jamais renoncé.
Pis, il a à plusieurs reprises encouragé Paul Biya à quitter le pouvoir. Ces positions ont fait de lui l’un des ennemis du régime. Prévue en novembre 2018, la CGA n’a d’ailleurs pas pu se tenir, faute d’autorisation officielle. D’après plusieurs observateurs, ce refus cache en réalité une lutte acharnée au sommet de l’Etat pour la succession de Paul Biya. « Au sein du pouvoir, ils se disent que si on laisse le cardinal Tumi organiser cette conférence, elle va se transformer en tribunal du régime. Ce qui fera que beaucoup de prétendants au pouvoir n’auront pas ou plus de crédibilité », souligne Elie Smith.
« Il faut agir vite »
Selon un universitaire membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC, au pouvoir), plus la crise perdure, plus elle affaiblit Paul Biya, 86 ans, vu comme « celui qui a laissé la situation pourrir ». « Il est déjà fatigué par l’âge. Il ne faut pas se le cacher, ses ministres et collaborateurs affûtent leurs armes. Celui qui parviendra à résoudre la crise, à mon avis la plus grave depuis l’indépendance, sera vu au sein de l’opinion comme un présidentiable, analyse-t-il. Laisser faire le cardinal, un homme proche des pauvres qui a toujours dit ce qu’il pensait du pouvoir, mettra le gouvernement dans une mauvaise posture : le cardinal sera vu comme le sauveur. Ce n’est bon ni pour Paul Biya, ni pour ses futurs successeurs. »
A 88 ans, Christian Tumi rétorque qu’il n’a « aucune ambition » autre que de « ramener la paix dans les régions anglophones et dans tout le Cameroun », mais qu’« il faut agir vite ». Début mai, le gouvernement a pour la première fois évoqué la tenue d’un dialogue. Le premier ministre, Joseph Dion Ngute, en visite dans les deux régions en crise, a assuré que « le président de la République [était] prêt à organiser un dialogue formel pour résoudre la crise ». Si le cardinal a accueilli favorablement cette main tendue, il estime cependant que « tout le monde doit être autour de la table et tous les sujets discutés. Comment discuter sans entendre ceux qui combattent et veulent quelque chose ? »
Pour le chercheur Hans De Marie Heungoup, de l’ICG, seuls un dialogue offrant de vraies réformes institutionnelles (fédéralisme ou régionalisme poussé) et la libération des détenus anglophones et des opposants politiques emprisonnés après la présidentielle d’octobre permettraient d’apaiser la scène camerounaise. « Si le président Biya est réellement prêt au dialogue inclusif, il devrait s’exprimer publiquement sur la question, désigner les médiateurs, esquisser un calendrier provisoire et autoriser formellement la CGA », poursuit-il. Deux mois après l’annonce du premier ministre, aucune initiative de ce genre n’a été prise.
Une dizaine de groupes séparatistes se sont dits prêts à dialoguer mais ont imposé certaines conditions, parmi lesquelles la libération de tous les prisonniers anglophones, dont Sisiku Ayuk Tabe, leur président autoproclamé, arrêté au Nigeria et extradé au Cameroun.
Le 27 juin, la Suisse a officiellement annoncé avoir accepté le rôle de médiatrice dans le but de trouver « une solution pacifique et durable » à la crise. Une initiative saluée par l’ONU, l’Union européenne, l’Union africaine et les Etats-Unis. Contacté par Le Monde Afrique, le ministère camerounais de la communication a expliqué que le gouvernement avait « son propre conducteur de communication », tout en précisant que « le dialogue inclusif » était en cours de préparation.
« Le pardon est possible »
Cependant, de nombreux analystes craignent que les leaders que choisiront les différents camps pour le dialogue n’aient aucune influence sur les combattants. « Attention aux leaders séparatistes Gucci [de luxe] qui vivent ailleurs et ignorent les réalités du terrain », prévient Elie Smith. Sur le terrain, justement, les groupes armés s’émancipent de plus en plus des membres de la diaspora qui les finançaient. Les kidnappings contre rançon leur apportent leurs propres revenus et « ils ne comptent plus substantiellement sur les fonds de la diaspora », confirme Hans De Marie Heungoup.
« Plus on met du temps, plus la situation empire », s’inquiète le cardinal, qui le répète aux diplomates qui le consultent régulièrement au sujet de cette crise. L’ancien archevêque émérite de Douala a tenté de rencontrer Paul Biya pour lui expliquer « la situation réelle et lui demander d’aller parler à ses enfants sur le terrain avant qu’il ne soit trop tard ». En vain. Alors, avec des membres de la CGA, il a envoyé des questionnaires aux anglophones vivant au Cameroun et à ceux établis à l’étranger (Etats-Unis, Royaume-Uni, Nigeria, Afrique du Sud…).
Dans les plus de 1 000 questionnaires déjà reçus, trois causes à la crise reviennent régulièrement. « D’abord, l’infidélité à la Constitution de 1961 garantissant la forme de l’Etat, donc le fédéralisme. Ensuite, l’infidélité, encore, à la Constitution de 1996, qui garantissait l’élection d’un gouvernement régional par le peuple. Enfin, la francophonisation des anglophones », résume Christian Tumi en désignant une chemise cartonnée sur son bureau.
Si certains anglophones prônent la séparation absolue, le prélat veut encore croire aux vertus du dialogue. Il suffit de « sincérité » et d’« humilité », dit-il. « Il y a des rancœurs, la haine attisée. Mais le pardon est possible. Même après les deux guerres mondiales, on l’a fait. Vous avez vu ce que les Allemands ont fait aux juifs ? On peut pardonner. Oublier, c’est autre chose. » Il compte remettre prochainement ces avis, compilés dans un dossier, au président de la République.
Le conflit au Cameroun anglophone : une série en cinq épisodes
Au Cameroun, depuis bientôt deux ans, une guerre a éclaté loin des regards extérieurs. Tenues à l’écart des médias, les deux régions anglophones du Nord-Ouest et Sud-Ouest ont basculé dans un conflit d’où n’émergent sur les réseaux sociaux que quelques rares et horribles images d’exactions. Entre les groupes armés qui combattent pour l’indépendance de ces deux régions et les forces armées camerounaises, les civils paient le prix fort. D’après les Nations unies, 4 millions de personnes sont affectées par le conflit. Plus d’un demi-million de personnes ont été déplacées, près de 2 000 tuées. Les enlèvements sont devenus un commerce en pleine expansion alors que l’économie de la région s’effondre. Notre reporter Josiane Kouagheu est allée donner la parole aux acteurs et aux victimes de ce drame.