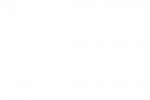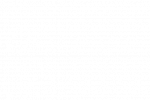« My Wonder Women » : Wonder Woman a deux mamans et un papa

« My Wonder Women » : Wonder Woman a deux mamans et un papa
Par Thomas Sotinel
Angela Robinson filme la genèse de l’héroïne de comics, entre comédie de spéculation et désir de transgression.
Quels que soient les défauts de My Wonder Women, le film d’Angela Robinson a le mérite d’offrir une conversation inédite, qui rassemblerait les féministes et les geeks, deux communautés qui ne s’adressent pas souvent la parole. En exhumant, sur les traces de la journaliste Jill Lepore qui y a consacré un ouvrage, la genèse de Wonder Woman, l’héroïne de bande dessinée qui vient de connaître un succès planétaire grâce à Patty Jenkins, Gal Gadot et la maison Warner, Angela Robinson, qui est également l’auteure du scénario, explique aux premières que les comics furent le vecteur d’une propagande clandestine en faveur de l’égalité des genres, et aux seconds que leur art favori n’est pas forcément destiné à la célébration de la virilité triomphante.
Dans cette version de l’histoire de Wonder Woman, la superhéroïne naît non pas d’un père et d’une mère, mais des tribulations d’un trio amoureux, qui s’est formé sur un campus du nord-est des Etats-Unis, au temps du New Deal. Là, le professeur William Marston (Luke Evans) et son épouse et collaboratrice Elizabeth Holloway (Rebecca Hall) embauchent une étudiante, Olive Byrne (Bella Heathcote) pour les aider dans leurs recherches, consacrées, pour l’essentiel à l’élaboration d’un détecteur de mensonge.
Les premières séquences de My Wonder Women atteignent un équilibre exquis, entre la comédie et la spéculation historique et philosophique. Le professeur Marston est un homme qui exerce son charme à bon escient sur ses ouailles (l’action est située à Radcliffe, établissement pour jeunes filles, jumelé avec Harvard, c’est l’une des nombreuses libertés que le scénario prend avec les faits, Marston enseignait dans un établissement bien moins prestigieux).
Scènes gentiment érotiques
Olive Byrne est d’abord séduite par l’universitaire, puis mortifiée lorsque l’épouse de ce dernier lui demande de promettre qu’elle ne « baisera pas son mari ». Dans le rôle d’Elizabeth Marston Holloway, Rebecca Hall fait un dragon très attrayant, dont on sent bien que l’agressivité n’est pas mue par la jalousie, mais par des pulsions plus positives. Elizabeth est tombée amoureuse d’Olive, et réciproquement. Quant à William, il ne demande qu’à répartir équitablement ses inépuisables provisions de désir et d’affection. Olive, dont la blondeur pourrait faire croire à l’innocence, révèle à ses amants qu’elle est la nièce de Margaret Sanger, mère fondatrice du féminisme moderne aux Etats-Unis (ce fait-là est exact).
Les efforts du trio pour parvenir à un modus vivendi donnent lieu à une succession de scènes gentiment érotiques, à des heurts avec les autorités, progrès et revers qui sont généralement traités sur un ton presque badin, auquel contribuent les acteurs, qui semblent s’amuser comme rarement. Mais on est à la fin des années 1930 et le manque de discrétion du trio lui vaut d’être expulsé de l’éden universitaire. Etablis dans une banlieue new-yorkaise, l’étudiante, la chercheuse et le professeur y fondent une famille (chacune des femmes donne naissance à deux enfants) dont la structure est dissimulée au voisinage par un voile de pieux mensonges. Dans le même temps, le trio découvre les joies du bondage et du sadomasochisme (et c’est en mettant en scène cette initiation que la douceur extrême qui règne sur My Wonder Women atteint ses limites) Pour arrondir des fins de mois bien difficiles, William Marston propose ses services à un éditeur de comics, qui accepte d’éditer les aventures de Wonder Woman.
Les yeux des spectateurs de 2018 se dessillent alors, aidés par un montage très pédagogique : tout ce qui fait la singularité de l’héroïne – le mystère de son identité, sa propension à se faire ligoter, les propriétés divinatoires de son lasso – trouve son explication dans l’épopée amoureuse à laquelle son créateur a pris part. Le film prend alors un tournant plus sombre : on est arrivé à l’immédiat après-guerre et les comics qui ont diverti les GI et les femmes américaines qui ont pris leur place dans les usines ont mauvaise presse. Anticipant un peu la vraie répression qui s’est abattue sur la bande dessinée (elle a pris toute son ampleur en 1954), le scénario montre William Marston comme une victime par anticipation (il est mort en 1947) de la réaction des années Eisenhower.
Ce ne sont pas tant les libertés que prend My Wonder Women avec la chronologie, ou le rapport des forces en présence qui entravent les efforts d’Angela Robinson pour approcher la vérité de ces trois êtres hors du commun. C’est plutôt son parti pris de réaliser un film normal sur la transgression. On devine bien l’envie d’attirer un public non averti vers les sexualités alternatives, à la manière de Marston glissant son discours féministe et érotique dans les cases de Wonder Woman. Mais on ne peut s’empêcher de penser que cette anomalie séduisante appelait un film hors normes.
Bande-Annonce MY WONDER WOMEN (VOST)
Durée : 02:02
Film américain d’Angela Robinson. Avec Luke Evans, Rebecca Hall, Bella Heathcote (1 h 48). Sur le Web : www.facebook.com/marstonmovie et professorm.movie