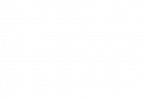Beat generation, récit biographique du « Picasso allemand », roman choral… la sélection du « Monde des livres »

Beat generation, récit biographique du « Picasso allemand », roman choral… la sélection du « Monde des livres »
LE MONDE DES LIVRES
Chaque jeudi dans La Matinale, la rédaction du « Monde des livres » choisit pour vous romans, nouvelles ou récit.
Cette semaine, « Le Monde des livres » vous recommande le roman posthume d’un grand écrivain américain trop méconnu, un récit biographique sur une peintre allemande de la Belle Epoque, un fin recueil de nouvelles, un roman portugais noir et désabusé et un autre, suédois, hilarant celui-là.
ROMAN. « Un dernier verre au bar sans nom », de Don Carpenter
Ce qui domine, sitôt le livre reposé, c’est son écriture simple, sobre, déliée. Un dernier verre au bar sans nom est un livre sur les écrivains, rempli d’écrivains parlant de leurs problèmes d’écrivains : sans doute fallait-il atteindre cette forme d’épure pour faire entendre la voix de chacun. Le manuscrit n’était pas fini quand Don Carpenter a mis fin à ses jours, en 1995. Il aura fallu attendre vingt ans pour le voir sortir en librairie dans une version « achevée » par Jonathan Lethem. Situé à Portland et à San Francisco dans les années 1950 à 1970, l’ouvrage brosse le destin de jeunes romanciers dans les affres de la création et attirés par les sirènes d’Hollywood. Habitués à se retrouver dans des « bars à poètes » – que fréquente également la fine fleur de la Beat generation –, chacun témoigne d’une relation particulière à l’écriture, comme si Carpenter avait voulu exposer les raisons multiples qui l’ont conduit à écrire. Une frénésie contagieuse déferle sur la Californie. A chacun de se saisir sa chance. Ou pas. Frédéric Potet
Un dernier verre au bar sans nom (Fridays at Enrico’s), de Don Carpenter, édité par Jonathan Lethem, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Céline Leroy, Cambourakis, 390 p., 24 €.
RÉCIT. « Etre ici est une splendeur », de Marie Darrieussecq
Le journal de Paula Modersohn-Becker (1876-1907) témoigne d’une obsession : « devenir quelqu’un ». Cette femme inconnue jusqu’ici en France, mais tenue outre-Rhin pour « le Picasso allemand », s’y sera employée en vouant sa vie à la peinture, réalisant, au plus fort de sa productivité, une toile tous les quatre jours. « Elle peint, vite, comme un éclat », écrit Marie Darrieussecq dans Etre ici est une splendeur, le récit biographique qu’elle consacre à l’artiste, lui-même constitué d’éclats. Au fil de courts paragraphes, l’écrivaine retrace cette vie intense, s’appuyant sur le journal de Paula Modersohn-Becker autant que sur sa correspondance – notamment avec son ami Rainer Maria Rilke, qui écrivit pour elle une partie de son Requiem (1909) –, n’avançant que des faits étayés et se refusant aux suppositions psychologisantes.
Ce livre troué et lumineux est tout à fois résolument un texte de Marie Darrieussecq, qui s’inscrit en plein dans son œuvre et creuse les mêmes thèmes (l’articulation entre l’art et la vie, la maternité), et un ouvrage généreux, au service d’une autre femme, à laquelle elle veut « rendre plus que la justice : (…) l’être-là, la splendeur ». Le miracle est qu’elle y parvient. Raphaëlle Leyris
Etre ici est une splendeur. Vie de Paula M. Becker, de Marie Darrieussecq, POL, 160 p., 15 €.
ROMAN. « De la nature des dieux », d’António Lobo Antunes
Un palais, à la lisière de Cascais. Des domestiques. Un intérieur luxueux. Un jardin exubérant. Là vit une femme âgée. Isolée, après avoir rompu avec ses enfants, elle raconte son existence à une employée de librairie, à laquelle elle commande chaque semaine des piles d’ouvrages qu’elle ne lira pas. C’est sur ce long monologue que s’ouvre De la nature des dieux, foisonnant roman du grand écrivain portugais António Lobo Antunes. Une tirade à laquelle jamais sa visiteuse ne sera invitée à répondre. Tout juste sera-t-elle sommée d’écouter ce récit qu’entrecoupent ses propres pensées. La violence de cette parole imposée, l’auteur en fait une parabole du pouvoir et de la façon dont celui-ci s’exerce entre les différentes classes sociales.
Cette violence s’incarne en la personne du père de la vieille femme. Lobo Antunes dresse ici le portrait brut d’un tyran, privé de toute morale, dont il restitue les traits à travers quatre voix successives, issues d’époques différentes. Quatre regards qui convergent pour donner à voir un être, dieu maléfique des temps modernes, dominant le monde comme une arène peuplée de « clowns » à son service. L’écrivain, en ancien psychiatre, s’applique à élucider, chez chacun de ses personnages jetés ainsi dans le « cirque » du pouvoir, le poids de ses origines familiales. Pour servir ce regard désabusé sur l’essence de l’humanité, il y a la force de sa langue heurtée, fracassée, qui fait alterner les points de vue et les différents narrateurs, souvent au cœur d’une même phrase, comme s’ils s’affrontaient sur un ring de boxe. Ariane Singer
De la nature des dieux (Da natureza dos deuses), d’António Lobo Antunes, traduit du portugais par Dominique Nédellec, Christian Bourgois, 528 p., 25 €.
NOUVELLES. « Une chance unique », d’Erwan Desplanques
La première réussite de ce recueil tient à sa fine organisation. L’art du montage est à compter parmi les qualités du bon nouvelliste. Or, ce livre commence très fort et s’achève en beauté. La plupart des nouvelles sont confiées à un narrateur sans nom dont le détail biographique diffère dans chaque récit, mais qui nous devient pourtant de plus en plus familier, comme s’il s’agissait d’un même homme : observateur lucide, un peu en retrait de sa vie, vaguement résigné à son sort, plutôt bien disposé envers autrui quoique un peu las de tout ce cirque. A l’égard de ses personnages, Erwan Desplanques fait preuve d’une sorte de cruauté bienveillante, ces derniers n’étant jamais tout à fait ridicules, même si la vie s’acharne à leur prouver leur peu d’importance. Eric Chevillard
Une chance unique, d’Erwan Desplanques, L’Olivier, 160 p., 15 €.
ROMAN. « L’Assassin qui rêvait d’une place au paradis », de Jonas Jonasson
Johan Andersson est libéré après trente-six ans de prison. Libéré par la justice, certes, mais pas de ses mauvais penchants : la bagarre et la boisson. Deux vices qu’entendent faire prospérer une femme pasteure qui ne croit pas un mot de la Bible, ainsi que son amant, le réceptionniste de l’hôtel miteux où a pris pension l’ex-détenu. Contre rétribution, le poivrot casse jambes et bras, jusqu’au jour où il connaît une crise mystique et se refuse à poursuivre dans la voie du sang. Le plan B consiste à faire de lui un rentable prêcheur d’amour et d’ivresse, en lui évitant de se faire tuer par des criminels en furie partis à ses trousses…
Ce troisième roman du Suédois Jonas Jonasson – variation sur le même thème que les précédents, la bêtise et la crédulité universelles – réjouit par ses saillies et sa kyrielle de gags. Artificier de l’humour, Jonasson s’emploie à son entreprise de désacralisation avec intelligence et malice. Macha Séry
L’Assassin qui rêvait d’une place au paradis (Mördar-Anders och hans vänner [samt en och annan ovä])), de Jonas Jonasson, traduit du suédois par Laurence Mennerich, Presses de la Cité, 384 p., 22 €.