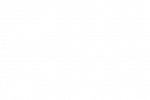A Cannes, deux films aux antipodes entrent en parallèle

A Cannes, deux films aux antipodes entrent en parallèle
Par Thomas Sotinel
Ouverture tragique pour la Quinzaine des réalisateurs avec « Fais de beaux rêves », plus enjouée pour la Semaine de la critique avec « Victoria ».
L’accord s’est peut-être conclu en secret, à moins qu’il ne s’agisse d’une pure coïncidence : la Quinzaine présenterait un film tragique, mélodramatique presque, d’un vétéran ; la Semaine, une comédie virevoltante d’une nouvelle venue. En tout cas, impossible d’imaginer opposition plus radicale entre les deux longs-métrages présentés en ouverture des sections parallèles : Fais de beaux rêves, de Marco Bellocchio, à la Quinzaine des réalisateurs et Victoria, de Justine Triet, à la Semaine de la critique.
Il n’est pas sûr que ces deux films soient annonciateurs des tons respectifs des deux programmations. Les jeunes cinéastes sont majoritaires à la Quinzaine, et on ne trouve, avec Marco Bellocchio, que deux grands anciens au programme : Alejandro Jodorowsky, qui présentera Poesia Sin Fin, et Paul Schrader, dont on verra Dog Eat Dog en clôture. Pas plus que le ton enjoué (quoique troublant) de Victoria ne garantit une Semaine exclusivement humoristique.
La section vouée aux premiers et deuxièmes films proposera des excursions dans le Liban de l’après-guerre (Tramontane, de Vatche Boulghourjian) ou les bas-fonds de Singapour (A Yellow Bird, de K. Rajagopal). Et si le premier film de la compétition projeté à la Semaine ce 12 mai, Albüm, du Turc Mehmet Can Mertoglu, est bien une comédie, elle est d’un noir impénétrable – mettant en scène un couple d’une insondable médiocrité prêt à toutes les turpitudes pour obtenir la mutation du mari enseignant.
Au cœur de la perte et du deuil
« Fais de beaux rêves », murmure une mère à son fils avant de mourir, sans réveiller l’enfant. De ce drame est né un roman de Massimo Gramellini (publié en France chez Robert Laffont) dont Marco Bellocchio s’est saisi pour revenir encore une fois sur le lien entre une mère et son fils, qui l’obsède depuis si longtemps. Le film va et vient dans le temps, entre l’année de la tragédie – 1967 –, l’enfance et l’adolescence endeuillée du petit Massimo à Turin, sa carrière de journaliste à Rome et à Sarajevo.
On reconnaît dans le scénario des ficelles du roman contemporain, avec ce secret qui n’en est pas un, mais que le protagoniste principal (incarné par des acteurs dont la valeur va en s’affaiblissant au fur et à mesure que le personnage prend de l’âge) reste incapable de deviner, jusqu’à la séquence finale. Mais il en faut plus pour priver de ses moyens un metteur en scène de la trempe de Bellocchio. Les séquences qui montrent la solitude de l’orphelin dans l’effervescence des années 1960, le dialogue impossible avec le père enfermé dans la douleur et le secret sont filmées à hauteur d’enfant, plaçant le spectateur au cœur de la perte et du deuil.
Au fil du récit, Massimo croise des femmes mystérieuses ou apaisantes, selon qu’elles sont incarnées par Emmanuelle Devos ou Bérénice Bejo. Presque à chaque fois, c’est l’occasion de tourner une nouvelle variation sur l’amour maternel, ses illusions, ses déchirements, ses regrets. On ne peut qu’être frappé de la coïncidence de ce retour vers l’enfance (qui n’est pas un retour en enfance) d’un cinéaste septuagénaire avec la recherche du temps perdu de Woody Allen dans Café Society.
De l’autre côté de l’Hôtel Carlton, au Miramar, la Semaine offrait un film parfaitement moderne, avec des réseaux sociaux, des images saisies partout et par n’importe qui (même par un chimpanzé) et des arrangements sentimentaux qui n’auraient pas trouvé leur place dans le Code Napoléon. Victoria (Virginie Efira) a peut-être été ainsi baptisée par Justine Triet, scénariste de son propre film, parce qu’elle n’a strictement rien à voir avec la monarque britannique. Pénaliste, mère célibataire (mais affligée d’un « ex » affligeant, blogueur à aspirations littéraires), elle voudrait croire qu’elle n’a renoncé à rien, du plaisir érotique aux joies et servitudes de la maternité, en passant par la psychanalyse et le tirage des cartes.
Jusqu’au jour où elle accepte de défendre un ex-amant (Melvil Poupaud), accusé d’avoir poignardé sa compagne avec un couteau à dessert, parce que c’était le stade où en était arrivé le repas de mariage qui fut le cadre du crime. A partir de cette décision fatidique, Justine Triet organise avec une jubilation sadique et perverse la démolition de la vie de Victoria.
Les procès s’y multiplient dans lesquels la jeune femme passe de la place de défenseuse à celle d’accusée ou de plaignante. A chaque fois, ils sont mis en scène avec un goût pour l’absurde, qu’il relève de la simple observation ou de l’invention la plus délirante (dans la procédure principale témoignent le chimpanzé et un dalmatien). Et les péripéties de la vie érotique de Victoria valent largement celles de sa vie professionnelle, avec dans le rôle du chevalier blanc Vincent Lacoste. Qui fait un joli couple avec Virginie Efira. Mais comment faire autrement ? L’actrice est si changeante d’une scène à l’autre, éteinte ou étincelante, séduisante ou pitoyable, qu’elle s’accorderait avec n’importe quel partenaire.