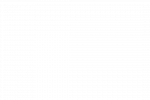« Les chercheurs comme la recherche doivent être protégés »

« Les chercheurs comme la recherche doivent être protégés »
La mort du doctorant italien Giulio Regeni en Égypte illustre la difficile condition de l’exercice des sciences sociales en milieu autoritaire, selon l’historienne Elena Chiti.
Par Elena Chiti, historienne du Moyen Orient
Le nom de Giulio Regeni n’est plus, malheureusement, celui d’un inconnu. Doctorant italien de l’Université de Cambridge, passionné par le mouvement syndical égyptien et les vendeurs de rue, Regeni menait ses recherches au Caire, quand il a été enlevé, le 25 janvier dernier. Son corps a été retrouvé le 3 février, avec des signes évidents de torture. Malgré le déni officiel, tous les indices impliquent les forces de sécurité égyptiennes. Enlevé, torturé et tué parce que chercheur, Giulio Regeni était coupable de poser des questions et récolter des données.
Sa mort, à l’âge de 28 ans, interpelle le monde académique. Il nous met face à la nécessité de repenser les risques et les limites de notre travail, ainsi que de nos liens avec les sociétés du Moyen Orient. Les chercheurs sont-ils en sécurité dans cette région ?
La question se pose, mais il faut essayer de parvenir à une réponse qui ne soit pas excessivement simpliste ou purement émotionnelle. Une réponse négative semble aller de soi, s’imposant comme une évidence, mais, loin d’être satisfaisante, elle ouvre la voie à d’autres questions. La première est une question d’historienne : les chercheurs ont-ils jamais été en sécurité ? Si une réaction de choc explique, à chaud, la tentation de peindre un événement tragique comme une nouveauté absolue, l’oubli du passé n’est plus justifiable dès qu’on articule une réflexion.
L’enlèvement de Michel Seurat en mai 1985, puis sa mort annoncée quelques mois plus tard, dans un Beyrouth en proie à la guerre civile, semble avoir des points en commun avec le cas Regeni. Certes, Michel Seurat n’était pas un doctorant, mais un sociologue confirmé, chercheur au CNRS. Son livre Syrie, l’État de barbarie (PUF, 2012) continue d’être d’actualité à trente ans de distance. Son enlèvement a été une opération ciblée, qui le visait personnellement, voulue par le Hezbollah, Damas et Téhéran. Mais le parallèle est-il totalement déplacé ? Dans les deux cas, des recherches menées en contexte autoritaire ont été à l’origine de la mort des chercheurs. Dans les deux cas, les familles ont dû lutter pour demander vérité et justice.
Illusions
Il y a néanmoins une autre question : pourquoi dresser un parallèle entre Regeni et Seurat, malgré la différence de statut, d’enjeux et de contexte ? Un autre aspect relie le sociologue français et le jeune chercheur italien et c’est leur condition d’étrangers dans le monde arabe. Dans un article paru dans le journal égyptien Mada Masr, Isabel Esterman, résidante étrangère du Caire, avouait avoir été profondément choquée par la mort de Regeni et en avoir éprouvé de la honte. Cette mort a brisé son illusion d’appartenir à une catégorie à part, pouvant risquer au pire l’expulsion et la prison, non pas la torture et le meurtre que risquent les Égyptiens. C’est un sentiment de honte qui nous interpelle et que l’on peut partager.
La mère de Giulio Regeni, en revanche, a toujours dit que le sort de son fils est celui de centaines d’Égyptiens, victimes de disparition forcée, de torture, de meurtre. En passant du constat à la revendication, l’opposition égyptienne s’est approprié la figure de Regeni. Elle en a fait un symbole de résistance, l’emblème d’un activisme qui transcende les frontières nationales. Or, Giulio Regeni n’était pas prêt à mourir pour ses idées. Il était prêt à les soumettre à l’épreuve du terrain et à la critique de ses collègues, à les formuler et reformuler sur la base de nouveaux acquis. Il a été un chercheur, pas un opposant. Une victime, pas l’apôtre d’une cause.
Faut-il pour autant infantiliser la victime ? Lui enlever agence et conscience ? On en vient ainsi à une question épineuse, soulevée au cours de ces derniers mois : celle de la protection. Si un contexte autoritaire protège les meurtriers d’un chercheur, qui protège les chercheurs eux-mêmes ? Et qu’entend-on par protection ? Dans une Italie secouée par le drame, celle-ci a été souvent envisagée en termes paternalistes. On a souligné le jeune âge de Regeni, plus que son expérience et ses qualités de chercheur, reconnues par ceux qui l’ont côtoyé. On a accusé ses directrices de thèse de l’avoir brutalement exposé au risque, en oubliant qu’un doctorant n’est pas une marionnette dans les mains d’un marionnettiste. On a déplacé le débat vers la fuite des cerveaux, en mêlant l’affiliation à Cambridge et le séjour en Égypte dans une sorte de méfiance généralisée envers l’étranger.
Quoique répandues, ces positions ont été heureusement critiquées. Lorenzo Declich, journaliste expert de monde arabe, a analysé les dérives d’une rhétorique qui invite à « mieux protéger nos jeunes ». Fiorenza Loiacono, doctorante en éducation à la politique, a déclaré que Giulio Regeni n’avait pas besoin de protection, « n’étant pas plus vulnérable que n’importe quel être humain traité en tant que tel ».
Si les chercheurs ne sont pas en sécurité, cela ne signifie pas qu’ils aient besoin de protection : non pas parce qu’ils jouent à Indiana Jones, mais parce qu’ils s’efforcent de bien faire leur travail, avec prudence et professionnalisme, même en contexte autoritaire. C’est la recherche en sciences humaines et sociales qui a peut-être besoin d’être protégée. Tant qu’on considère que c’est un passe-temps oisif, auquel on peut bien renoncer, on risque d’oublier qu’une lecture critique, et historique, des dynamiques à l’œuvre dans une société est une condition essentielle pour essayer de la comprendre, en s’interdisant de donner des réponses avant d’avoir posé les bonnes questions et interrogé les bonnes sources. C’est là toute la différence entre la recherche et la propagande.
Elena Chiti chercheuse associée au Le Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes (LARHRA) de Lyon. À l’occasion de la deuxième édition des Rendez-Vous de l’Histoire du Monde Arabe (RVHMA) qui se tient à l’Institut du Monde Arabe du 20 au 22 mai sur le thème « religions et pouvoirs » et dont Le Monde est partenaire, le conseil scientifique des RVHMA a souhaité attirer l’attention sur l’insécurité croissante que rencontrent les chercheurs qui enquêtent sur le terrain. Ils ont voulu donner la parole à une jeune chercheuse, Elena Chiti.