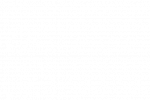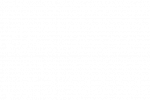Pour leur carrière, ils ont choisi le Maroc, pas la France

Pour leur carrière, ils ont choisi le Maroc, pas la France
Par Paul Blondé, Julia Küntzle
Portraits de Marocains qui ont grandi ou fait leurs études en France. Ils avaient la possibilité d’y rester, mais l’appel du « retour » a été le plus fort.
Ils ont en commun d’avoir grandi ou fait leurs études en France. Ils avaient la possibilité d’y rester. Pourtant, ces Marocains ou Franco-Marocains ont opté pour le retour aux sources et ont rencontré le succès de l’autre côté de la Méditerranée.
Certains, comme Mohamed Ezzouak, patron du site d’informations Yabiladi, sont des « repats », comme l’on surnomme au Nigeria cette génération diplômée européenne ou américaine ayant choisi d’aller vivre et s’investir dans le pays de leurs parents. Mais, au-delà des raisons économiques, c’est souvent une quête de sens qui explique leur retour et leur a donné le courage de persévérer en dépit des difficultés.
En 2010, un homme d’affaires, Jamal Belahrach, avait fait parler de lui avec un livre, Envie de Maroc. Après avoir grandi en France, il rejoint le Maroc à 34 ans. « Ce livre a été une thérapie pour moi, confie-t-il. Il faut dire à ceux qui souhaitent venir vivre une expérience au Maroc qu’il faut s’y préparer et ne pas venir en terrain conquis. »
Selon une estimation datant de 2013, ceux que l’on appelle des « MRE » (Marocains résidents à l’étranger) seraient entre 6 et 7,5 millions, dont environ 1,5 million en France. Ils font l’objet d’une attention grandissante de la part du royaume, qui organise des foires en France et ailleurs pour convaincre les jeunes diplômés, très recherchés par les entreprises marocaines, de rentrer. Un ministère est désormais dédié aux MRE, qui déploie des programmes pour faciliter leur retour. Combien le font, ce retour ? Les chiffres sont vagues. En 2013, le ministre des MRE avait annoncé que 30 000 d’entre eux avaient regagné définitivement le Maroc depuis 2010.
En dehors de ces programmes gouvernementaux, trois Franco-Marocains ont raconté au Monde Afrique comment, en faisant de leur double culture un atout, ils ont réussi dans le royaume chérifien.
Mohamed Ezzouak
S’il a voulu « créer un pont entre la France et le Maroc », c’est tout sauf un hasard. Mohamed Ezzouak, fondateur en 2002 de yabiladi.com, dirige toujours aujourd’hui ce qui est devenu le premier portail francophone du Maroc, avec 400 000 membres, 6 millions de visites et près de 14 millions de pages vues par mois.
Yabiladi est devenu, comme l’espérait son fondateur, le site de la diaspora marocaine, dont le natif d’un petit village près de Taounate a longtemps fait partie. « Je suis parti en France à deux ans, avec ma mère et ma sœur, dans les bagages de mon père, qui était ouvrier dans une usine de plasturgie à Oyonnax, dans l’Ain, entre Lyon et Genève. » Mohamed Ezzouak grandit avec le « mythe du retour » de son père, proche du Parti communiste, admirateur des valeurs de liberté et de « méritocratie » de l’école à la française, mais conscient du décalage identitaire avec son pays d’accueil, dont il ne maîtrise quasiment pas la langue. « J’ai cultivé une attache avec le Maroc grâce aux vacances annuelles, raconte-t-il avec bonheur. Des vacances à la Pagnol. »
Bon élève, surtout en français, Mohamed fait des études supérieures à Lyon. Alors qu’à Oyonnax, « le premier de la classe regardait bizarrement l’Arabe qui avait les meilleures notes », le futur patron de Yabiladi découvre « une ville cosmopolite » où il apprend à « accepter et à être à l’aise avec [sa] double culture ». Il y rencontre aussi sa femme, d’origine marocaine comme lui. Spécialisé en informatique décisionnelle, il débute sa carrière à Paris avec succès. Tout va bien pour lui, jusqu’à une réunion professionnelle, le 11 septembre 2001, alors qu’il a 23 ans. « Quelqu’un est entré dans la pièce en parlant du World Trace Centre et en nous disant d’allumer la télévision. Là, un des participants à la réunion s’est levé, s’est tourné vers moi et a lancé : “Putain, vous faites chier, les Arabes !” Je me suis pris un énorme choc négatif dans la figure. Depuis, l’atmosphère n’a fait qu’empirer. » Déjà en pleine réflexion sur l’idée d’un portail franco-marocain, le jeune homme souhaitait créer « un endroit où les Franco-Marocains pourraient se réapproprier leur identité, mais de façon ouverte, sans communautarisme ». Il franchit le pas et met le cap sur Casablanca. Les premiers mois sont très durs : « La veille du départ, j’ai senti un vertige. Je suis arrivé un 4 janvier chez mes cousins, dans un quartier populaire. Il faisait très froid, c’était pollué. J’ai vu l’énormité du défi à relever. Je n’ai jamais compris l’exigence d’intégration qu’on nous imposait en France. Moi, je suis d’Oyonnax, c’est mon terroir, la France est mon pays, pourquoi devrais-je m’y intégrer ? Par contre, l’exigence d’intégration, je l’ai comprise en arrivant au Maroc. Mon adaptation a duré neuf mois avant que le Maroc, ce soit chez moi. » Neuf mois avant un déclic : « Le mythe du retour de mon père, je l’avais dans le sang. Mais, pour que je me sente bien ici, il a fallu que je comprenne que pour moi, ce n’était pas un retour. »
Meryem Cherkaoui
Bac en poche, Meryem Cherkaoui quitte Rabat pour étudier la cuisine en France dans le prestigieux Institut Paul Bocuse. Mais les plus grands palaces, du Crillon au Majestic, ne parviennent pas à la retenir. « Je n’ai pas eu envie de rester dans ces grandes structures, explique-t-elle, et l’idée de rentrer au pays pour y lancer mon propre business ne m’a jamais quittée. »
La jeune chef retourne au Maroc en 2000. Elle s’investit pendant un an corps et âme pour monter son restaurant, La Maison du gourmet, à Casablanca. « Rien n’a été facile !, s’exclame-t-elle. Ici, il ne faut pas s’attendre à trouver les explications dans des guides, il faut tout chercher soi-même et former le personnel de A à Z, comme s’ils entraient à l’école hôtelière. Ne pas savoir ce qu’est une julienne, c’est comme ignorer le solfège en piano ! » Idem pour les fournisseurs, à qui la chef explique comment livrer et respecter les conditions d’hygiène ou de traçabilité. « Je suis même allée voir comment on cultivait les produits, pour les améliorer. C’était dur, mais je ne regrette rien, j’ai beaucoup appris et désormais je n’ai plus peur de rien ! », s’amuse-t-elle. Sa recette, qui allie le savoir-faire français aux saveurs de son pays natal, lui assure le succès et la reconnaissance.
Autant chef d’entreprise que chef, Meryem Cherkaoui ne s’arrête pas là. Elle revend son restaurant pour partir sur de nouveaux fronts : la formation, avec L’Atelier des chefs, et la mise en valeur à l’étranger des terroirs marocains avec Dilma Terroir. La totalité des bénéfices issus de la commercialisation de ces produits de luxe sont reversés aux coopératives de femmes avec qui elle travaille.
Insatiable, elle ouvre aussi des restaurants « signature », comme récemment à Milan ou encore à Marrakech pour la chaîne Mandarin Oriental. Meryem Cherkaoui attribue avant tout sa réussite à l’amour qu’elle nourrit pour son pays. « Si je n’aimais pas ce métier, je ne pourrais pas lui donner plus. Pour mon pays, c’est pareil ! »
Mehdi Alioua
Mehdi Alioua, 40 ans, est docteur en sociologie et enseignant-chercheur à Sciences Po Rabat depuis 2011. Et il compte bien rester au Maroc : « Je me dis que j’aurais même dû revenir plus tôt ! »
Auparavant, sa vie s’était partagée entre les deux pays : une petite enfance en France, à Montpellier, jusqu’à ses 6 ans : « Les cours d’arabe à l’ancienne, où le prof tapait avec sa règle, ont été mon premier traumatisme ! » Puis une jeunesse marocaine, jusqu’à 18 ans : « Je n’avais qu’une envie, c’était de foutre le camp. C’était le Maroc post-années de plomb. Dès qu’on parlait de politique, de sexualité, de place des femmes, on se mettait à chuchoter. » Puis de nouveau quinze années en France, estudiantines et militantes, conclues par une thèse en sociologie sur les Subsahariens du Maroc. Quand il est revenu en France à 18 ans, il était « quasiment persuadé » de ne pas en repartir. « Mais en fait, il n’y avait pas de place pour moi », regrette-t-il. C’est alors que lui vient l’envie de se « rendre utile » dans le royaume. Sans déménager, il cofonde en 2006 le Groupe antiraciste de défense et d’accompagnement des étrangers et migrants (Gadem), dont il fait toujours partie.
Plusieurs années passeront encore avant que, en 2011, Mehdi reçoive un coup de fil : « C’était pour me proposer mon poste actuel à l’université », raconte-t-il. Il refait donc le voyage du « retour », cette fois avec sa femme et ses filles et se félicite aujourd’hui de ne pas avoir reculé : « Ma seule peur avant de venir, c’était de me retrouver avec un emploi sans intérêt, dans un ministère ou ailleurs : costard-cravate et métro-boulot-dodo. Finalement, je m’épanouis. Je me sens valorisé ici, c’est gratifiant. » Et quand on l’interroge sur le phénomène des « repats », Mehdi Alioua émet les doutes du sociologue : « Je pense qu’il est surévalué. Le Maroc est souvent cité comme un pays qui garde un lien fort avec sa diaspora, et c’est vrai. Malgré cela, peu de Franco-Marocains de la seconde génération reviennent. Ils ne représentent qu’un tiers de l’ensemble des Français venant s’installer au Maroc. Parfois, je leur demande dans quel pays ils veulent être enterrés. Et, contrairement à leurs parents, aucun de ces enfants d’immigrés ne m’a jamais répondu : “Au Maroc”. »