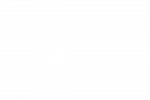Les dix penseurs africains qui veulent achever l’émancipation du continent

Les dix penseurs africains qui veulent achever l’émancipation du continent
Par Séverine Kodjo-Grandvaux (contributrice Le Monde Afrique, Douala)
Portraits des personnalités qui viendront débattre aux Ateliers de la pensée de Dakar et de Saint-Louis, organisées par Felwine Sarr et Achille Mbembe.
C’est sur l’impulsion de Felwine Sarr et Achille Mbembe que s’ouvre, à Dakar et à Saint-Louis, ce vendredi 28 octobre, la première édition des Ateliers de la pensée.
Un rendez-vous appelé à faire date et auxquels l’écrivain sénégalais et l’historien camerounais ont convié plusieurs personnalités africaines à élaborer le renouveau d’une pensée africaine plurielle et dégagée, entre autres, du post-colonialisme. Une entreprise de « décolonisation mentale ». Portraits.
Kwame Anthony Appiah
Son œuvre pourrait sembler peu africaine et pourtant, c’est l’une des plus importantes et des plus significatives du renouveau de la pensée critique du continent. Résolument inscrite dans les traditions philosophiques occidentales, la réflexion de Kwame Anthony Appiah puise néanmoins sa source dans son histoire familiale et son double héritage culturel, ghanéen et britannique évoqués dès 1992 dans In My Father’s House (Oxford University Press).
Le cosmopolitisme n’est pas seulement une question théorique, c’est une éthique et une pratique pour celui qui a grandi au Ghana avant de mener ses études supérieures en Angleterre et de s’installer aux Etats-Unis, où il a enseigné dans les plus prestigieuses universités. Ainsi qu’il le raconte dans Vers un nouveau cosmopolitisme (éd. Odile Jacob, 2008), Appiah s’est toujours efforcé d’obéir au vade-mecum de son père : « Souvenez-vous que vous êtes des citoyens du monde, et travaillez à le quitter meilleur que vous ne l’aurez trouvé. »
Lire aussi La curiosité cosmopolite
Etre citoyen du monde, c’est s’autoriser à être d’ici et d’ailleurs pleinement, à hériter de l’humanité entière et contribuer à l’enrichir de là où nous sommes. C’est concilier le singulier et l’universel, le différent et l’en-commun, c’est refuser les assignations identitaires. « Les identités ethnoraciales risquent fort de devenir obsessionnelles, un tout et la fin de tout, dans les vies de ceux qui s’identifient à elles. […] Et en oblitérant les identités qu’ils partagent avec les gens en dehors de leur race ou de leur ethnicité, elles les détournent de la possibilité de s’identifier aux Autres. […] Il ne faut pas laisser nos identités raciales nous soumettre à de nouvelles tyrannies », écrit-il dans Color Conscious (Princeton University Press, 1996) avant de nous inviter à vivre « des identités fracturées ».
Ainsi que le remarque dans la revue De(s) générations Anthony Mangeon, professeur de littératures francophones à l’Université de Strasbourg, avec Appiah, né en 1954, comme avec V. Y. Mudimbe, « la pratique africaine de la philosophie, telle qu’ils l’ont conjointement menée en combinant l’étude historique, l’analyse conceptuelle et l’approche anthropologique, peut non seulement fournir un modèle interdisciplinaire, mais surtout illuminer des questions centrales pour la philosophie occidentale ».
Ali Benmakhlouf
Dans son dernier essai La Conversation comme manière de vivre (éd. Albin Michel), Ali Benmakhlouf s’appuie aussi bien sur Montaigne, Lewis Carroll, Flaubert, Jack Goody, ou James Agee que sur Al-Tawhidi ou Al-Farabi, Barthes ou Leibniz. Il nous démontre une fois de plus que la bibliothèque du monde est ouverte à tous. Grâce à ces références multiples, il étudie sous de nombreux angles tout ce qui fait la richesse de la conversation, là où se joue le lien à soi-même et à autrui et où se noue la relation qui « nous fait tenir l’un à l’autre par la parole ».
Lieu de l’échange, de la confrontation comme de la réconciliation, la conversation est aussi un espace de transmission d’un patrimoine, ainsi que l’a montré la « controverse de Bagdad » lors de laquelle les penseurs musulmans questionnèrent le legs grec et interrogé le lien entre philosophie et islam à l’époque médiévale. Une question fréquente dans la réflexion du philosophe né à Fès en 1959, dont une grand-mère maternelle était sénégalaise. Il enseigne à l’université de Paris-Est-Créteil et se dit « 100 % africain et 100 % européen ». Un pied en France, l’autre au Maroc, Ali Benmakhlouf s’intéresse aussi bien aux questions d’identité, de droit, d’art, d’éthique médicale, de politique que de logique. Il est l’auteur notamment de Pourquoi lire les philosophes arabes (éd. Albin Michel, 2015), un essai remarqué qui nous rappelle à quel point la pensée médiévale arabe, et donc l’islam, a façonné le paysage intellectuel européen.
Jean-Godefroy Bidima
Jean-Godefroy Bidima est un homme extrêmement discret. Vous ne le croiserez pas sur un plateau télé, mais dans la pénombre des bibliothèques qu’il fréquente assidûment. Spécialiste de la théorie critique de l’école de Francfort, l’ancien directeur de programme du Collège international de philosophie de Paris est professeur titulaire de l’université Tulane, à la Nouvelle-Orléans, où il occupe la chaire Yvonne-Arnoult.
Bioéthique, anthropologie du droit, éthique médicale, esthétique, économie… ses champs de réflexion sont nombreux et vastes. Penseur extrêmement fécond, ce philosophe camerounais de 58 ans s’efforce de lire notre monde à travers ses imaginaires et les rapports asymétriques et de domination qui le structurent. Au fil de ses recherches, il forge une œuvre solide qui appréhende les réalités africaines et globales à travers les non-dits, déconstruit les faux-semblants et interroge les interstices et les marges.
Dans l’un de ses derniers articles publié dans l’ouvrage collectif qu’il a codirigé avec Victorien Lavou Zoungbo, « Réalités et représentations de la violence en postcolonies » (Presses universitaires de Perpignan, 2015), il revient sur la violence imposée par « l’esprit managérial », caractéristique de la raison instrumentale, qui « sacrifie souvent le règne des fins au profit du fétichisme des moyens ». Conséquence : « La fameuse notion de “développement” avait comme mission de faire la guerre à “ce qui ne sert pas” au profit d’une rationalité qui ne fait que calculer. » A été alors sacrifié tout ce qui a été jugé inutile au marché : on a dépouillé le sujet de ses références culturelles, on l’a mis à nu et l’on a manipulé et instrumentalisé ses désirs afin qu’il consomme toujours plus, même s’il n’en a pas les moyens. Quitte à engendrer de la frustration. Ainsi passe-t-on d’une économie de production à une économie de consommation.
Auteur de L’Art négro-africain (éd. PUF, « Que sais-je ? », 1997) et La Philosophie négro-africaine (éd. PUF, « Que sais-je ? », 1995), Jean-Godefroy Bidima a créé le concept de « traversée », largement repris depuis par des penseurs plus connus comme son compatriote Achille Mbembe, afin de dire « de quels pluriels une histoire déterminée est faite ». Plus qu’une idée-force, la traversée est une attitude face au réel, l’envie d’y déceler le multiple et le divers, de percevoir le potentiel et le non-encore-exprimé, de démêler le confus et le non-dit afin de permettre au possible d’éclore. Et de laisser place aux utopies émancipatrices.
Souleymane Bachir Diagne
A l’image d’Ali Benmakhlouf qui a écrit Pourquoi lire les philosophes arabes, Souleymane Bachir Diagne est l’un des penseurs africains les plus éminents de l’islam et de ses Lumières. Son ouvrage Comment philosopher en islam (éd. Jimsaan, 2014) rappelle que cette religion a produit une « tradition de libre-pensée » et que le débat pour un islam ouvert et philosophique a toujours existé. Il est même plus que jamais « vital que la pensée en islam mette en avant esprit critique et pluralisme ». Une thèse qu’il défend vaillamment dans des entretiens croisés avec Philippe Capelle-Dumont et publiés en septembre aux éditions Le Cerf sous le titre Philosopher en islam et en christianisme.
Né à Saint-Louis en 1955, professeur à l’université Columbia de New York formé à l’Ecole normale supérieure de la rue d’Ulm, spécialiste de l’algèbre de Boole et de logique, Souleymane Bachir Diagne s’intéresse tout particulièrement à la question de la traduction. A la suite des travaux menés par le Ghanéen Kwasi Wiredu, le Sénégalais affirme, dans un entretien paru dans la revue De(s) générations, que « passer d’une langue à l’autre permet de voir en quoi les problèmes philosophiques, que l’on dit universels, sont fortement liés aux différentes langues dans lesquelles ils sont formulés ». Une manière de relativiser la prétention à l’universel de certains énoncés philosophiques, en les inscrivant dans leur culture.
Pour autant, pas question de renoncer à l’universel pour Souleymane Bachir Diagne qui, à l’instar de Jean-Godefroy Bidima, fait sienne la distinction opérée par Merleau-Ponty dans son Eloge de la philosophie entre un universalisme de surplomb et un universalisme latéral qui est l’« horizon qui se propose à partir de la postcolonialité », celui que nous devons construire à partir de l’expression de nos diversités, si nous voulons faire monde-en-commun.
Nadia Yala Kisukidi
La Française d’origine congolaise et italienne Nadia Yala Kisukidi lors de l’émission « Philosophie » d’Arte. | Gérard Figuérola/PRIME GROUP
Se penchant sur l’Inde coloniale, le politologue Rajeev Bhargava remarque dans un article publié en 2013 dans la revue Socio qu’« à l’injustice économique et politique qu’implique la colonisation s’ajoute une injustice culturelle. L’injustice épistémique en est l’une des formes : elle survient quand les concepts et les catégories grâce auxquels un peuple se comprend lui-même et comprend son univers sont remplacés ou affectés par les concepts et les catégories des colonisateurs ». Cela est vrai aussi pour l’Afrique et à partir de la réflexion de Rajeev Bhargava, Nadia Yala Kisukidi appelle à mettre fin à l’une de ces injustices épistémiques : la non-reconnaissance de l’existence de pensées philosophiques en terres d’Afrique. Une non-reconnaissance qui émane des philosophes occidentaux eux-mêmes (Hegel, entre autres, exclut les Noirs de la marche de l’Histoire et donc de la raison) mais aussi des agents coloniaux, au premier rang desquels l’on retrouve les premiers anthropologues, qui ont décrété qu’il n’y avait pas de Raison au sud du Sahara mais une « mentalité primitive » (Henri Levy-Bruhl).
Ce lourd héritage colonial pèse toujours sur l’enseignement de la philosophie en France où, contrairement aux Etats-Unis, la philosophie africaine n’est pas reconnue par le milieu universitaire. Impossible donc pour la jeunesse française d’apprendre qu’au même moment où Descartes publiait son Discours de la méthode, un éthiopien du nom de Zera Yacob rédigeait Hatata, un traité de philosophie rationaliste.
La Française Nadia Yala Kisukidi, née d’un père congolais et d’une mère franco-italienne, entend donc « décoloniser la philosophie » et mettre à jour « une raison subjuguée par sa propre nuit, construisant lignes de partages et exclusions sommaires ». Tout comme elle entend démontrer, dans un livre à paraître prochainement, que des philosophes africains comme Fabien Eboussi Boualaga, Engelbert Mveng, Jean-Marc Ela ont permis de renouveler la pensée du religieux en en faisant un lieu d’émancipation. Ce que pourront découvrir les étudiants de l’université de Paris-8 où, depuis cette rentrée, la vice-présidente du Collège international de philosophie, spécialiste de Bergson, donne, à 38 ans, un séminaire de philosophie africaine. Une première pour une université française.
Achille Mbembe
Il est sans doute l’un des plus brillants de sa génération. Invité dans le monde entier à donner des conférences, professeur d’histoire à l’université du Witwatersrand, à Johannesburg, mais aussi à Duke, à 61 ans, Achille Mbembe pense l’Afrique et sa « planétarisation ». L’auteur de Sortir de la grande nuit (La Découverte, 2010) ne cesse de le répéter : l’Europe a perdu son leadership international et dans cette reconfiguration économico-politique, c’est sur le continent que se dessine l’avenir de l’humanité.
Mais, alors que les crispations identitaires se multiplient, que la lutte de tous contre tous fait rage et que les démocraties au nom de la guerre contre le terrorisme (Politiques de l’inimité, La Découverte, 2016) sont prêtes à remettre en cause leur fondement même, il est urgent de construire une Afrique tolérante, ouverte, créole. Une « Afrique-monde » où chacun, quels que soient sa religion, sa carnation, son genre ou son orientation sexuelle, puisse s’y épanouir pleinement. Spécialiste de la théorie postcoloniale sans pour autant s’en réclamer (De la postcolonie, Karthala, 2000), ce défenseur de l’afropolitanisme, héritier de Frantz Fanon, pose un regard acéré et sans concession sur notre monde qui, nous rappelle-t-il dans Critique de la raison nègre (La Découverte, 2013), s’est construit sur le racisme et la chosification du corps noir.
Léonora Miano
Entière, sans concession, Léonora Miano n’a pas peur de la confrontation ni de déplaire. Cette radicalité est salutaire. Elle nous tend un miroir et nous oblige à nous regarder en toute lucidité. L’image qui nous est renvoyée est peu glorieuse et nous confronte à notre histoire dans ce qu’elle a de plus sombre. Elle nous force à prendre conscience de nos limites et de nos préjugés. Vous, qui êtes blanc, avez-vous déjà pensé votre blancheur ? Et vous, qui êtes noir, pourquoi vous voyez-vous ainsi ? Pourquoi endosser cette désignation coloniale ?
A partir d’une explication psychologisante de l’invention de la race, Léonora Miano renverse les perspectives habituelles et avance que les esclavagistes ont souhaité se blanchir des « ténèbres » qu’ils déversèrent sur le monde avec la déportation transatlantique d’hommes et de femmes qui jusque-là ne se considéraient ni comme Africains ni comme Noirs. Dès lors, « le Noir matérialise les ténèbres intérieures de celui qui mutile sa propre humanité en niant celle de l’autre » (L’Impératif transgressif, L’Arche Editeur, 2016).
Née à Douala en 1973 et installée en France depuis le début des années 1990, Léonora Miano s’intéresse aussi bien dans ses romans, son théâtre que dans ses écrits théoriques, à la place des afrodescendants dans les sociétés occidentales (Tels des astres éteints), aux pans de la mémoire atlantique en Afrique (La Saison de l’ombre, prix Fémina 2013), aux questions de sexualité et de genre (Crépuscule du tourment, 2016). Elle a ainsi contribué à la diffusion de la notion d’« afropéanité » et se penche sans « pathos ni ressentiment » sur notre passé commun fait d’exploitation et de chosification, d’aliénation et de résistances, afin de mieux saisir notre présent et d’en dessiner les voies émancipatrices.
Sabelo Ndlovu-Gatsheni
La décolonisation de l’Afrique est un mythe, la liberté du continent une illusion. Sabelo Ndlovu-Gatsheni le dit et le répète : l’indépendance des nations africaines n’a pas mis fin aux rapports de domination. En témoignent l’imposition de sanctions économiques ou les interventions militaires sur le continent au nom des droits de l’homme, de la démocratie ou de la lutte contre le terrorisme. Les relations entre l’Occident et l’Afrique se disent toujours dans un rapport de colonialité. Aussi l’historien zimbabwéen, directeur de l’Institut de recherches Archie Mafeje de l’Université d’Afrique du Sud (Unisa), développe-t-il dans Coloniality and Power in Postcolonial Africa : Myths of Decolonization (Codesria, 2013) que « postcolonial » et « néocolonial » s’entremêlent tous deux dans notre monde contemporain et qu’il est plus que jamais urgent de penser la « décolonialité », comme l’ont fait en Amérique latine Walter D. Mignolo, Arturo Escobar, Ramon Grosfoguel ou Anibal Quijano.
Privilégiant une approche interdisciplinaire, Sabelo Ndlovu-Gatsheni appelle à décentrer le regard, à sortir des espaces académiques forgés par un monde européen engagé dans un projet de conquête impériale, à explorer les marges et les frontières. La violence n’est seulement physique ou psychologique, elle est aussi épistémique. Il faut donc penser de nouveaux concepts et de nouveaux référents intellectuels ; condition sine qua non pour bâtir une humanité fondée sur l’équité, la justice sociale et la « coexistence éthique », et mettre fin aux rapports de classes et de races.
Kako Nubukpo
Le franc CFA est un frein à la compétitivité de l’Afrique et au progrès social : Kako Nubukpo en a fait son cheval de bataille. Déjà en 2007, avec son ouvrage Politique monétaire et servitude volontaire : la gestion du franc CFA par la BCEAO (éd. Karthala), il s’attaquait à cette monnaie unique qui maintient les anciennes possessions françaises dans un système de dépendance coloniale. Ce macro-économiste togolais, ancien ministre de la prospective et de l’évaluation des politiques publiques, qui a travaillé pour de nombreuses institutions internationales (BCEAO, Cirad, UEMOA, OIF) en est convaincu : les Etats africains doivent sortir du franc CFA et élaborer leur propre politique monétaire s’ils veulent pouvoir « parachever leur indépendance politique et renforcer les bases d’une transformation structurelle de leur économie ».
Avec Martial Ze Belinga, Bruno Tinel et Demba Moussa Dembele, il vient de publier, aux éditions La Dispute, Sortir l’Afrique de la servitude monétaire. A qui profite le franc CFA ? Une attaque en règle de ce qui paraît être le pilier d’une domination néocoloniale que d’aucuns estiment être relayée également par la francophonie. Ce n’est pas le cas de Kako Nubuko qui, à 48 ans, est devenu directeur de la Francophonie économique et numérique au sein de l’Organisation internationale de la Francophonie.
Felwine Sarr
Les médias français l’ont découvert avec son essai Afrotopia, paru au printemps, mais depuis une dizaine d’années le Sénégalais Felwine Sarr construit une œuvre singulière, originale dans sa forme et son propos, et extrêmement dense. Professeur à l’université Gaston-Berger où il dirige le Laboratoire de recherche en économie de Saint-Louis (LARES), l’organisateur des Ateliers de la pensée est avant tout un écrivain et un poète-philosophe. Il a écrit notamment Dahij (Gallimard, 2009) et Méditations africaines (Mémoire d’encrier, 2012), deux ouvrages inclassables et d’une richesse inépuisable, construits à partir d’aphorismes et de réflexions personnelles, à travers lesquels il livre une pensée à la fois intimiste et universaliste et nous amène à revenir sur ce qui fonde notre humanité et sur la manière dont nous souhaitons la construire.
Adepte des arts martiaux qui a fait sienne la maxime de Juvénal, « un esprit sain dans un corps sain », musulman qui a servi la messe enfant et s’intéresse au bouddhisme zen, sereer dans un univers majoritairement wolof qui parle français depuis son plus jeune âge, à 44 ans, Felwine Sarr sait mieux que quiconque que les identités sont multiples. Et que les cultures peuvent se féconder. Raison pour laquelle il invite les penseurs du continent à s’engager dans une rupture épistémique en délaissant les concepts occidentaux qui seraient peu adaptés aux réalités du continent et en investissant des notions africaines comme le jom (« dignité »), la teranga (« hospitalité »), le ngor (« sens de l’honneur »)… pour en dégager les possibles apports bénéfiques. Que ce soit sur un plan collectif ou d’un point de vue individuel, ce philosophe du quotidien nous invite tous à trouver notre propre voie en délaissant les chemins tracés d’avance et les idées toutes faites.