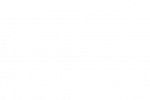« Des journées sans boire, sans manger » : le ras-le-bol infirmier

« Des journées sans boire, sans manger » : le ras-le-bol infirmier
Par François Béguin
Des manifestations sont prévues, mardi 8 novembre, dans tout le pays pour dénoncer la dégradation des conditions de travail.
Elles se disent « amères », « épuisées » et « en colère ». Les infirmières sont appelées à manifester, mardi 8 novembre, aux côtés des aides-soignantes et des personnels non médicaux des hôpitaux publics pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. « Ce sont les premières victimes des économies majeures que l’on demande aux hôpitaux pour rétablir les comptes de la Sécurité sociale », explique Nathalie Depoire, présidente de la Coordination nationale infirmière (CNI), l’une des seize organisations professionnelles à appeler à la grève mardi 8 novembre.
Intensification des rythmes et de la charge de travail, réaffectation parfois brutale des personnels en fonction des besoins, non-remplacement systématique des absents… Les dizaines d’infirmiers et d’infirmières qui ont répondu à un appel à témoignages récemment lancé sur le site Internet du Monde font dans leur très grande majorité état d’un « épuisement moral et physique » face à des « cadences » devenues « infernales ». « Je souffre de mon métier », résume une infirmière de 36 ans exerçant en Haute-Savoie. Les suicides de cinq infirmiers cet été, liés selon leurs proches à leurs conditions de travail, révèlent l’ampleur du malaise de la profession, font d’ailleurs valoir les organisations syndicales.
« Course contre la montre »
« Il y a cinq ou six ans, j’avais en charge quinze patients sur une journée, maintenant j’en ai dix de plus », raconte Catherine, 49 ans, infirmière dans un service de chirurgie d’un gros hôpital du sud de la France. « Des journées sans boire, sans manger, sans aller aux toilettes, ça arrive tout le temps, témoigne-t-elle. Réussir à finir ses tâches devient une course contre la montre ». Admettant rentrer « épuisée » et « hébétée » de ses journées de travail, elle se prend parfois à penser « que l’usine, c’est moins dur ».
Pour nombre d’infirmières, cet accroissement du nombre de tâches à réaliser au cours des heures de travail s’est fait ces dernières années au prix d’une certaine « déshumanisation » de leur métier. Certaines disent même avoir peur de devenir malgré elles « maltraitantes ». « On se retrouve à faire un travail à la chaîne, à ne plus pouvoir passer autant de temps à rassurer un patient stressé ou angoissé avant une opération, on doit souvent se contenter de lui poser les questions de la check-list de sécurité, regrette Pascale, 24 ans, infirmière de bloc opératoire dans un gros hôpital de la région parisienne. J’ai parfois l’impression de traiter ces patients comme des pièces de boucherie et non plus comme des êtres humains. »
Camille, 28 ans, infirmière dans un service de cancérologie en Aquitaine, raconte qu’il lui « arrive de ne pas avoir le temps d’enlever une perfusion à un patient qui veut aller se promener » tant il lui est chaque jour demandé d’être « à quatre endroits à la fois » en raison du « sous-effectif chronique » de son service. « A la frustration de ne plus pouvoir exercer correctement mon travail s’ajoute la culpabilité de n’avoir pu accompagner, faute de temps, cette maman qui pleurait seule au fond du couloir », ajoute Séverine, 32 ans, infirmière dans un service de pédiatrie d’un grand hôpital de Lyon.
Revalorisations de salaires
Autre grief récurrent : la multiplication des tâches, notamment administratives, qui ne relèvent pas directement du soin. « On se retrouve à gérer des plannings, à passer des commandes de matériels auprès de prestataires, ce qui a un impact sur le temps que nous passons avec les résidents », raconte Gwendoline, 26 ans, infirmière dans un établissement pour personnes âgées dépendantes de Saint-Etienne (Loire). Une autre infirmière déplore devoir passer « beaucoup de temps à coder tout ce qu’elle fait », c’est-à-dire de répertorier les tâches qui permettront à l’hôpital de toucher de l’argent de la Sécurité sociale pour les soins effectués.
Car derrière toutes ces critiques, c’est la tarification à l’activité (T2A), progressivement mise en place entre 2004 et 2008 et faisant directement dépendre les ressources budgétaires des hôpitaux de leur production de soins, qui est incriminée par les soignants prêts à manifester mardi. « Le système de cotation administratif ne peut résumer notre travail de soignant, tout ne rentre pas dans les cases, estime Séverine, l’infirmière lyonnaise. Ce qu’on me demande désormais à l’hôpital ne correspond pas au sens que je donnais à mon métier. »
A ces conditions d’exercice, s’ajoute bien souvent la pression exercée par la hiérarchie dans sa gestion des plannings. « On nous demande régulièrement à la dernière minute de venir faire un remplacement le samedi ou le dimanche, témoigne Marie, 40 ans, infirmière dans un service de chirurgie de la région Centre. On peut difficilement refuser, on nous harcèle et on nous culpabilise, on fait valoir la charge de travail qui va peser sur les collègues si on ne revient pas… »
Mardi, les organisations infirmières demanderont au ministère que soient attribués aux établissements de soins des moyens leur permettant de mettre en place des effectifs proportionnels aux charges de travail. Elles plaideront également pour des revalorisations de salaires, aujourd’hui d’un montant d’environ 1 800 euros net par mois en début de carrière. Des mesures qui passent nécessairement, selon elles, par une « révision » du plan triennal d’économie de 3 milliards d’euros demandé à l’hôpital public.