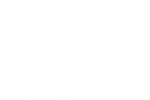Un an après le 13 novembre, « le fantôme du terrorisme plane toujours »

Un an après le 13 novembre, « le fantôme du terrorisme plane toujours »
Par Cécile Bouanchaud
Au cours de cette année, émaillée par d’autres attaques terroristes, les stigmates des attentats de Paris et Saint-Denis restent vifs. Le sentiment de l’habitude n’efface pas celui de l’insécurité.
« Comment retrouver la légèreté ? », « Pourquoi eux sont morts et pas moi ? », « Comment surmonter ma peur ? », « Et si je changeais de vie ? », « Qu’est-ce que je peux faire ? » Un an après les attentats de Paris et de Saint-Denis, les mois passent, mais le souvenir de ce vendredi 13 novembre reste vif. Et les stigmates nombreux. Si le sentiment de sidération est passé, laissant place à celui de l’habitude, la vie n’a pour autant pas repris son cours « normal ».
LeMonde.fr a lancé en octobre un appel à témoignages : « Qu’est-ce que les attentats ont changé dans votre vie ? » A cette question aussi simple que large, nous avons reçu près de 250 récits – un chiffre bien au-dessus de la moyenne. Au-delà de ce constat quantitatif, nous avons été frappés par la qualité des témoignages, souvent denses, teintés de ressentis généraux et empreints de détails concrets. Progressivement, dans cette multitude d’histoires singulières, s’est dessiné un diagnostic général post-attentats : tous évoquent « un avant/après 13-Novembre », une injonction à « vivre avec » le terrorisme, avec ces attaques venues chambouler toute la sphère de l’intime et les habitudes qui la composent.
Identification
Un premier constat s’impose, le 13-Novembre a été un traumatisme national, qui a donné lieu à un processus d’identification puissant. L’onde de choc ressentie a été d’autant plus forte que les liens géographiques, temporels, affectifs ou sociétaux établis avec les victimes étaient ténus. Assez logiquement, la majorité des témoignages que nous avons recueillis sont ceux d’une population qui s’est identifiée avec le plus d’acuité aux victimes des attentats de Paris et de Saint-Denis. Ceux qu’on a appelés la « génération Bataclan » : des jeunes, âgés de 16 à 35 ans, issus de classes moyennes, venus à Paris pour y étudier ou pour travailler, ou vivant dans de grandes villes comme Nantes, Lyon, Lille ou encore Toulouse. Chacun dresse un inventaire des points communs avec les victimes des attentats, comme autant de « j’aurais pu y être ».
« Etant dans la même tranche d’âge que les victimes du 13-Novembre et fréquentant les mêmes lieux pour sortir, j’ai été énormément marquée par ces attentats », souligne Juliette Allot, 25 ans, étudiante en droit à Paris, résumant avec ses mots le leitmotiv de dizaines de jeunes adultes. Des témoignages qui dessinent le portrait d’une génération joyeuse, baroudeuse, déjà marquée par les actes terroristes de janvier 2015. « Charlie Hebdo m’a touchée, mais je ne me sentais pas comme une cible potentielle. Les attentats de Paris ont tout changé », résume Estelle, 38 ans, Parisienne de cœur, qui a une histoire pour chacun des lieux visés par les terroristes du 13-Novembre : « J’ai rencontré mon mari au Bataclan et mes amis proches vivent en face de La Belle Equipe. »
Pour tous, cette attaque a marqué un basculement dans une nouvelle ère. Les termes « innocence perdue », « insouciance envolée » ou encore « légèreté oubliée » reviennent souvent. « Rien n’a changé, mais tout a changé, parce que l’insouciance est partie », constate Fanny, hôtesse d’accueil de 31 ans, vivant dans la capitale.
Chez les jeunes adultes, les attaques de Paris et de Saint-Denis semblent avoir marqué l’entrée concrète dans l’âge adulte, synonyme de la perte des idéaux. « J’ai grandi avec la certitude profonde que mon pays m’offrirait toujours la garantie de vivre en paix et en sécurité. A 17 ans, j’ai pris conscience que ce constat était illusoire et que ma croyance était naïve », rapporte Marie Foviaux, étudiante en sciences politiques à Lyon, rappelant que sa génération « n’a pas souvenir du 11-Septembre ».
La jeune femme se souviendra du 13-Novembre comme de la date qui a donné naissance à ses premières interrogations sur l’avenir. « S’en suit, irrémédiablement, un changement dans ma manière de me comporter et d’aborder le futur », précise Marie, pour qui les attentats ont conforté son envie de « travailler dans la police ».
Sentiment d’insécurité
Décrite jusqu’ici comme une « génération sans histoire », qui n’a ni connu les deux guerres mondiales ni la guerre froide, qui se souvient à peine de la chute du Mur, la génération des 15-35 ans appréhende désormais de manière palpable ce que constitue d’insécurisant la menace d’une attaque sur son sol. D’autant que, durant cette année écoulée, les attentats du 13-Novembre se sont inscrits dans une longue série d’attaques. Au total, huit attentats ont été commis sur le territoire national ou à l’étranger, causant la mort de 230 Français – un nombre inégalé de victimes du terrorisme. Durant l’année 2015, puis celle de 2016, la liste des villes touchées s’est allongée, le parcours des suspects s’est complexifié, le profil des personnes visées s’est diversifié, donnant lieu à un sentiment de menace diffus.
« Depuis l’assassinat d’Hervé Gourdel, la tuerie de Charlie Hebdo, la tragique soirée du 13-Novembre et l’attentat de Nice, je pense toujours à un éventuel attentat », confie Francine Jarry, retraitée de 62 ans, vivant dans le 11e arrondissement de Paris.
Les attaques de Paris et de Saint-Denis, et celles qui ont suivi, ont instillé un sentiment d’insécurité endémique. « J’ai perdu un sentiment de sécurité qui ne reviendra sans doute jamais. Quand je vais à un concert, je ne me sens plus comme à la maison. Ma maison est cassée », résume Fanny, qui vit dans le quartier touché par les attentats.
Un climat d’insécurité qui empêche le travail de mise à distance, pourtant nécessaire pour dépasser les peurs qui surviennent à la suite de tels événements. Depuis le 13-Novembre, la menace semble en effet plus concrète. « J’ai peur de plein de choses qui n’avaient aucune importance auparavant », confie Adrien, 18 ans, étudiant en droit à Lyon. « C’est insidieux, ce sont des détails insignifiants, mais le fantôme du terrorisme plane, qu’on le veuille ou non », constate Marie-Pierre Cinelli, 48 ans, responsable d’une boutique dans le Marais, à Paris.
« Un sac trop gros », « le bruit d’une sirène », « quelqu’un qui a l’air hagard dans le métro », « un cri dans la rue », « l’explosion d’un pétard », « le claquement d’un siège au cinéma » constituent autant d’événements anodins qui revêtent désormais la forme d’une menace.
Rationaliser sa peur
D’aucuns rapportent qu’ils ont depuis adopté des « stratégies » pour contourner des peurs trop vives. Francine Jarry, « non-violente dans l’âme », s’est par exemple acheté une bombe lacrymogène pour se défendre en cas d’attaque. Pierre, informaticien genevois de 37 ans, qui avait l’habitude de se rendre à Paris pour des concerts, a mis un terme à ces séjours dans la capitale, de la même manière qu’il évite désormais de voyager dans des grandes villes européennes.
A l’instar de nombreux internautes qui ont répondu à notre appel à témoignages, Julien Lauriol, 28 ans, repère les issues de secours dès qu’il entre dans un lieu public clos. Lorsqu’elle voyage en France, Magali prend désormais la voiture et se contraint à de grands détours pour éviter Paris. Une attitude contre-productive selon de nombreux psychologues, qui rappellent que ce type d’événement, imprévisible, ne possède aucun schéma repérable.
D’autres évoquent l’ambivalence du sentiment « d’habituation », à la fois salutaire et culpabilisant. « La vie, le quotidien, reprennent le dessus avec une banalité déconcertante », témoigne une jeune femme de 23 ans. « L’être humain a cette caractéristique aussi utile qu’effrayante : il s’habitue à tout. Je me suis habituée aux menaces sur nos rassemblements, aux militaires dans les centres commerciaux et aux fouilles lors des événements », constate Margaux Voglet, 22 ans, étudiante en management du tourisme à Namur, en Belgique.
Face à ce sentiment d’insécurité, les spécialistes conseillent « la rationalisation » de l’événement. Une posture adoptée par certains témoins, comme Véronique, étudiante de 23 ans, vivant à l’étranger : « Quand un avion s’écrase, un bateau coule, un train déraille, on n’arrête pas pour autant les transports en commun. »
Le risque étant que certaines personnes, pour s’épargner de trop grandes angoisses, adoptent une posture de déni, comme ne plus du tout écouter les informations. « Depuis le 13-Novembre, je refuse de regarder les médias, quels qu’ils soient », rapporte Joëlle, 47 ans, responsable commerciale dans une compagnie d’assistance à Paris.
Cette réaction de repli est constatée par de nombreux psychologues. Lors d’une attaque comme celle-ci, les personnes visées vont chercher, dans le meilleur des cas, à se recentrer sur la sphère de l’intime. A la suite des attentats du 13-Novembre, les parents de Marie-Astrid ont créé un groupe Facebook regroupant ses quatre frères et sœurs, dispersés aux quatre coins de la France. « De cette façon, nous restons en contact à tout moment, et nous sommes plus soudés que jamais », s’enthousiasme la jeune femme de 24 ans. « Je ressens la nécessité de recentrer mon temps et mes préoccupations sur les choses essentielles », confie, pour sa part, Julien Lauriol, travaillant dans le marketing, à Saint-Nom-la-Bretèche (Yvelines).
Matt, designer parisien de 35 ans, évoque lui aussi l’effet « sonnette d’alarme » des attentats de Paris et de Saint-Denis, « mais dans le sens positif du terme ». Il a transformé son sentiment de menace en une incitation à vivre pleinement. « Soudain, l’urgence d’aimer, de le dire, d’oublier les querelles. Sortir la tête de mon téléphone et des réseaux sociaux qui rendent malheureux. Vivre, manger, sortir, faire la fête », énumère le jeune homme, qui, en guise d’exemple le plus éloquent, précise qu’il a décidé de se pacser.
Une injonction à changer
Pour d’autres, le 13-Novembre a servi d’électrochoc, interrogeant trajectoires professionnelles et citoyenneté. A 31 ans, une professeure d’histoire-géographie dans l’est de la France a constaté que les attentats ont donné lieu à « de nouveaux questionnements plus poussés » de la part de ses élèves :
« Certains sujets deviennent plus durs à traiter : la loi Badinter, la tolérance religieuse ou la laïcité. Comment trouver les mots au lendemain de tels actes ? Comment contrer les théories du complot ? Nous sommes peu armés pour traiter cela. »
La jeune femme, qui regrette l’absence de ligne directrice de la part de l’éducation nationale pour aborder ce genre de questions, précise être devenue « moins tolérante » envers les remarques de ses élèves sur la laïcité ou sur le complotisme, donnant à ses cours « un cadrage plus axé sur les valeurs de la République ».
Dans des cas plus rares – mais non négligeables –, les attentats n’ont pas simplement conduit à une redéfinition des pratiques professionnelles, mais à un changement de cap radical. Après les attentats, Charlotte Marchalant, journaliste de 33 ans, a choisi de quitter Paris pour déménager à Nantes en juillet dernier, « après six mois à subir sa vie ».
Les attentats de Paris et de Saint-Denis ont ravivé de vieilles angoisses qu’elle pensait guéries – justement, depuis son arrivée dans la capitale. Les trajets interminables de métro durant lesquels elle changeait régulièrement de rame, les CRS croisés sur son chemin et son trajet quotidien la contraignant à passer devant la place de la République et ses bougies ont eu raison de son amour indéfectible pour Paris.
Si elle rassure ses proches en leur disant qu’une opportunité s’offrait à elle – ou plutôt à son conjoint –, la jeune femme confie qu’elle ne serait « jamais partie si sa ville fantasmée n’avait pas viré au cauchemar ». Aujourd’hui, malgré une situation professionnelle balbutiante, elle ne regrette pas son choix : « Je subis moins. Je pleure moins. Même si la tristesse reste là. »
Emmanuelle, elle, s’est installée plus au sud, à Bordeaux, où « l’innocence des gens » la protège. Elle aussi confirme que sa tristesse « ne partira pas comme ça », mais pour cette conseillère en ressources humaines, qui travaillait à la Défense et vivait en face d’un bar visé par les terroristes, ce déménagement a été salvateur, en ce sens qu’il a créé une distanciation lui permettant de reprendre « une vie normale ».
Sandrine, elle, a démissionné de son travail dont elle se plaignait continuellement, troquant au passage sa foi chrétienne pour « des valeurs humanistes ». Le 13-Novembre a aussi constitué un sursaut citoyen, comme chez Didier Laurent, pour qui « l’autre est devenu un essentiel » :
« Depuis six mois, nous accueillons un migrant sous notre toit, et tout se passe bien ici. Les gens heureux ont toujours raison. »