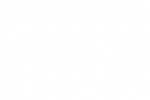Fragile domino autrichien

Fragile domino autrichien
Editorial. Les Autrichiens doivent décider dimanche 4 décembre si, pour la première fois en Europe depuis la guerre, ils élisent au suffrage universel un président de la République issu d’un parti d’extrême droite.
Affiches de campagne du candidat indépendant, l’écologiste Alexander Van der Bellen, et de celui du FPÖ, Norbert Hofer, à l’élection présidentielle autrichienne du 4 décembre. | © Heinz-Peter Bader / Reuters / REUTERS
Editorial. C’est la deuxième élection de ce dimanche 4 décembre, celle du président de la République autrichien. Le scrutin est largement occulté par le référendum convoqué le même jour par le premier ministre italien, Matteo Renzi : une victoire du non pourrait sceller le départ de M. Renzi, ouvrir les portes du pouvoir au mouvement populiste 5 étoiles de Beppe Grillo en Italie et relancer la crise de l’euro. En outre, la campagne autrichienne a trop duré : une première élection, celle du 22 mai, a été annulée en juillet par la Cour constitutionnelle autrichienne pour cause de négligences dans le dépouillement, tandis qu’un nouveau scrutin prévu en octobre a dû être reporté pour cause de bulletins de vote défaillants.
Il n’empêche, l’enjeu de dimanche est décisif : les Autrichiens doivent décider si, pour la première fois en Europe depuis la guerre, ils élisent au suffrage universel un président de la République issu d’un parti d’extrême droite. Les sondages sont au coude à coude, dans un scrutin qui oppose Norbert Hofer, 45 ans, issu du Parti libéral d’Autriche (FPÖ), au candidat indépendant, l’écologiste Alexander Van der Bellen : âgé de 72 ans, ce dernier avait gagné en mai d’un cheveu le scrutin invalidé.
Les causes de cette possible victoire de l’extrême droite sont nombreuses. D’abord, le FPÖ, parti allié de Marine Le Pen, a réussi sa dédiabolisation et participé au pouvoir, avec les conservateurs au début du siècle, mais aussi, au niveau régional, avec les sociaux-démocrates. Il a fallu qu’une rescapée d’Auschwitz s’invite dans le débat pour que soient rappelées les origines nazies du FPÖ.
Sentiment de balkanisation
Ensuite, l’Autriche vit le syndrome de ces pays devenus petits, qui s’étaient habitués à la prospérité et à l’entre-soi. Son entrée en 1995 dans l’UE, après la chute du rideau de fer et avant l’élargissement, l’avait replacée au cœur de l’Europe. Mais ces événements ont aussi changé son identité. L’Autriche est l’un des pays qui accueillent le plus d’immigrés de la première génération. En 2015, elle n’a pas simplement été un pays de transit pour les réfugiés empruntant la route des Balkans, mais aussi une destination : par habitant, l’Autriche accueille plus de réfugiés que l’Allemagne. A quoi s’ajoute le basculement autocratique du président Erdogan en Turquie, après le coup d’Etat manqué de l’été : il n’en fallait pas tant pour attiser la peur ancestrale du Turc, largement partagée dans un pays réticent depuis toujours à l’adhésion de la Turquie à l’UE.
Economiquement, l’Autriche apparaît prospère, mais une partie de la population ne le vit pas ainsi : certes le chômage y est l’un des plus bas d’Europe, mais il monte. Et le pays se sent décrocher face à l’Allemagne, alors qu’il était plus prospère qu’elle au tournant du siècle. Conséquence, l’Autriche, qui ressemblait à la Suisse, éprouve un sentiment de balkanisation. L’extrême droite a mené une campagne anti-Merkel et anti-européenne, dont on voit mal l’issue positive pour un pays enclavé.
L’élection du président, à l’autorité relativement limitée, même si des abus de pouvoir ne sont pas à exclure, ouvrirait la voie à un gouvernement FPÖ. L’Autriche serait le premier pays du bloc de l’Ouest à basculer dans l’« illibéralisme », après la Hongrie de Victor Orban, la Pologne de Jaroslaw Kaczynski et la Slovaquie de Robert Fico. Sa victoire constituerait un échec de plus pour l’Europe et ne manquerait pas d’encourager Marine Le Pen. Elle n’est pas inéluctable.