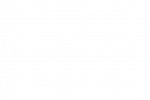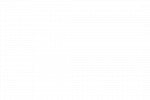Roman geek, polar et noblesse russe : nos idées de lecture

Roman geek, polar et noblesse russe : nos idées de lecture
Chaque jeudi, « Le Monde des livres » vous donne ses conseils de lecture.
Au menu ce jeudi : la dissection historique de la noblesse russe dans la société soviétique par Sofia Tchouikina, le troisième roman traduit en français de Victor del Arbol et l’univers romanesque en forme de jeu de Nicolas Dickner.
Roman geek : « Six degrés de liberté », de Nicolas Dickner
D’un côté, un personnage de pirate informatique ; de l’autre, un garçon et une fille qui tentent de mettre au point un conteneur intelligent et « habitable ». Six degrés de liberté serait-il un roman geek ? En partie, oui. Mais si les thèmes du hacking et de l’inventivité technologique constituent bien les sujets évidents du roman, le dispositif d’écriture de Nicolas Dickner permet à l’œuvre de déborder largement de ce cadre.
Brique à brique, l’écrivain pose les fondations de son univers romanesque, alterne les lignes narratives, et n’hésite pas à retarder autant que nécessaire l’évocation du voyage de son héroïne en conteneur, comme si écrire était pour lui construire tout un univers en Lego. Autant dire que le lecteur met assez longtemps à comprendre où veut en venir l’auteur. Pourtant, ses efforts sont largement récompensés dès que les pièces commencent à s’emboîter, que la temporalité s’accélère et que les deux récits se rejoignent. Derrière l’alibi geek se dévoile une belle méditation sur les moyens qui s’offrent à chacun pour conquérir un degré de liberté supplémentaire. Et sur l’espace de jeu que toute approche méthodique des problèmes gagne à préserver. En informatique comme ailleurs. Florence Bouchy
Six degrés de liberté, de Nicolas Dickner, Seuil, 320 p., 18 €.
Roman policier : « La Veille de presque tout », de Victor del Arbol
Nous sommes tous coupables. C’est ce que Victor del Arbol affirme livre après livre : la terrible humanité du crime. Dans son troisième roman traduit en français, La Veille de presque tout, le Catalan met en scène une multitude de personnages qui ont (presque) tous tué. Chacun d’entre eux est hanté par ses fantômes ou ses démons, c’est selon.
Complexe est l’histoire, comme toujours chez l’écrivain espagnol. Germinal Ibarra est revenu sur ses terres sauvages galiciennes après avoir résolu une affaire retentissante : la disparition, en Andalousie, de la jeune Amanda Malher, petite-fille d’un riche industriel. Emporté par sa rage, Ibarra a tué le meurtrier. Trois ans après, il est appelé en pleine nuit au chevet d’une femme grièvement blessée. C’est Eva, la mère d’Amanda, qui s’était installée dans ce bout du monde sous une fausse identité pour fuir le passé ou trouver une impossible rédemption. S’engage alors un dialogue sous la forme d’un aller-retour temporel, au cours duquel Ibarra reconstitue un puzzle tragique. L’on y croise un rescapé de la dictature argentine, un jeune artiste schizophrène ou encore un ancien tortionnaire amateur de narcisses blancs…
Une nouvelle fois, le lecteur est emporté dans les méandres du récit de Victor del Arbol, qui sait mieux que quiconque écrire la douleur et la tristesse. La Veille de presque tout, qui a reçu en Espagne le prestigieux prix Nadal, est à la fois un roman noir et un roman intimiste et philosophique sur la solitude des êtres qui errent dans le monde, comme des âmes perdues dans les limbes. Abel Mestre
La Veille de presque tout (La Vispera de casi todo), de Victor del Arbol, traduit de l’espagnol par Claude Bleton, Actes Sud, « Actes noirs », 320 p., 22,50 €.
Histoire : « Les Gens d’autrefois, la noblesse russe dans la société soviétique », de Sofia Tchouikina
Mener le « récit collectif d’une adaptation » : tel est l’objectif de l’historienne Sofia Tchouikina dans son ouvrage sur la noblesse russe dans la société soviétique. La cible est atteinte, d’une manière que l’on n’hésitera pas à qualifier de magistrale, tant ce livre constitue à la fois un plaisir de lecture et un modèle de rigueur et d’inventivité historiennes. L’auteure travaille depuis de longues années sur le devenir, dans la Russie soviétique, de celles et ceux que l’on appela très vite en russe « les gens d’autrefois », expression qui donne son titre au livre. En plus de sa connaissance des nombreuses sources qui lui permettent de retracer les trajectoires des « ci-devant nobles », elle a pu mener dès les années 1990 de nombreux entretiens avec des hommes et des femmes issus de ce groupe social, nés au début du XXe siècle.
Ces échanges ponctuent l’ouvrage et constituent un formidable moyen d’accéder à des faits et à des sentiments qu’un travail classique d’historien n’aurait pas eu le pouvoir de faire émerger : on rêverait de disposer de tels témoignages directs venus de la noblesse française du XIXe siècle pour comprendre la manière dont celle-ci a vécu le bouleversement de son monde après 1789 ! Comme celle-ci, et même beaucoup plus que celle-ci, la noblesse russe de l’ancien régime a connu en quelques mois une transformation brutale de son existence. L’auteure excelle à montrer la manière dont les nobles recyclent des éléments de leur éducation aristocratique, la maîtrise des langues, par exemple, en compétences professionnelles et comment la mémoire familiale fonctionne avec ses silences et ses reconstructions dans des appartements devenus communautaires. Superbe d’un bout à l’autre. Pierre Karila-Cohen
Les Gens d’autrefois, la noblesse russe dans la société soviétique (Dvorjanskaja pamjat’), de Sofia Tchouikina, préface de Nicolas Werth, traduit du russe par Karine Guerre et Katia Pichugina, Belin, « Contemporaines », 400 p., 23,50 € (en librairie le 24 mars)
Histoire : « Le Mythe bolchevik. Journal 1920-1922 », d’Alexandre Berkman
En ces temps d’anniversaire d’Octobre 1917, on lira avec profit le beau témoignage de l’anarchiste Alexandre Berkman. D’origine russe, émigré outre-Atlantique, son activisme l’a conduit, la moitié de sa vie durant, dans des geôles américaines. Libéré et expulsé avec d’autres figures de l’anarchisme, comme Emma Goldman, fin 1919, il parvient en Russie, émerveillé à l’idée de « donner [sa] vie un million de fois au service de la révolution sociale », mais sceptique sur la façon bolchevique de construire l’avenir. Venu de l’étranger, il obtient une relative liberté de circulation, qui l’amène au contact de Russes de toutes conditions et même de Lénine, qu’il juge lui aussi « fanatique ».
Le captivant Journal, qu’il tient à partir de 1920, est ainsi la chronique précise d’une désillusion, fourmillant de détails sur les souffrances des populations en ces années de famine et de pogroms, sur les exactions de la Tchéka, mais aussi sur les débats passionnés parmi les militants, ou les expérimentations artistiques et éducatives d’un Lounatcharski. Cette part lumineuse du livre permet de ne pas réduire la période à sa violence, l’élan révolutionnaire à sa trahison. Cette dernière conduira Berkman à un nouvel exil, après l’écrasement de l’insurrection de Kronstadt. A la veille de la naissance de l’URSS, « la révolution est morte, son esprit hurle dans le vide ». André Loez
Le Mythe bolchevik. Journal 1920-1922 (The Bolshevik Myth), d’Alexandre Berkman, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Pascale Haas, préface de Miguel Abensour et Louis Janover, Klincksieck, « Critique de la politique », 352 p., 23,90 €.