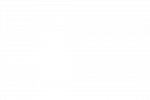Démocratie participative : « Les villes sont devenues les lieux de l’innovation politique »

Démocratie participative : « Les villes sont devenues les lieux de l’innovation politique »
Propos recueillis par Claire Legros (Propos recueillis par)
Pour le sociologue Loïc Blondiaux, c’est à l’échelle municipale que la démarche participative se diffuse le mieux, à la faveur notamment de nouveaux outils.
La participation citoyenne peut-elle transformer la gouvernance des villes ? Pour le sociologue Loïc Blondiaux, professeur au département de sciences politiques de la Sorbonne (Paris-I), où il dirige un master d’ingénierie de la concertation, c’est à l’échelle municipale que la démarche participative se diffuse le mieux, à la faveur notamment de nouveaux outils.
Affiche de la campagne pour le budget participatif de la ville de Grenoble. | Capture d'écran site ville de Grenoble
On constate une effervescence dans le domaine de la démocratie participative. Les villes y tiennent-elles une place particulière ?
D’un point de vue quantitatif, c’est à l’échelle municipale que la démarche participative se diffuse le mieux, et c’est souvent à l’initiative d’élus locaux que les expériences de transitions à la fois écologique, économique et politique sont les plus avancées. Cela participe du déplacement des lieux du pouvoir entre le national et le local.
Les municipalités sont devenues les lieux de l’innovation sociale et politique, car elles disposent des leviers pour susciter la contribution des citoyens. Pour les élus, il existe aujourd’hui un catalogue de techniques et d’outils assez complet, qui va des discussions de groupe jusqu’aux plates-formes de contributions en ligne et aux budgets participatifs, efficaces quand ils font l’objet d’un vrai travail de concertation et de restitution.
Les démocraties traversent une crise majeure de la représentation. Ces outils réussissent-ils à aller chercher ceux qui ne vont plus voter ?
Nos sociétés contemporaines sont confrontées à la fois à la défiance et au silence des catégories populaires qui, pour certaines, ont renoncé à participer, tandis que d’autres se réfugient dans les extrêmes. La fracture, aujourd’hui, se situe entre diplômés et non-diplômés. Pour les premiers, intégrés politiquement et socialement, la participation est normale et devient même une exigence ; pour les seconds, elle présente un coût élevé, symbolique et matériel. Il n’est pas facile de donner son avis quand on a des horaires décalés ou qu’on a le sentiment de ne pas avoir de place dans la société.
La démocratie participative ne fait pas toujours mieux que la démocratie représentative, sauf dans le cadre d’expériences où l’on se donne les moyens d’aller chercher les citoyens des quartiers populaires. Je pense par exemple aux initiatives de l’architecte Patrick Bouchain pour associer très en amont les habitants à des projets de rénovation urbaine, avec des dispositifs inclusifs sur le bâti, l’architecture. Ou aux démarches inspirées du community organizing américain, qui partent des besoins, des ressentis des habitants, sans vouloir débattre a priori d’enjeux qui ne les concernent pas. Ces expériences encourageantes peuvent produire une spirale vertueuse et créer de l’inclusion.
Certaines villes sont plus novatrices dans ce domaine. Quels sont les ressorts de leur dynamisme ?
A l’échelle de l’Europe, on constate deux formes de participation urbaine : d’un côté, les pays scandinaves ont une pratique spontanée et ancienne des relations de concertation et de collaboration entre élus et citoyens. Cette pratique est institutionnalisée et relève presque du réflexe. De l’autre, des pays avancent très vite dans ce domaine parce qu’ils ont été affectés par la crise et connaissent un effondrement des institutions.
C’est le cas de l’Espagne où des collectifs se sont formés pour prendre en charge des aspects de la vie publique que les collectivités ne pouvaient plus gérer. Ces mouvements citoyens ont pris le pouvoir dans plusieurs grandes villes et inaugurent des formes nouvelles de gouvernance. Des laboratoires se mettent en place, comme à Barcelone où la maire, Ada Colau, expérimente un principe de consultation permanente de la population, et de co-construction des politiques publiques.
Comment la participation se met-elle en place dans les villes françaises où le maire reste l’élu qui inspire le plus confiance ?
La culture politique française reste très verticale, l’élu y occupe une place particulière, il est à la fois sacralisé et démonisé. Dans de nombreuses villes, la monarchie municipale n’est pas un mythe et instaure une forte distance entre élus et citoyens. La France est à la fois le pays qui a créé, en 1995, la commission nationale du débat public, un instrument novateur qui n’a pas d’équivalent ailleurs et dont la mission est de faire en sorte que le point de vue des citoyens soit pris en compte sur les projets d’aménagement du territoire.
Et de l’autre côté, c’est un pays où la culture participative est lente à se diffuser. On en parle beaucoup, peut-être plus qu’ailleurs, mais force est de constater qu’il existe un décalage entre les ambitions affichées et la réalité. La prise de conscience, chez les élus et les techniciens de l’action publique, qu’on ne peut plus prendre des décisions comme avant ne coule pas de source. L’idée qu’un expert de la chose publique a les solutions, qu’il maîtrise les principaux paramètres de décision et n’a pas besoin de l’expertise profane des citoyens, reste très ancrée dans les esprits. C’est en train de changer, mais le processus d’acculturation est lent.
Quelles expériences urbaines menées en France vous paraissent-elles les plus significatives ?
Des métropoles comme Nantes, Paris ou Metz ont fait de la participation une ligne majeure de leur action. Elles mettent en mouvement leurs collectivités pour les soumettre à cette exigence.
Deux expériences singulières sont à suivre de près : l’agglomération de Grenoble met en œuvre des instruments nouveaux, sans comparaison ailleurs en France, comme le droit de pétition – 2 000 citoyens peuvent inscrire une mesure à l’ordre du jour pour qu’il y ait votation. Et la petite ville de Saillans, dans la Drôme, inaugure une forme de représentation avec sa « liste collégiale » qui travaille étroitement avec les habitants.
Quelles sont pour vous les points communs des initiatives les plus efficaces ?
D’abord la volonté politique. Sans elle, rien n’est possible, car la démarche est longue et complexe à diffuser dans une collectivité. Une cohérence et une affirmation forte de cet impératif par le binôme cabinet-maire sont indispensables, pour autant que les élus n’aient pas peur de la participation, qu’ils prennent conscience qu’elle peut améliorer l’efficacité de l’action publique.
L’autre condition pour que cela fonctionne, c’est le professionnalisme. La participation ne s’improvise pas. Il ne suffit plus de mettre des élus et des citoyens dans une même salle pour penser qu’on fait de la démocratie participative ; le résultat dépend largement de la formation, du professionnalisme et de l’éthique des acteurs. Ces deux conditions sont rarement réunies et très fragiles. Il suffit parfois d’une alternance politique pour que des municipalités régressent en quelques mois.
La participation citoyenne est-elle toujours synonyme d’intérêt général ?
Tout dépend de quoi on parle. Réfléchir à la participation citoyenne invite à sortir du mythe de l’intérêt général à la française qui serait toujours du côté de l’Etat, de l’administration, et à le repenser comme une construction collective un processus dans lequel on n’a pas affaire à un seul intérêt général a priori mais à de multiples définitions de l’intérêt général qui se confrontent pour aboutir à un intérêt général reconnu par chacun.
Bien sûr, il y a toujours un risque d’instrumentalisation par des intérêts particuliers. Il faut s’en méfier en permanence et le contrecarrer en renforçant les capacités des organisateurs à imposer la pluralité des points de vue. Mais ce risque existe aussi dans la démocratie représentative : la décision politique est souvent prise en fonction d’intérêts particuliers, économiques notamment, dans le cadre de négociations opaques. La démocratie participative tend à éclairer ces processus de concertation et les rend mieux contrôlables.
De plus en plus d’initiatives viennent des citoyens, qui agissent à leur échelle sans passer par les institutions. Comment ces actions peuvent-elles s’articuler avec celles des élus ?
Les espaces de participation citoyenne, même s’ils sont concédés par les élus, tirent leur légitimité d’une certaine tension, de frottements avec la représentation traditionnelle. Je ne fais pas partie de ceux qui prophétisent la fin de la politique représentative, sauf peut-être à certaines échelles. Mais elle n’est jamais aussi efficace que quand une autre forme de démocratie plus vivante, plus critique, se déploie à l’extérieur des institutions.