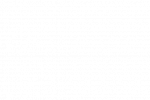James Bond, héros géopolitique

James Bond, héros géopolitique
Par Isabelle Regnier
Un colloque, à l’Institut d’étude des relations internationales à Paris, s’est penché sur le sous-texte diplomatico-stratégique de la saga 007, qui revient avec « Spectre ».
L'acteur Daniel Craig lors de la projection du film "007 Spectre" à Berlin, le 28 octobre 2015. | TOBIAS SCHWARZ/AFP
La James Bond mania bat son plein. Impossible de faire un pas dans la rue sans voir le visage de Daniel Craig associé à une marque de montre. Impossible d’ouvrir un ordinateur sans tomber sur la bande-annonce de 007 Spectre. Impossible d’aller au cinéma sans se voir bombardé de publicités pour l’une ou l’autre des marques partenaires du film. Comme l’air du temps, le 007 nouveau se fond dans le paysage. Il conditionne les esprits, impose son tempo, y compris au sein d’institutions que rien ne relie a priori à la machine James Bond, et qui se font pourtant spontanément le relais de sa promotion.
Vendredi 6 novembre, soit cinq jours avant la sortie officielle du film, s’est ainsi tenu à l’Institut d’étude des relations internationales (Ileri), à Paris, un colloque sur le thème « James Bond : héros géopolitique ? ». Devant un petit amphi plein à craquer, quatre invités se sont succédé au micro – l’historien et journaliste Alexandre Adler, la docteure en littérature Isabelle Safa, le docteur en sciences de l’information Pierre Fayard et l’historien David Vauclair –, pour évoquer le sous-texte géopolitique de ce mythe contemporain qui n’a eu de cesse, depuis un demi-siècle qu’il perdure, de se réinventer au gré des soubresauts de l’Histoire.
Un « mythe compensatoire »
Casino Royale, le premier roman de Ian Fleming mettant en scène James Bond, est publié en 1953. Le premier film, Dr No, sort sur les écrans neuf ans plus tard, en 1962, année de la crise des missiles à Cuba. Pur produit de la guerre froide, cette saga dans laquelle les enjeux internationaux sont réduits à des rapports d’individus (ou de groupes) en a longtemps reflété le climat de menace et de paranoïa. Elle s’inscrit également, et de plain-pied, dans le contexte de la dissolution de l’empire britannique et de ce point de vue, comme l’ont soutenu de concert les quatre intervenants, cet agent secret super-chic, séducteur imparable, tueur hors pair qu’est 007, a longtemps représenté, pour une Grande-Bretagne déboussolée, fraîchement éjectée de sa place au centre de l’échiquier mondial, un « mythe compensatoire ».
James Bond évolue, en effet, dans un monde où l’empire paraît ne s’être jamais dilué. Où qu’il soit, il a des alliés qui le logent, lui fournissent des armes, des renseignements, des invitations à des fêtes, des relations… « L’empire lui fournit tout, soutient Pierre Fayard, parce que l’empire est omniprésent ». Si bien qu’il n’a jamais rien à faire, y compris avec les femmes, qui tombent sous son charme comme si elles étaient prédestinées (Bond, en anglais, veut dire à la fois « lien », et « obligation »).
L’empire dans lequel évolue James Bond, est moins britannique, au fond, que « britannico-yankee » (les Etats-Unis étant représentés dans la saga par le personnage de Felix Leiter, l’ami américain de Bond). Mais si la puissance militaro-financière est américaine, les Britanniques conservent un magistère scientifique et technologique (qu’incarne exemplairement le personnage de Q), et un sens de l’honneur qui leur confère une supériorité morale sur les autres nationalités. Comme le résume David Vauclair, la saga offre une « représentation du “soft power” britannique avec lequel le public est appelé à communier – à grand renfort de parachutes aux couleurs de l’Union Jack, de jeux avec l’image de la reine… – dans un patriotisme bon enfant ».
Héros conservateur
Héros conservateur, qui ramène toujours la situation au statu quo, ce mâle absolu, qui « permet de rêver un monde qui n’est plus », comme le pose Alexandre Adler, incarne l’Occident triomphant. Cela lui a d’ailleurs valu quelques interdictions de séjour, que ce soit dans la Russie de Brejnev, dans l’Algérie de Boumédiène, en Chine, jusqu’en 2006, ou encore en Corée du Nord. Nasser lui-même avait dénoncé son caractère « impérialiste » devant ses députés.
La chute du mur de Berlin a fait chanceler James Bond. Un black-out de six ans sépare ainsi Permis de tuer (1989) de GoldenEye (1995), le suivant, qui inaugura l’ère Pierce Brosnan. Mais cette saga qui avait anticipé la guerre des étoiles de Reagan (dans Moonraker, en 1979) a su s’adapter au nouvel ordre multipolaire, et aux nouvelles menaces dont il était porteur. Ainsi dans Demain ne meurt jamais, 007 se confronte-t-il au pouvoir des grands médias, dans Meurs un autre jour, à Cuba, vestige du bloc soviétique, dans Quantum of Solace, à la question de l’écologie.
Le 11-Septembre a inauguré l’ère plus sombre, introspective et brutale de Daniel Craig, plus correcte politiquement aussi, plus modeste, plus autocritique. Tout en continuant d’incarner une Angleterre pacificatrice, et scientifiquement avancée, l’agent secret donne à voir le sale côté du métier – la torture, la laideur que recouvre l’idée du « permis de tuer »… Désormais, comme conclut Alexandre Adler, « il ne fait plus rêver ».
Un Orient de carte postale
Le 11-Septembre, pour autant, n’a jamais été abordé de front. Pour ne pas se couper des marchés substantiels, en l’espèce de ceux du Moyen-Orient, les producteurs de James Bond éviteraient toujours les sujets clivants, affirme David Vauclair. Les pays désignés comme ennemis dans les films, poursuit-il, comme la Corée du Nord dans Meurs un autre jour, ne représentent jamais d’importants gisements de spectateurs. « Bond s’attaque plus aux fantasmes internationaux, de fait, qu’aux ennemis nationaux. Plutôt que s’aventurer sur un terrain glissant, les producteurs préfèrent revisiter le mythe (Casino Royale), ou désigner un ennemi intérieur (Quantum of Solace). »
L’Orient de James Bond, en outre, n’a jamais rien été d’autre qu’un Orient de carte postale, stéréotypé, totalement dépolitisé. Un monde qui renverrait au paradigme d’Edward Saïd, affirme Isabelle Safa, selon lequel les clichés orientalistes servent la domination de l’Occident, si le recours aux clichés n’était pas si essentiellement ludique, si la mise en scène ne venait pas régulièrement souligner (dans L’Espion qui m’aimait par exemple, quand la musique de Lawrence d’Arabie jette un pont entre Roger Moore et Peter O’Toole, quand un spectacle de son et lumière sur le site de Gizeh devient le décor d’une bataille épique…) que cet Orient n’est rien d’autre qu’un décor de cinéma.
"Spectre" : un James Bond peu inspiré et déjà vu
Durée : 03:43