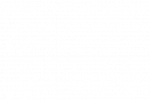En Libye, des Subsahariens déchirés entre besoin d’argent, rêve d’Europe et peur de l’esclavage

En Libye, des Subsahariens déchirés entre besoin d’argent, rêve d’Europe et peur de l’esclavage
Par Frédéric Bobin (Tunis, correspondant)
Dans l’ex-Jamahiriya, les migrants, qu’ils soient de « travail » ou de « transit », sont exposés à tous les abus : enlèvements, extorsions, tortures…
Etre subsaharien à Tripoli, c’est mener la vie d’Omar Hassan, un Nigérien de 36 ans. Nous l’avions rencontré à la mi-juillet. Son camp de fortune, courette de sable bordée d’abris en ciment et de cabanes en bois, était niché sous l’autoroute traversant Bab Ben Gashir, un quartier central de la capitale.
Casquette bleu nuit vissée sur le crâne, Omar Hassan était éboueur. « Je ne suis pas venu en Libye pour passer en Europe, disait-il. Tout ce qui m’intéressait, c’était de trouver un travail. » Son projet était de recueillir un peu de capital pour monter un commerce de textile à Niamey. Assis à ses côtés sous le linge pendant à un fil, les compagnons d’Omar Hassan présentaient un profil assez identique. Il y avait des Nigériens comme lui, mais aussi un groupe de Bangladais.
L’« eldorado » de Kadhafi
A sa manière, la petite communauté de Bab Ben Gashir illustre une dimension de la présence de migrants en Libye occultée par le flux de contrebande d’être humains vers l’Italie : la migration de travail et non la migration de transit. A la veille de la révolution anti-Kadhafi en 2011, ces travailleurs immigrés, attirés par le dynamisme d’une économie alors riche de sa rente pétrolière, ont représenté jusqu’à 700 000 personnes – 10,4 % de la population. Et encore ne s’agissait-il que de ceux qui étaient en situation régulière. En y ajoutant les étrangers non déclarés, le total des immigrés en Libye a oscillé, selon certaines sources, entre 2 et 2,5 millions – autour d’un tiers des habitants du pays.
Dans l’« eldorado » libyen de l’époque, l’offre d’emplois manuels ou qualifiés était abondante. Ainsi, l’essentiel du personnel médical était originaire d’Asie ou d’Europe de l’Est, comme l’avait mis en évidence l’affaire dite des « infirmières bulgares » emprisonnées par Kadhafi.
Les turbulences de la révolution de 2011 ont fait fuir une bonne partie de ces immigrés. Mais nombre d’Africains subsahariens sont restés, ceux qui s’étaient mis à l’abri dans des pays voisins sont revenus, rejoints à partir de 2012-2013 par un courant en plein essor : les candidats à la traversée de la Méditerranée.
En mai, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a identifié et localisé près de 400 000 migrants présents dans le pays. Les responsables de l’OIM reconnaissent toutefois que le chiffre réel est supérieur, se situant probablement dans la fourchette de 700 000 à 1 million de personnes. Si le chiffre est étonnamment élevé au regard de la crise économique libyenne, c’est qu’un nouveau mouvement s’est manifesté : le voyage vers l’Europe.
ballotté de passeur en passeur
Cette migration de transit existait déjà sous Kadhafi, qui en jouait pour faire pression sur les Européens, mais elle mobilisait surtout des ressortissants de la Corne de l’Afrique, notamment des Erythréens et des Somaliens. Le nouveau flux puise désormais en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest. Car l’après-Kadhafi a vu l’émergence de nouveaux acteurs de la contrebande, concurrençant les réseaux établis et prospectant agressivement de nouveaux bassins migratoires. Selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), le Nigeria, la Guinée et la Côte d’Ivoire sont aujourd’hui les trois principaux pourvoyeurs de migrants subsahariens débarquant en Italie par la Libye.
Il en résulte une logique migratoire en pleine mutation. Selon l’OIM, la recherche de revenus en Libye demeure la motivation majoritaire : 58 % des migrants interrogés la tiennent pour leur « pays de destination ». Cette migration de travail mobilise surtout les ressortissants de pays voisins de la Libye, en particulier l’Egypte, le Tchad et le Niger, la relative proximité favorisant de fréquents retours au pays. Sous ses tôles de Bab Ben Gashir, le Nigérien Omar Hassan s’inscrit pleinement dans cette dynamique qui s’apparente à une migration intra-africaine. Mais les choses évoluent. La frontière entre « migration de travail » (en Libye) et « migration de transit » (vers l’Europe), qui n’a certes jamais été d’une étanchéité absolue, tend à se brouiller davantage.
Une double raison explique cette porosité croissante. En premier lieu, le basculement géographique vers l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest des réseaux d’acheminement de migrants vers l’Europe s’est accompagné d’un bouleversement du modèle économique. A l’époque – sous Kadhafi – où la Corne de l’Afrique en était la source principale, les circuits étaient intégrés : paiement unique, filière de passeurs homogènes et traversée rapide de la Libye.
Mais, depuis 2011, la dérégulation du « marché » vers l’Ouest africain s’est traduite par une fragmentation des circuits, et donc par leur fragilisation : le migrant est ballotté de passeur en passeur au fil d’une odyssée de plus en plus segmentée, l’exposant de manière dramatique à tous les abus, tels les enlèvements, les extorsions, les tortures, voire la réduction en esclavage, ainsi que l’a récemment documenté un reportage de CNN.
Des autorités sous pression
Pour ceux qui arrivent à échapper au pire, la nécessité de financer le reste de leur traversée de la Libye demeure une préoccupation quotidienne. Du coup, le « migrant de transit » devient de plus en plus un « migrant de travail », surtout dans un contexte où les autorités libyennes, sous pression européenne, rendent de plus en plus difficile l’embarquement vers l’Italie.
L’autre raison du brouillage entre les deux dynamiques est, en sens inverse, l’évolution de la « migration de travail » vers la « migration de transit ». Devant la montée des difficultés économiques et l’essor de la violence dans les villes, un nombre croissant de travailleurs immigrés cherche en effet à quitter la Libye. Omar Hassan en est l’exemple type.
Pour lui, tout avait pourtant plutôt bien commencé. Arrivé en Libye en 2010, il avait trouvé un emploi dans une entreprise de collecte de déchets, un secteur qui emploie de très nombreux Nigériens. Le travail était pénible, mais il présentait un avantage : de ses sorties, Omar Hassan ramenait de multiples ustensiles ou biens alimentaires susceptibles d’être recyclés.
Dans sa courette de Bab Ben Gashir aux allures de capharnaüm, on pouvait ainsi repérer un radiateur rouillé ou un frigidaire transformé en armoire. Dans un coin s’entassait aussi du pain rassis voué à être vendu à des propriétaires de poulaillers. Le détail a cessé d’être secondaire. C’est qu’il n’y a plus de petits revenus d’appoint quand il s’agit de survivre dans une Libye plongée dans la régression économique.
A l’époque, Omar Hassan n’avait pas été payé depuis cinq mois par son employeur, qui lui expliquait que ses clients n’honoraient plus leurs factures. « La situation devient de plus en plus difficile ici », se lamentait-il. Il rapportait que sur les 40 Nigériens qui travaillaient à ses côtés dans son entreprise, « trente [étaient] rentrés au pays ». Et lui qui n’avait jamais envisagé de quitter la Libye, voilà qu’il en nourrissait le dessein. « Si je n’ai pas assez d’argent pour rentrer au Niger, expliquait-il, j’essaierai alors de m’embarquer pour l’Europe. »
Mais Omar Hassan n’est toujours pas parti. Il demeure bloqué dans son bric-à-brac de Bab Ben Gashir. Nous l’avons joint, mercredi 22 novembre, au téléphone. Il nous a expliqué qu’il avait quitté son emploi d’éboueur, échaudé par les salaires non versés, et qu’il avait trouvé un autre travail : trois fois par semaine, il va nettoyer un magasin en ville.
Exploiteurs et esclavagistes
Telle est la Libye : en dépit du chaos économique, il reste toujours des petits boulots à grappiller pour les migrants, car les Libyens, élevés dans l’âge d’or de la rente pétrolière, continuent à rechigner aux tâches jugées les plus ingrates. Lorsqu’on traverse les villes de la Tripolitaine (Libye occidentale), de Zouara à Misrata en passant par Sabratha, Tripoli ou Khoms, on ne cesse de voir ces Subsahariens ramasser les poubelles, carrosser les routes, s’échiner sur les chantiers de construction ou manier le chalumeau dans un atelier de soudure.
On les voit aussi agglomérés aux carrefours des cités, assis en tailleur dans l’attente qu’une voiture d’un employeur s’arrête leur faire une proposition. Quand ils sont choisis pour une tâche, ils savent qu’ils n’ont aucun droit. Ils peuvent tomber sur des Libyens plutôt bienveillants qui vont honorer leurs promesses financières. Comme ils peuvent basculer dans les griffes d’exploiteurs ou, dans le pire des cas, d’esclavagistes.
Dans les jours qui ont suivi la diffusion du reportage de CNN, Omar Hassan a été interpellé par des Libyens dans le magasin où il travaille désormais. « Ils m’ont demandé : “Pourquoi vous, les Africains, vous racontez toutes ces histoires de ventes d’esclaves ?” » La question a été apparemment posée de bonne foi. Nombreux en effet sont les Libyens qui ignorent sincèrement la persistance de ces pratiques d’un autre âge. « Pourtant, tout ça est bien vrai », a insisté Omar Hassan au téléphone.
La crainte d’être enlevé est d’ailleurs sa hantise quotidienne, alors que la criminalité s’aggrave chaque jour davantage à Tripoli. Il y a un mois, les Bangladais du baraquement de Bab Ben Gashir ont été kidnappés. Des hommes avaient frappé à la porte. Les Bangladais ont ouvert. Les visiteurs se sont présentés comme des employeurs cherchant de la main-d’œuvre. Les Bangladais ont accepté, ils sont montés dans leur voiture. Mal leur en a pris. Ils venaient d’être enlevés.
« Ils ont été détenus un mois, raconte Omar Hassan. Leurs familles au pays ont dû payer 3 500 dollars pour leur libération. » Depuis, Omar se fait le plus discret possible. Il ne marche plus dans la rue : « C’est trop dangereux. » Il peut être approché à tout moment par ce que les migrants appellent les « Asma Boys », ces garçons des rues qui attirent les Subsahariens en les interpellant : « Asma ! Asma ! » (« Ecoute ! Ecoute ! »).
En général, l’affaire se termine mal : les « Asma Boys » dépouillent leurs victimes de leur argent de poche ou de leur téléphone mobile. Mais avec l’aggravation des difficultés économique du pays, les « Asma Boys » ont tendance à céder la place à des réseaux professionnels de kidnappeurs. « Maintenant, certains Libyens ont tellement besoin de manger qu’ils attrapent les étrangers dans la rue pour leur extraire de l’argent. » Par précaution, Omar Hassan circule donc à vélo. Il se sent moins vulnérable qu’à pied. Combien de temps cette vie-là va-t-elle continuer ? « Je veux quitter la Libye, il y a trop de bandits ici, dit-il. Mais je ne sais pas comment. »