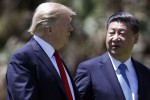En Tunisie, « le risque d’une dérive autoritaire »

En Tunisie, « le risque d’une dérive autoritaire »
Pour les chercheurs d’ICG, Michaël Ayari et Issandr El-Amrani, le pouvoir tunisien doit parachever la transition démocratique sept ans après la chute de Ben Ali.
Des forces spéciales tunisiennes montant la garde à Ettadhamen, le 14 janvier 2018. / FETHI BELAID/AFP
Tribune. La Tunisie connaît un nouvel épisode de contestation et de violence sociale. Le dernier en date, celui de janvier 2016, avait contribué à écourter la durée de vie du gouvernement de Habib Essid, remplacé par l’actuel premier ministre, Youssef Chahed, en août 2016. Si le sentiment diffus est celui d’un bis repetita, le contexte est plus délicat et les aboutissements plus incertains.
L’euphorie révolutionnaire qui a suivi le départ de Zine El Abidine Ben Ali, le 14 janvier 2011, n’est désormais plus qu’un vague souvenir. La realpolitik, l’inertie administrative et le marasme économique ont transformé les espoirs en désillusion, voire en résignation.
Le pays semble prisonnier d’une transition sans fin qui affaiblit l’Etat et le fait dériver vers l’autoritarisme. Les fondamentaux économiques se dégradent, les pouvoirs publics rompent progressivement avec leur politique d’achat de la paix sociale – près de la moitié du budget de l’Etat est, en effet, consacré au paiement des salaires dans la fonction publique.
« Fuite en arrière »
Les décideurs politiques font face à une tâche très délicate à un moment où le doute s’installe quant à l’efficacité de la démocratie à relever les défis. Ils doivent mettre en œuvre une Constitution adoptée en janvier 2014, alors que l’élan révolutionnaire suscité par ledit « printemps arabe » s’essouffle (percée fulgurante de l’Etat islamique en Syrie et en Irak à partir de 2013, coup d’Etat en Egypte en juillet 2013, éclatement de la guerre civile en Libye en juillet-août 2014). Il leur incombe aussi de maintenir tant bien que mal une coalition qui permet de réduire la polarisation entre pro et anti-islamistes, mais dont le fonctionnement plutôt opaque cristallise l’opposition des « révolutionnaires » et des nostalgiques du régime autoritaire. En outre, ils doivent également gérer les problèmes sécuritaires, mais surtout économiques, qui menacent la stabilité du pays.
La classe politique estime devoir trouver rapidement des solutions de court terme, quitte à recourir à celles déjà mises en œuvre sous l’ancien régime. Cette « fuite en arrière » est alimentée par la nostalgie d’un pouvoir exécutif solide et homogène sur le plan idéologique, capable de prendre des décisions expéditives.
Elle vise en particulier à renouer avec l’hyperprésidence, mesure justifiée par le caractère réputé artificiel (non adapté à la culture politique tunisienne) et dysfonctionnel des institutions créées dans le sillage de la révolution de 2010-2011. Selon les partisans de ce retour de l’ancien régime, la greffe démocratique ne prendrait pas, comme l’attesterait la dispersion des centres de pouvoir, la corruption des politiciens et leurs débats stériles.
La tentation de la « restauration »
Les responsables politiques n’ont pas encore cédé à cette tentation autoritaire, redoutée par plusieurs analystes internationaux et qualifiée de « restauration » par de nombreux militants de la société civile. Ce terme réapparaît en effet pour décrire la banalisation des discours qui assimilent la démocratie à la faillite de l’Etat, à la montée de la corruption et de la paupérisation ainsi qu’au retour de plusieurs figures de l’ancien régime à des postes de décision politiques et administratifs.
Revenir au régime de Ben Ali paraît peu réaliste étant donné les nombreuses divisions socio-économiques, politiques et administratives, et le retour de la liberté d’expression depuis 2011.
Quoi qu’il en soit, hypertrophier le pouvoir exécutif et parvenir à renouer avec la gouvernance autoritaire serait loin d’être une solution aux défis économiques et sécuritaires structurels auxquels le pays fait face. Cela engendrerait, au contraire, davantage de tensions politiques et sociales. Le pays entrerait dans une spirale de répression visant à créer un climat de peur auprès de l’opposition et de la société civile. La liberté d’expression serait réduite, ce qui rendrait les décideurs politiques moins réactifs aux problèmes de larges pans de la population, dont le niveau de vie se détériore, ce qui renforce leur sentiment de discrimination sociorégional et les rend davantage susceptibles de se soulever contre l’Etat.
Incertitude électorale
La Tunisie entre dans une période d’incertitude électorale. Les élections municipales doivent se tenir en 2018 et les scrutins législatifs et présidentiel en 2019. La coalition actuelle, qui peut théoriquement céder la place à une nouvelle majorité, devrait accélérer les réformes prévues par la Constitution tout en renforçant les conditions d’une alternance politique pacifique.
Pour faire face à tout événement imprévu (attentats, vacance provisoire ou définitive de la présidence de la République) dans ce contexte de montée des tensions sociales, il est nécessaire de mettre en place la Cour constitutionnelle dans les plus brefs délais, de créer les instances constitutionnelles indépendantes sans les vider de leur contenu, d’organiser les élections municipales en 2018 et, dans l’immédiat, d’assurer le bon fonctionnement de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) chargée d’organiser ces scrutins, à l’instar des législatives et de la présidentielle en 2019.
Enfin, pour ne pas avoir à osciller brutalement entre austérité et achat de la paix sociale, des réformes ambitieuses devraient viser à rendre l’économie plus inclusive, ce qui favoriserait la création de richesses dans les régions déshéritées et non le partage, le plus souvent injuste, des ressources clientélistes – notamment les emplois publics – qui tendent à se raréfier.
Moins attrayant qu’une rupture brutale que nostalgiques de la révolution du 14 janvier 2011 ou de l’ancien régime appellent de leurs vœux, ce programme est nécessaire pour maintenir le cap vers l’idéal démocratique et, surtout, éviter un dénouement violent à l’image de celui qu’ont subi d’autres pays de la région.
Par Michaël Ayari, analyste, et Issandr El-Amrani, directeur du projet Afrique du Nord du cercle de réflexion International Crisis Group (ICG).