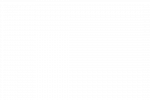Négociations sur la Syrie : « un dernier espoir pour la paix » ?

Négociations sur la Syrie : « un dernier espoir pour la paix » ?
Par Marc Semo
Des pourparlers intersyriens entre régime et opposition doivent se tenir à Vienne les 25 et 26 janvier sous l’égide de l’ONU, et à Sotchi les 29 et 30 janvier à l’initiative de la Russie. Décryptage des deux initiatives.
Les chancelleries comme les experts conviennent tous de l’impossibilité d’une solution militaire au conflit qui ravage la Syrie depuis 2011. Une issue politique et négociée de cette guerre qui a fait au moins 350 000 morts et 11 millions de réfugiés ou déplacés, soit plus d’un Syrien sur deux, reste néanmoins toujours aussi incertaine.
La lutte contre l’organisation Etat islamique (EI), priorité de la coalition occidentale, avait fait passer au second plan les autres conflits dans le conflit, qui risquent de devenir de plus en plus incontrôlables après la défaite des djihadistes. L’offensive lancée par l’armée turque contre l’enclave kurde syrienne d’Afrin en est un premier signe.
Une longue séquence diplomatique s’ouvre le 25 et 26 janvier pour une relance des pourparlers intersyriens, entre régime et opposition, sous l’égide de l’ONU à Vienne, au lieu de Genève comme à l’accoutumée pour raison logistique. A la fin du mois, les 29 et 30 janvier, doit se tenir à Sotchi, au bord de la mer Noire, la réunion du « congrès pour la paix » organisé par la Russie, qui, déjà, il y a un an, avait parrainé le processus dit d’Astana avec la Turquie et l’Iran. Ces initiatives sont à la fois complémentaires, mais aussi potentiellement concurrentes. Décryptage.
Qu’est-ce que le processus de Genève ?
Nul ne se fait trop d’illusions sur les résultats des deux jours de pourparlers qui s’ouvrent à Vienne jeudi 25 janvier. « C’est une phase très, très critique », a reconnu l’émissaire onusien pour la Syrie, Staffan de Mistura, qui chapeaute les discussions. « Il n’y a aujourd’hui aucune perspective politique qui se présente, sauf – et c’est le dernier espoir – la réunion qui va se tenir à Vienne sous l’égide des Nations unies », a souligné le ministre français des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, évoquant « un dernier espoir pour la paix ». Les huit précédents tours de négociations, dont le dernier en décembre, s’étaient soldés par un échec. Le processus de Genève est néanmoins le seul pleinement reconnu comme légitime, y compris par le régime, même s’il fait tout pour le saboter.
Amorcé dès 2012, il est resté longtemps au point mort. Deux poids lourds de la diplomatie onusienne, l’ancien secrétaire général de l’ONU Kofi Annan et le diplomate algérien Lakhdar Brahimi, nommés successivement émissaires spéciaux pour la Syrie, ont l’un après l’autre jeté l’éponge. Leur mission était de « faire cesser les violences et les violations des droits humains et promouvoir une solution pacifique de la crise syrienne ». Le diplomate italo-suédois Staffan de Mistura a pris le relais en 2014 et il a été maintenu dans ses fonctions par le nouveau secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.
Le processus a réellement démarré en décembre 2015 par l’adoption à l’unanimité du Conseil de sécurité de la résolution 2254, la première sur la Syrie. Maîtresse du jeu depuis son intervention militaire à l’automne 2015 qui sauva le régime, la Russie s’inquiétait déjà alors du risque de l’enlisement dans une guerre sans fin. John Kerry, le secrétaire d’Etat américain, et son homologue russe, Sergueï Lavrov, s’étaient accordés sur une feuille de route très précise prévoyant à la fois l’instauration d’un cessez-le-feu, l’acheminement des aides humanitaires pour les zones assiégées et des pourparlers entre le régime et l’opposition pour l’instauration d’une « gouvernance crédible, inclusive et non sectaire », l’élaboration d’une nouvelle Constitution, puis la mise sur pied d’élections « avec le niveau le plus élevé de transparence sous la supervision des Nations unies ».
Mais la question centrale reste celle de l’organisation du pouvoir et de l’avenir de Bachar Al-Assad. La résolution 2254 reste encore maintenant la référence pour toute solution politique du conflit syrien. Mais elle ne fixe pas quel sera le sort de Bachar Al-Assad, l’une des principales raisons du blocage.
Pourquoi Genève patine ?
Le seul succès de Staffan de Mistura est d’avoir réussi à maintenir en vie ce processus, même s’il est dans le coma : il demeure le seul cadre pour une solution politique que toutes les grandes puissances appellent – au moins en parole – de leurs vœux.
Les pourparlers de Genève sont, selon le mot de l’émissaire de l’ONU, « des négociations de proximité ». Lui ou ses collaborateurs reçoivent tour à tour les deux délégations ou font la navette entre les deux, car jamais le régime n’a accepté de discuter en face à face avec l’opposition qui, elle, y est prête.
« La rencontre de Vienne sera un nouveau test. Moscou a échoué à contraindre le régime à s’engager dans la négociation », souligne Nasser Hariri, le président de la Commission syrienne des négociations, qui regroupe désormais la quasi-totalité des composantes de l’opposition syrienne, y compris les plus modérées vis-à-vis d’Assad et des partis kurdes.
Seul le PYD (Parti de l’union démocratique), hégémonique au Rojava, le Kurdistan syrien, et organiquement lié au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, le parti des rebelles kurdes de Turquie), reste en dehors. L’opposition syrienne l’accuse d’entretenir des relations pour le moins ambiguës avec le régime.
Le principal point d’achoppement des discussions reste le destin de Bachar Al-Assad. Pour le régime comme pour ses protecteurs russe et iranien, il doit rester au pouvoir, même si Moscou laisse entendre qu’une fois garantie la pérennité du régime et de l’Etat, il pourrait être remplacé. Pour l’opposition et ses soutiens occidentaux, notamment Paris, Londres et Washington, si le départ du dictateur n’était pas un préalable à l’ouverture des négociations, « le boucher de Damas » ne peut incarner l’avenir de son peuple. Telle était la problématique lors du premier round de pourparlers en mars 2016. Près de deux ans plus tard, rien n’a vraiment bougé.
De quels moyens de pression dispose la communauté internationale pour relancer les pourparlers ?
L’épuisement des belligérants, quand aucune victoire n’est possible pour un camp ou un autre, est un facteur qui, dans tout conflit, joue en faveur d’une solution négociée. Les conditions sont loin d’être réunies en Syrie. L’opposition se refuse encore à admettre pleinement qu’elle a perdu la guerre, même si ses bastions se sont réduits comme peau de chagrin : la zone d’Idlib au nord-ouest, autour de Djarabulus au nord, Deraa au sud et des zones assiégées dans la Ghouta orientale près de Damas.
Le régime, lui, est convaincu d’avoir gagné, même s’il s’agit en bonne part d’un trompe-l’œil. Rien n’aurait été possible sans l’aide au sol de dizaines de milliers de combattants étrangers encadrés par l’Iran, des gardiens de la révolution directement ou des volontaires chiites venus d’Afghanistan avec la bénédiction de Téhéran, du Liban au travers du Hezbollah et d’Irak.
Rien n’aurait été possible non plus sans l’aide de l’aviation russe, qui a beaucoup plus ciblé la rébellion que les djihadistes de l’EI. Le régime contrôle certes la Syrie dite « utile » au centre, mais à peine plus de 50 % du territoire. La moitié de la population seulement vit dans les territoires contrôlés par Damas, et le reste est déplacé ou exilé. Les zones pétrolifères à l’est sont aux mains des forces kurdes alliées de la coalition occidentale anti-EI.
L’autre question cruciale sera celle de la reconstruction, dont le montant est évalué au bas mot entre 300 et 500 milliards de dollars (entre 240 et 400 milliards d’euros). Les parrains du régime, l’Iran et la Russie, n’ont guère les moyens de garantir les investissements nécessaires. Le PIB de la Russie reste plus ou moins équivalent à celui de l’Italie. Les Occidentaux, à commencer par les Américains, dont la stratégie sur la Syrie après l’élection de Donald Trump était restée longtemps illisible, et les Français comptent utiliser à plein ce levier pour tenter d’imposer un véritable processus de transition.
Les Russes sont aussi conscients de la fragilité de l’apparente victoire du régime et font pression pour qu’il accepte de rentrer dans la logique de négociations de paix. « Les conditions sont réunies pour un règlement politique du conflit sous l’égide de l’ONU », avait lancé Vladimir Poutine à Bachar Al-Assad lors de sa visite surprise le 11 décembre sur la base de Hmeimim, le cœur du dispositif militaire russe en Syrie. Une phrase qui sonnait comme une mise en demeure.
Que veulent les Russes avec la conférence de Sotchi ?
Le « Congrès de paix intersyrien » à l’initiative de Moscou et de Téhéran, alliés du régime de Damas, et d’Ankara, soutien des rebelles, prétend réunir à Sotchi, les 29 et 30 janvier, « tous les principaux acteurs régionaux et internationaux », y compris les Kurdes, malgré les réticences de la Turquie.
C’est l’aboutissement d’une montée en puissance diplomatique de Moscou sur la Syrie amorcée depuis un an. La Russie retrouve son rang de grande puissance à même de jouer jeu égal avec les Etats-Unis. Mais cela veut dire être capable de transformer en victoire politique le succès militaire de l’intervention de l’automne 2015, menée avec au plus 5 000 hommes et dont l’apogée fut la reconquête de la partie orientale d’Alep, bastion de la rébellion, en décembre 2016.
Quelques jours plus tard, le Kremlin annonce un cessez-le-feu pour le 30 décembre, sous son parrainage et celui de l’Iran côté régime, et de la Turquie, soutien de la rébellion. Et, dans la foulée, l’organisation, le 23 janvier 2017 à Astana, capitale du Kazakhstan, de négociations inédites entre Damas et des groupes armés sous la houlette de Moscou, Téhéran et Ankara.
Aucun pays arabe n’était parmi les organisateurs. Aucun pays occidental non plus. Le processus d’Astana devenait le symbole d’un basculement du monde. Ses objectifs étaient et restent néanmoins avant tout techniques. Il s’agissait de permettre des cessez-le-feu locaux, l’acheminement d’aide humanitaire et la création de « zones de désescalade » aujourd’hui au nombre de quatre : au sud autour de Deraa, à Hama au centre, au nord-ouest autour d’Idlib, et dans la Ghouta orientale.
L’intensification des combats et des bombardements du régime dans ces deux dernières, le tragique de la situation humanitaire dans la Ghouta orientale montrent les limites de cette démarche. Elle n’en a pas moins posé Moscou comme un acteur diplomatique essentiel dans le dossier syrien.
Le Kremlin veut maintenant encore monter en puissance avec une conférence politique. Censé regrouper toutes les parties politiques, les communautés ethniques et religieuses syriennes, le processus de Sotchi, déjà reporté deux fois, vise avant tout à un effet d’affichage. Moscou souffle certes le chaud et le froid, mais rappelle que ce processus est complémentaire de celui de l’ONU et vise à le « stimuler ».
L’opposition n’a pas encore tranché sur le fait de s’y rendre ou non, conditionnant sa présence aux résultats de deux jours de négociations dans la capitale autrichienne. Les Occidentaux sont tout aussi circonspects, rappelant la « centralité du processus de Genève ».