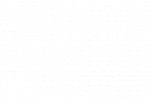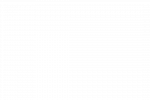Le projet de remplir le lac Tchad refait surface

Le projet de remplir le lac Tchad refait surface
Par Laurence Caramel, Joan Tilouine
L’avenir de cet espace sahélien qui fait vivre près de 40 millions de personnes est devenu un enjeu politique.
A bord d'une pirogue de commerçants reliant les différentes îles du lac Tchad, dans la région de Baga-Sola. en avril 2017. / Michael Zumstein/Agence VU pour LE MONDE
Le lac Tchad est de ces espaces que nul n’a jamais vraiment pu cartographier ni maîtriser. Cette immense oasis, liant le Sahel et l’Afrique centrale, préserve ses mystères depuis sa découverte au XIXe siècle par des explorateurs européens. Aujourd’hui, ce sont les chefs d’Etat du bassin du lac Tchad (Nigeria, Niger, Tchad, Cameroun) qui se prennent à rêver d’un méga projet incertain et controversé. « Le transfert des eaux du fleuve Oubangui vers le lac Tchad via un canal créé pour l’occasion, se réjouit le président nigérien, Mahamadou Issoufou. Cela va coûter très cher, mais c’est indispensable. » Et il espère bien que la conférence internationale consacrée au « sauvetage du lac Tchad » qui les réunit dans la capitale du Nigeria, Abuja, du 26 au 28 février lancera une bonne fois pour toutes ce vieux projet.
L’entrée en scène, il y a un an, de la société chinoise Power China, connue pour avoir participé à la construction du barrage des Trois-Gorges, au cœur de la Chine, a relancé les spéculations. Jusqu’à présent, aucune information n’a fuité sur le scénario chinois, mais Abuja ne devrait pas être le lieu des révélations. « Power China n’a pas terminé les études de faisabilité », coupe court Abdoulaye Ibbo Daddy, le directeur de la communication de la Commission du bassin du lac Tchad (CBLT), signataire de l’accord avec le groupe asiatique.
Série d’assassinats
C’est l’histoire d’une vieille utopie ravivée dans un contexte de guerre contre Boko Haram. Le groupe djihadiste, désormais divisé, a vu sa branche affiliée à l’organisation Etat islamique s’implanter sur le lac Tchad, son dernier sanctuaire. Ses cadres y bénéficient du soutien de la communauté de pêcheurs, délaissée par les Etats, et ont infiltré les circuits économiques transfrontaliers. Du côté tchadien du lac, la levée de l’interdiction de pêche en août 2017 a été suivie d’une série d’assassinats sur les îles et sur les rives. « La sécurité s’améliore, mais la guerre n’est pas finie. Toute la région est bouleversée sur le plan économique et les effets du changement climatique inquiètent », confie Adoum Forteye Amadou, le gouverneur tchadien du lac. Mais les Etats ne peuvent plus assurer la sécurité sur les routes et de nombreux villages se sont vidés de leur population.
Le lac fait normalement vivre près de 40 millions de personnes. Mais la violence de Boko Haram a plongé la région dans une grave crise humanitaire. Onze millions de personnes ont besoin d’assistance, selon l’ONU. Depuis 2009, le conflit a causé la mort de plus de 20 000 personnes, contraint 2,2 millions d’habitants à fuir et ravagé l’activité agropastorale, autrefois si dynamique. Lui-même visé par des attentats, l’émir de Kano, la grande ville du nord du Nigeria, pense néanmoins détenir la solution. « Pour moi, la priorité, c’est de faire revenir l’eau dans le lac Tchad pour relancer l’agriculture et la production électrique », dit Lamido Sanusi Lamido, chef traditionnel et économiste de renom.
L’élite dirigeante reste hantée par le spectre d’un assèchement du lac Tchad, accéléré par le changement climatique. Une crainte qui remonte au début des années 1970, marquées par les grandes sécheresses et des famines. A ce moment-là, la surface des eaux se rétracte. Le grand lac Tchad devient le « petit lac », marécageux et peu profond. Il se scinde en deux : une cuvette nord désormais peu alimentée en eau, et la cuvette sud, directement nourrie par le fleuve Chari et la rivière Logone.
Utopies coloniales
« La configuration actuelle en “petit lac” a permis de découvrir de vastes étendues de terres fertiles et rend plus de services qu’à l’époque humide aux populations qui savent en tirer profit, constate Christian Seignobos, directeur de recherche émérite à l’Institut de recherche pour le développement (IRD). Le remplissage briserait cet équilibre. Pour les populations, ce serait un désastre. »
L’idée d’un méga-ouvrage qui canaliserait de vastes quantités d’eau, prélevées depuis la zone tropicale humide du bassin du Congo vers un Sahel assoiffé, est pourtant ancienne. Jacques Lemoalle, chercheur émérite à l’IRD, fait remonter cette chimère à 1932. L’architecte allemand Herman Sörgel imagine alors « Atlantropa ». « Ce projet prévoyait de drainer l’eau du fleuve Congo vers les chotts [vastes étendues d’eau salées] du Sud tunisien et algérien pour y développer une agriculture irriguée, raconte l’hydrologue français. Le lac Tchad n’était alors qu’une étape intermédiaire. » Une idée restée sur les étagères des utopies coloniales. Mais l’ambition de valorisation puis de sauvegarde du lac Tchad n’a pas pour autant été abandonnée.
Au début des années 1980, la société italienne Bonifica perpétue le mythe de grandes infrastructures avec, cette fois, une proposition de transfert des eaux turbides du fleuve Congo d’abord. Puis de l’Oubangui ensuite. Ce projet, dénommé Transaqua, prévoit la construction d’un canal de 2 400 km reliant cette rivière, qui forme la frontière naturelle entre la République démocratique du Congo (RDC) et la Centrafrique, au Chari, le principal tributaire du lac Tchad. Kinshasa ne veut pas en entendre parler, et les experts s’interrogent sur les impacts sociaux et environnementaux.
Mais le projet continue de fasciner. En 2010, la Commission du bassin du lac Tchad se tourne vers un cabinet canadien qui réalise une étude – jamais publiée – sur un scénario bien plus « modeste » d’un transfert de 6 km³ d’eau par an, contre 100 puis 40 km3 par an pour Transaqua. La facture reste exorbitante : 14 milliards de dollars (11 milliards d’euros) pour des bénéfices incertains.
La défense du lac Tchad est entre-temps devenue médiatique avec le documentaire Une vérité qui dérange (2006) de l’ex-vice-président américain Al Gore. La NASA diffuse des images satellites alarmantes, contestées depuis, montrant qu’en l’espace de moins de quarante ans l’étendue lacustre aurait perdu 90 % de sa superficie. A ce rythme, elle disparaîtrait d’ici à vingt ans.
Les meilleurs spécialistes de la zone ne donnent pourtant que peu de crédit à cette prédiction. Faute de données fiables de terrain où les instruments de mesure sont obsolètes, ces scénarios alarmistes continuent d’avoir cours. Le géographe français Géraud Magrin, lui, dénonce un « mythe » ou un « objet hydropolitique » destiné à assouvir les rêves de grandeur de chefs d’Etat. Pour ces scientifiques, le lac Tchad ne disparaît pas. Il est en perpétuelle évolution. « La variation des niveaux des eaux dépend des pluies et nul ne sait comment elles évolueront, affirme l’hydrologue Abou Amani, de l’Unesco. Les modèles climatiques se contredisent et on navigue à vue. » Il n’existe en effet aucun réseau de suivi des variations du lac Tchad, et le fleuve Chari n’est plus jaugé depuis bien longtemps. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat n’exclut pas une hausse importante des précipitations sur le Sahel d’ici à la fin du siècle.
« Discours des années 1960 »
« Il s’agit pour les chefs d’Etat de faire un choix de développement », ajoute M. Amani. La question, longtemps taboue, de la croissance démographique, reste déterminante dans la région, où la population devrait doubler d’ici à 2050. Plus que le changement climatique, elle interroge la capacité de ce « petit lac », dont la surface varie entre 2 000 et 14 000 km2 selon les crues, à assurer les besoins des habitants. Deux milliards de dollars seront nécessaires cette année pour répondre à la crise humanitaire dans la région, selon l’ONU.
Fragilisés sur le plan sécuritaire, les présidents du lac exhument aujourd’hui ce méga-projet de réapprovisionnement en eaux, dont le coût pourrait atteindre des milliards de dollars. L’historien Vincent Hiribarren, de King’s College de Londres, y voit une façon d’échapper à la réalité présente en renouant avec « un discours développementaliste des années 1960 ». Une manière, pensent-ils, d’attirer les investisseurs, les bailleurs de fonds, et ainsi de relancer une économie exsangue dans l’espoir de conjurer la menace terroriste.