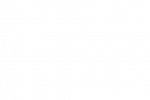Tarnac, le procès d’un sabotage et d’un fiasco judiciaire

Tarnac, le procès d’un sabotage et d’un fiasco judiciaire
Par Henri Seckel
Huit personnes sont jugées à partir de mardi, dont Julien Coupat et Yildune Lévy, accusés d’avoir saboté des lignes de TGV en 2008.
Ce fut un emballement spectaculaire, alors le contraste l’est aussi, forcément, entre le déclenchement de « l’affaire de Tarnac », il y a dix ans, et sa conclusion judiciaire qui approche. En 2008, Tarnac était une histoire de terrorisme. En 2018, c’est un procès de droit commun. C’était la résurgence de l’« ultragauche » des années de plomb qui voulait abattre l’Etat. Il en reste huit prévenus qui comparaissent devant la 14e chambre du tribunal correctionnel de Paris à partir du mardi 13 mars et jusqu’au 30 mars.
Pendant près de trois semaines, Julien Coupat, 43 ans, et Yildune Lévy, 34 ans, vont être jugés pour « dégradations d’un bien appartenant à autrui » – en l’occurrence un TGV de la SNCF et des câbles électriques de Réseau ferré de France. Eux deux et deux autres prévenus, Elsa Hauck, 33 ans, et Bertrand Deveaud, 31 ans, sont aussi jugés pour « association de malfaiteurs », en raison de leur participation à une manifestation s’étant achevée par des heurts avec les forces de l’ordre. Ils encourent dix ans de prison ; les quatre derniers doivent répondre de délits mineurs (« refus de se soumettre au prélèvement biologique », « recel de documents administratifs volés »).
Tout ça – des mois de filature, 15 000 heures d’écoute, un dossier de 27 000 pages – pour ça. Ce procès, qui n’a pas lieu aux assises en raison du rejet par la Cour de cassation, en janvier 2017, de la qualification terroriste, constitue le dernier acte d’un feuilleton dont la trace dans l’histoire sera peut-être moins celle d’un sabotage que celle de son exploitation politique et d’un fiasco judiciaire.
Incarnation de la menace
Retour en 2008. Dans la nuit du 7 au 8 novembre, quatre lignes de TGV sont sabotées selon le même modus operandi : un crochet en fer à béton posé sur une caténaire, qui agrippe le pantographe du train sur son passage. Aucun risque de déraillement, mais suffisamment de dégâts pour paralyser une partie du réseau SNCF. Trois jours plus tard a lieu une vague d’interpellations, notamment à Paris et à Tarnac, en Corrèze, village de 320 âmes investi par 150 policiers cagoulés, sous l’œil de nombreuses caméras.
Les perquisitions sont encore en cours lorsque Michèle Alliot-Marie, ministre (UMP) de l’intérieur, se félicite de l’arrestation d’une vingtaine d’individus issus de la « mouvance anarcho-autonome ». Le procureur de Paris, Jean-Claude Marin, évoque un groupe appelé « cellule invisible », « qui avait pour objet la lutte armée », et dont « il n’est pas exclu qu’il ait envisagé des actions contre des personnes ». Il est question de « commando » et de « guérilleros » dans les médias ; neuf personnes sont mises en examen pour « association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme » ; Julien Coupat devient l’incarnation de la menace, dans une France qui n’a pas encore connu Mohamed Merah ni les attentats de 2015 et 2016. Pour la toute nouvelle direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), ce « FBI à la française » voulu par le président Nicolas Sarkozy élu un an plus tôt, c’est une belle prise.
Les enquêteurs affirment, sur la foi d’un témoin anonyme, que Julien Coupat, alors âgé de 34 ans, est le cerveau du « groupe de Tarnac » qu’il aurait endoctriné. Selon ce dernier, Coupat aurait assuré qu’« il pourrait être un jour envisagé d’avoir à tuer, car la vie humaine a une valeur inférieure au combat politique », et son objectif serait « le renversement de l’Etat » selon des méthodes décrites dans l’ouvrage L’Insurrection qui vient (éditions La Fabrique, 2007), dont il est présenté comme « le théoricien ».
Dossier fragile
C’est lui qui serait, avec Yildune Lévy, sa compagne âgée de 25 ans, l’auteur du sabotage survenu à Dhuisy, en Seine-et-Marne, affirment les enquêteurs, qui surveillent tout ce petit monde depuis des mois, à la suite d’informations fournies par un agent secret britannique infiltré dans la mouvance altermondialiste. Ainsi, selon un long procès-verbal de filature, aujourd’hui connu sous le nom de « PV 104 », les deux suspects se sont rendus en Seine-et-Marne dans la soirée du 7 novembre, et leur véhicule a été vu à 4 heures du matin stationnant pendant vingt minutes sur les lieux où le sabotage allait avoir lieu une heure plus tard.
Très vite, pourtant, l’instruction va patiner. Les mis en examen sont relâchés les uns après les autres, y compris Julien Coupat, en mai 2009, après six mois à la Santé. Le procureur de Paris a beau rappeler que cette libération « ne saurait être interprétée comme le signe de l’absence ou l’insuffisance de charges », le dossier, auquel les médias ont largement accès, semble fragile.
D’abord, l’identité du témoin anonyme a fuité, et celui-ci, filmé à son insu par TF1 en novembre 2009, révèle que son témoignage n’en était pas un : il dit avoir signé un texte rédigé à l’avance par les enquêteurs. Quant au fameux « PV 104 », son authenticité est remise en cause par les avocats de la défense, qui y ont relevé de nombreuses incohérences concernant les horaires, les trajets et les effectifs de police présents. Et qui soulignent qu’aucun des dix-huit agents censés avoir effectué la filature n’a vu les suspects procéder au sabotage.
Charge symbolique
Me Thierry Lévy, avocat de Julien Coupat, dénonce alors « un scandale d’Etat » : « Le gouvernement a pris la responsabilité d’ordonner des enquêtes en incitant les policiers et les juges à se montrer peu scrupuleux afin de donner consistance à quelque chose qui n’existe pas ». Une partie de la gauche – François Hollande en tête – dénonce une manœuvre politique, ainsi résumée par le député socialiste André Vallini : « Le gouvernement cherche à entretenir un climat, pour ne pas dire une psychose sécuritaire, et comme la délinquance ne suffit plus toujours à impressionner l’opinion publique, il semble qu’il cherche à utiliser la menace terroriste en essayant de l’amalgamer avec la mouvance de l’ultragauche. » Symbole d’un dossier devenu ingérable : le juge d’instruction Thierry Fragnoli en est dessaisi au bout de trois ans – il exerce aujourd’hui à Papeete, à 16 000 kilomètres de Tarnac.
Pour Marie Dosé, avocate de Yildune Lévy, les prochaines semaines seront « le procès d’une instruction qui s’est émancipée des grands principes de prudence et de présomption d’innocence ». Jérémie Assous, qui défend les sept autres prévenus, se réjouit quant à lui de faire « le procès de l’antiterrorisme ». Il est toutefois peu probable que Michèle Alliot-Marie, Jean-Claude Marin ou encore l’ancien patron de la DCRI Bernard Squarcini, tous cités comme témoins par la défense, se présentent à la barre.
La juge Corinne Goetzmann s’attachera à maintenir les débats sur les faits. Mais il lui sera difficile de déshabiller ce procès de toute sa charge symbolique, laquelle sera d’autant plus forte que, à quelques semaines du déménagement du tribunal de grande instance de Paris dans le 17e arrondissement, Tarnac devrait être la dernière grande affaire en correctionnelle jugée sur l’île de la Cité.