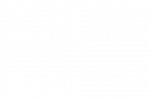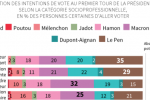Election présidentielle sous contrôle en Azerbaïdjan

Election présidentielle sous contrôle en Azerbaïdjan
Par Arthur Carpentier
En quinze ans passés au pouvoir, l’autocrate Ilham Aliev, candidat à sa réélection, a assis son emprise sur le pays.
Ilham Aliev à Bruxelles le 24 novembre 2017 pour le sommet du partenariat oriental. / Olivier Matthys / AP
Les 5,2 millions d’électeurs azerbaïdjanais sont appelés aux urnes, mercredi 11 avril, pour un scrutin présidentiel sans suspense. Le président Ilham Aliev, au pouvoir depuis 2003, sera reconduit pour un nouveau mandat de sept ans. Les opposants, dont certains sont emprisonnés, ont appelé au boycottage du scrutin. Pour faire bonne mesure et entretenir une illusion de pluralisme, le pouvoir a poussé des fidèles à présenter leur candidature.
Ce vote devait initialement se tenir le 17 octobre 2017, mais le président a décidé en février de l’avancer de six mois. Les autorités assurent que cette décision a pour but d’éviter un chevauchement des prochaines élections présidentielle et législatives, prévues pour 2025. Cette justification a suscité des critiques, notamment auprès de l’Organisation pour la sécurité et la coopération européenne (OSCE), qui contrôle les scrutins azerbaïdjanais depuis 1995.
Les observateurs de l’OSCE ont ainsi pu assister à onze élections, et pas une ne s’est déroulée sans que des malversations soient dénoncées : intimidations et représailles, fonctionnaires forcés de prendre part aux rassemblements en faveur du président en fonction, bourrages d’urnes…
Première dame, second personnage de l’Etat
Détenteur du pouvoir depuis quinze ans sans discontinuer, Ilham Aliev l’a hérité de son père, Heydar Aliev, ancien chef du KGB local, dirigeant du pays entre 1993 et 2003. La dynastie Aliev a su s’enraciner au sommet de l’appareil étatique en utilisant à plein les ressources procurées par un sous-sol riche en hydrocarbures et en jouant de la rivalité avec l’ennemi arménien, auquel l’oppose le conflit irrésolu du Haut-Karabakh. Recette de sa longévité : un peu de caviar, beaucoup de pétrole et une importante dose d’autoritarisme.
Durant son règne, M. Aliev s’est employé à tailler les institutions à sa mesure. En 2009, un référendum lui permet d’abolir la limite de deux mandats présidentiels et offre au chef de l’Etat, au premier ministre ainsi qu’aux députés une « immunité personnelle » : aucun de ces dirigeants ne peut être poursuivi pénalement, et il est interdit aux journalistes d’enquêter sur eux. Un nouveau référendum, en 2016, fait passer le mandat présidentiel de cinq à sept ans, et crée le poste de premier vice-président. Trois mois plus tard, Ilham Aliev nomme à ce poste sa femme, Mehriban Alieva. Après avoir mis la main sur des pans entiers de l’économie, elle devient ainsi le second personnage de l’Etat.
Ilham Aliev et sa femme Mehriban Aliyeva au grand prix de F1 de Bakou, le 19 juin 2016. / Ivan Sekretarev / AP
La rente pétrolière a permis à la famille Aliev d’entretenir les caciques du régime – autant que son propre train de vie – pour pérenniser sa situation. Mais pas seulement. L’enquête « Laundromat », menée conjointement par Le Monde et dix autres publications européennes, avait permis de révéler les dessous de la « diplomatie du caviar » azerbaïdjanaise.
Des milliards d’euros, probablement détournés du budget de l’Etat, permettaient au régime de nouer de belles amitiés avec les représentants de puissances étrangères, dont la France. Cadeaux, dons, investissements, voyages, autant de gestes pour s’attirer la sympathie d’élus, porte-parole de Bakou dans leur pays et fréquemment invités à dire le bien qu’ils pensent des scrutins électoraux azerbaïdjanais.
Le financement des ONG contrôlé
L’opposition, elle, ne dispose ni des moyens de s’organiser ni de ceux de se faire entendre. Les autorités ont facilement recours aux emprisonnements abusifs. Soucieuses de ne pas avoir officiellement de « prisonniers politiques », elles ont pris l’habitude d’écrouer les opposants grâce à de prétendues infractions liées aux stupéfiants, à de la fraude ou à l’évasion fiscale.
C’est pour ces derniers motifs que la militante des droits de l’homme Leyla Yunus a passé seize mois dans les geôles du régime, ou elle a été torturée. Sa libération, en décembre 2015, est apparue comme un gage donné aux Occidentaux. Mais, dénonce-t-elle dans une tribune publiée par Le Monde le 7 avril, « aujourd’hui, l’Azerbaïdjan compte 161 prisonniers politiques dont la majorité ont été arrêtés simplement pour avoir critiqué la politique d’Ilham Aliev sur les réseaux sociaux. Des prisonniers politiques décèdent régulièrement à la suite de tortures ».
Des policiers azeris ceinturent une activiste au cours d’une manifestation contre la dévaluation de la monaie nationale, le manat, en 2015. Entre 2014 et 2016, la chute du prix du barril a diviser par deux le PIB du pays, impactant la vie quotidienne des habitants. / TOFIK BABAYEV / AFP
Depuis deux ans, de nouvelles lois encadrent l’activité des ONG : en fait de leur offrir un cadre législatif, elles consistent plutôt en un étouffant carcan réduisant à rien l’espace public de la société civile. Il est désormais obligatoire pour ces organisations d’informer l’administration de toutes leurs sources de financement, notamment les dons issus de l’étranger. Les donateurs internationaux doivent eux-mêmes demander une autorisation pour obtenir le droit de subventionner des activités dans le pays. L’Etat bénéficie d’un large panel de motifs justifiant l’interdiction de ce type de versements, par exemple s’il estime déjà octroyer des fonds suffisants à certaines causes.
Les médias ne sont pas épargnés par cette entreprise de réduction au silence des courants opposés au régime. L’Azerbaïdjan pointe à la 162e place (sur 180) du classement 2017 de la liberté de la presse de Reporters sans frontières (RSF). Plus d’une douzaine de journalistes ou blogueurs croupissent dans les prisons du pays, certains depuis six ans. En janvier 2018, le journaliste d’investigation Afgan Mukhtarli était condamné à six ans de prison. Il avait été enlevé quelques mois plus tôt par les autorités azéries en Géorgie, où il était réfugié.