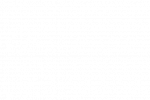Syrie : « Poutine n’arrive pas à transformer son succès militaire en succès diplomatique »

Syrie : « Poutine n’arrive pas à transformer son succès militaire en succès diplomatique »
Reprise du fief rebelle de la Ghouta, attaque chimique : dans un tchat avec les internautes, les journalistes du « Monde » ont décrypté la situation en Syrie.
Une affiche représentant Bachar Al-Assad, à Al-Wafidine, entre Damas et la Ghouta orientale, le 12 avril. / YOUSSEF KARWASHAN / AFP
La reprise de Douma, dans la banlieue de Damas, jeudi 12 avril, couronne le processus de redressement du pouvoir de Bachar Al-Assad. Mais l’attaque chimique contre le fief rebelle suscite de vives tensions entre la Russie et les Etats-Unis, qui menacent le régime syrien de frappes punitives. Dans un tchat avec les internautes, les journalistes du Monde Allan Kaval et Marc Semo ont fait le point sur la situation.
VS : La France va-t-elle répondre à l’attaque chimique en Syrie ?
Marc Semo : C’est probable, car Paris n’a cessé de rappeler que l’on ne peut accepter la banalisation de l’emploi des armes chimiques, et Emmanuel Macron en a fait explicitement une « ligne rouge ». Sa crédibilité comme celle de Washington sont en jeu. Mais le cadre, la durée, l’ampleur de l’opération sont encore en discussion. Il s’agit de ne pas se limiter à une frappe ponctuelle comme celle faite par les Etats-Unis il y a un an, mais en même temps d’éviter une escalade.
Bolkonsky : Quelles sont les preuves de l’utilisation de l’arme chimique par les autorités syriennes ?
Allan Kaval : A ce stade, il est n’est pas possible de recueillir les preuves matérielles de manière indépendante. Il faudrait pouvoir effectuer des prélèvements sur le site de l’attaque – un immeuble d’habitation – et sur les corps. Or la zone est à présent sous contrôle russe.
Kassagi : A part ne pas perdre la face, si la ligne rouge a bien été franchie, à quoi peut servir une frappe française, maintenant que la guerre a été gagnée par Bachar Al-Assad ?
M. S. : Il ne s’agit pas seulement de rappeler clairement que l’emploi de l’arme chimique ne restera pas impuni. La guerre est certes plus ou moins gagnée par le régime mais elle n’est pas finie. Si l’on ne fait rien, Damas pourra de nouveau utiliser ces armes pour reconquérir la zone d’Idlib dans le nord-ouest, ou de Deraa au sud. Les armes chimiques pourraient être utilisées ailleurs et par d’autres…
Ce n’est pas une coïncidence si les services secrets russes ont employé sur le sol britannique du poison novitchok pour tenter d’éliminer un ex-agent double. C’est aussi une manière de voir jusqu’où il est possible d’aller face aux démocraties occidentales.
JdLF : Quelle légitimité internationale aurait une attaque occidentale contre les forces syriennes ?
M. S. : C’est tout le problème ! La violation par Damas de ses engagements au sein de l’OIAC (Organisation internationale pour l’interdiction des armes chimiques) ne suffit pas pour fonder légalement une intervention sans mandat du Conseil de sécurité de l’ONU. La participation aux frappes de la coalition en Syrie contre l’EI était justifiée par la menace directe que représentait le groupe djihadiste. Mais l’arme chimique n’est pas une menace directe pour la France.
Cyp44 : Pouvez-vous nous expliquer la situation en Moyen-Orient ? Je ne comprends rien !
M. S. : Pour résumer, il y a maintenant en Syrie au moins cinq conflits imbriqués :
- une guerre entre la rébellion désormais aux abois et le régime ;
- une guerre menée par la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis et où la France est très active contre l’EI ;
- une lutte des Kurdes qui ont le soutien des Occidentaux, car ils sont les alliés sur le terrain contre l’EI, mais que la Turquie, soutien des rebelles anti-régime, veut écraser ;
- un conflit qui monte entre les puissances régionales, opposant notamment l’Iran et Israël, toujours plus inquiet de la présence croissante des forces iraniennes en Syrie avec le régime ;
- et un bras-de-fer international entre les grandes puissances.
BFR : Que reste-t-il de la rébellion ?
A. K. : Les groupes armés désignés sous l’expression d’Armée syrienne libre n’ont jamais constitué une entité militaire unifiée. Après la chute définitive de la Ghouta, il reste des poches rebelles dans les zones dominées par le régime. Ces petits territoires peuvent être repris rapidement, par les armes ou au moyen d’accords de reddition. Il existe des emprises rebelles plus vastes autour de Deraa, près de la frontière jordanienne ainsi que sur le plateau du Golan.
Dans le gouvernorat d’Idlib, des groupes rebelles coexistent avec des factions djihadistes. Et certains groupes armés issus de la rébellion, et se réclamant encore de l’Armée syrienne libre, servent de supplétifs aux forces turques qui contrôlent des territoires dans le gouvernorat d’Alep, dont l’ancienne enclave kurde d’Afrin. Ces groupes sont sous commandement turc et ont pour vocation essentielle de combattre les Kurdes.
Internaute : Quel objectif maintenant pour les forces d’Assad ?
A. K. : La question des frappes occidentales mise à part, le régime est lancé dans une dynamique de reconquête. Il est désormais maître de sa capitale. Et la reprise de Douma marque la fin d’une phase : celle de la reprise de la Syrie dite « utile », une dorsale urbaine qui court de Damas à Alep en passant par Homs et Hama.
Les représentants du régime ont déclaré que leur objectif final était la reconquête totale du pays. Cette vision politique connaît cependant de fortes limites militaires. Le régime ne peut entreprendre d’offensive majeure sans le soutien appuyé de son allié russe. A Idlib, Moscou voit d’un œil favorable la constitution d’une zone d’influence turque connectée aux territoires indirectement administrés par la Turquie du gouvernorat d’Alep. Concernant le Golan, la Russie n’a pas intérêt à ce stade à laisser le régime soutenu par son autre parrain, l’Iran, menacer directement Israël.
JS : Où en sont les forces armées turques dans leur volonté de s’attaquer à la région de Manbij (et celle de Kobané) tenue par les Kurdes ?
A. K. : L’envoi de forces supplémentaires de la coalition internationale contre l’EI auprès des Forces démocratiques syriennes, qui tiennent Manbij, semble avoir mis un coup d’arrêt au positionnement offensif d’Ankara. Malgré les déclarations du président américain sur un retrait prochain de Syrie, Washington et, dans une moindre mesure, Paris, ont envoyé un signal clair à la Turquie : Manbij demeure dans la zone d’intérêt de la coalition.
Kobané, qui abrite des installations militaires importantes de la coalition, reste à ce stade hors d’atteinte des forces armées turques et de leurs supplétifs syriens.
Antoine : Je ne comprends pas le positionnement de la Russie envers la Syrie. Quels sont ses intérêts ?
M. S. : C’est une question de prestige d’abord. Même à l’époque de l’URSS, Damas était le principal point d’appui de Moscou dans la région, surtout après que l’Egypte a basculé au milieu des années 1970 dans le camp américain. C’est aussi au travers de son intervention en Syrie à l’automne 2015 pour sauver le régime – avec 5 000 hommes et de l’aviation – que Moscou a retrouvé, comme le voulait Vladimir Poutine, son rang de grande puissance parlant d’égal à égal avec Washington – même s’il ne faut pas oublier que le PIB russe équivaut, les bonnes années, à celui de l’Italie.
Dans ce contexte, le Kremlin ne peut plus faire marche arrière : lâcher le régime serait aussi sa défaite. Poutine sait qu’il risque l’enlisement s’il ne réussit pas à transformer son succès militaire en succès diplomatique avec un plan de paix. Mais il n’y arrive pas. En Géorgie ou en Ukraine, Moscou a pu geler le conflit. En Syrie, compte tenu de la multiplicité des acteurs, cela est impossible.
Grégoire : Pourquoi la Russie n’exige-t-elle pas le départ du dictateur Assad ?
M. S. : Probablement parce qu’ils n’ont pas encore réussi à lui trouver un remplaçant crédible à même de garantir la stabilité du régime, qui est leur obsession. En outre, les Iraniens, qui sont désormais les vrais patrons dans l’appareil sécuritaire à Damas, continuent de le soutenir à fond.