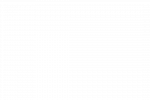Erudits, tendres ou comiques, nos choix littéraires

Erudits, tendres ou comiques, nos choix littéraires
Chaque jeudi, la rédaction du « Monde des livres » propose une sélection de romans et d’essais pour tous les goûts.
L’autobiographie du comédien américain Lenny Bruce « Irrécupérable » (« How to Talk Dirty and Influence People »), publiée aux éditions Tristram. / DENNIS STOCK/MAGNUM PHOTOS
LES CHOIX DE LA MATINALE
En compagnie d’Edouard Louis, de Lenny Bruce ou d’Elsa Morante, la semaine littéraire s’annonce pointue.
HISTOIRE. « Les Françaises, les Français et l’épuration », de François Rouquet et Fabrice Virgili
Le 14 juillet 1943, Bir-Hakeim, un journal de la Résistance, prévenait que « le jour du jugement et de la fessée en place publique » approchait pour les « caméléons » et les « traîtres ». Avec un an d’avance s’esquissait l’épuration, dans ses dimensions à la fois judiciaires et symboliques, ces dernières si importantes pour apaiser le pays meurtri.
C’est toute la complexité de ce moment, où le soulagement de la sortie de guerre coïncide avec un intense besoin de punition, que restituent François Rouquet et Fabrice Virgili dans une somme enthousiasmante par l’ampleur des matériaux brassés et des perspectives dessinées. Cette « histoire populaire de l’épuration », attentive aux émotions des contemporains et ouverte dans l’espace et le temps, montre que l’épuration ne fut pas l’occasion de sordides règlements de comptes : elle fut avant tout, pour des communautés dévastées par la guerre, un processus nécessaire de reconstitution par exclusion, décliné en d’innombrables modalités locales. Constamment réflexif, l’ouvrage réussit le bel exploit, sur un tel sujet, de ne pas juger et de toujours contextualiser. André Loez
« Les Françaises, les Français et l’épuration. De 1940 à nos jours », de François Rouquet et Fabrice Virgili, Folio, « Histoire », inédit, 832 p., 11,90 €.
RÉCIT. « Qui a tué mon père », d’Edouard Louis
En finir avec Eddy Bellegueule et Histoire de la violence, les deux premiers romans autobiographiques d’Edouard Louis (Seuil, 2014 et 2016), entrelaçaient deux langues : celle, durassienne, dans laquelle s’est forgé le style de l’auteur, et celle, populaire, de sa famille – parents, sœur… Dans Qui a tué mon père, « seul le fils parle », précise d’emblée une note liminaire à ce livre en trois parties – trois actes pour un texte destiné à être joué au théâtre, mais qui se lit comme un récit. « Seul le fils parle », mais il mêle les registres : la colère, la douceur, le regret et le silence se succèdent et s’imbriquent pour raconter la vie de son père, qu’il connaît si mal, et pour dire leur relation.
La colère, c’est celle, dressée contre la violence sociale et institutionnelle, qui fait écrire à Edouard Louis, s’adressant à cet homme de 51 ans, au corps détruit : « Tu appartiens à cette catégorie d’humains à qui la politique réserve une mort précoce » ; dans la troisième partie, il donnera les noms de ministres et présidents qu’il juge responsables de l’état de son père.
La douceur et le regret (ainsi que le remords : « Je n’étais pas innocent »), ce sont ceux avec lesquels Edouard Louis retrace une poignée de scènes de son enfance, et explore les rares informations qu’il possède sur la jeunesse de son père. Sans chercher à combler les blancs laissés par un homme convaincu que se raconter est un manquement aux règles de la virilité.
Si, son titre l’indique, Qui a tué mon père se veut d’abord le récit d’un assassinat politique, il est surtout l’histoire d’une vie empêchée, faisant le compte de ce que le monde a enlevé à celle-ci. A commencer par la possibilité de se dire, entre père et fils, que l’on s’aime – ce manque que la littérature permet, magnifiquement, de combler. Raphaëlle Leyris
« Qui a tué mon père », d’Edouard Louis, Seuil, 96 p., 12 €.
ROMAN. « Nos révolutions », de Jane Smiley
Jane Smiley a consacré sa thèse aux sagas islandaises, genre dans lequel elle s’est ensuite illustrée comme auteure avec La Nuit des Groenlandais (Robert Laffont, 1989), avant d’asseoir sa place sur la scène littéraire américaine grâce à la saga familiale et shakespearienne L’Exploitation (Rivages, 1993, prix Pulitzer 1992). Autant dire que l’écrivaine possède un incontestable savoir-faire en matière de romans-fleuves, de personnages multiples, de maîtrise du temps long autant que de ses effets.
La trilogie Un siècle américain, dont paraît le deuxième tome, en apporte un éclatant exemple, qui reprend deux ingrédients centraux de L’Exploitation : une famille et un domaine agricole dans l’Iowa. Dans le premier tome, Nos premiers jours, on découvrait, en 1920, Walter Langdon et son épouse, Rosanna, alors qu’ils s’installaient dans leur ferme et donnaient naissance à six enfants, dont l’une allait mourir ; le volume se refermait, en 1953, avec le décès de Walter.
Ses obsèques ouvrent Nos révolutions, dont le personnage central est Frank, l’aîné, mais sans que soient sacrifiées les très attachantes figures de ses frère, sœurs et autres membres de la parentèle, aux côtés desquels on traverse trente-trois années, en autant de chapitres.
Jane Smiley raconte l’histoire personnelle de chacun avec, en toile de fond, celle de l’Amérique (prospérité, maccarthysme, élection de Kennedy, guerre du Vietnam, scandale du Watergate…), mais elle ne force jamais ce lien – ce qui le rend d’autant plus fort. Certaines années passent à toute vitesse, d’autres s’étirent, et sa capacité à restituer cette élasticité du temps n’est pas la moindre réussite de l’auteure au fil de cette formidable saga. R. L.
« Nos révolutions. Un siècle américain II » (Early Warning), de Jane Smiley, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Carine Chichereau, Rivages, 660 p., 24,50 €.
BIOGRAPHIE. « Elsa Morante. Une vie pour la littérature », de René de Ceccatty
Huit ans après sa biographie d’Alberto Moravia (Flammarion, 2010), l’écrivain René de Ceccatty s’attaque à celle qui fut son épouse de 1941 à 1962 – date à laquelle le couple se sépara sans divorcer : Elsa Morante. L’auteure de La Storia (Gallimard, 1977) détestait pourtant qu’on la présente ainsi. A juste titre. « A aucun moment de sa vie, Elsa ne s’est pensée autrement qu’indépendante », écrit son biographe.
C’est cette femme résolument libre, imaginative et intransigeante qu’il met en scène : soixante-treize ans d’une vie romaine commencée en 1912 sous le signe du secret – son père était-il celui dont elle porte le nom ou un postier sicilien amant de sa mère ? – et terminée en 1985, après une tentative de suicide en 1982 – Morante étant à la fois déçue politiquement par la dérive violente des « années de plomb » et effrayée à l’idée de sa propre décrépitude.
Entre ces deux dates, on voit s’épanouir cette figure de l’intelligentsia italienne, autodidacte précoce aimée et admirée de Luchino Visconti, de Pier Paolo Pasolini, de Leonor Fini… et bien sûr d’Alberto Moravia, dont les lettres témoignent jusqu’au bout d’une indéfectible tendresse. Richement documentée, passionnante, cette enquête ne se contente pas de ressusciter le génie d’une femme et d’une époque : elle donne grande envie de se replonger dans l’œuvre. Florence Noiville
« Elsa Morante. Une vie pour la littérature », de René de Ceccatty, Tallandier, 432 p., 21,90 €.
AUTOBIOGRAPHIE. « Irrécupérable », de Lenny Bruce
Quoiqu’elle épouse l’ordre chronologique – depuis son enfance désargentée au sein de la communauté juive de Long Island, jusqu’à ses déboires judiciaires avant sa mort –, l’autobiographie de Lenny Bruce (1925-1966) est à l’image du stand-up pratiqué dans ses années 1950 et 1960 par l’humoriste américain.
Ce style inspiré du courant de conscience joycien, écrit-il dans ses Mémoires, il l’a forgé en mer – dans la Navy pendant la seconde guerre mondiale. « Jour et nuit, je pensais à toutes sortes de choses. Il m’arrivait de parler tout seul à voix haute quand j’étais à la proue du navire, où des tonnes d’eau déforment la plaque de blindage. »
Parce qu’il aimait improviser, parce qu’il goûtait les libres associations, parce que son idole était Charlie Parker, Lenny Bruce se voyait comme un jazzman. Et c’est bien un plaisir d’auditeur – grâce à l’excellente traduction de Christine Rimoldy – que l’on éprouve à la lecture d’Irrécupérable : lorsque Lenny Bruce conte son périple burlesque pour acquérir une machine à laver, sa transformation en frère Mathias pour soutirer de l’argent aux âmes charitables, ou qu’il retranscrit d’absurdes extraits de procès-verbaux lors d’actions judiciaires intentées contre lui…
Irrécupérable offre l’opportunité de découvrir le « mélancomique » et l’idole brisée qu’ont pleurés Nico et les Beatles, l’artiste ayant inspiré de nombreux comédiens et comiques américains, de Richard Pryor à Robin Williams. « Le frère que nous n’avons pas eu », chantait Bob Dylan. Macha Séry
« Irrécupérable » (« How to Talk Dirty and Influence People »), de Lenny Bruce, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Christine Rimoldy, Tristram, 384 p., 23,50 €.