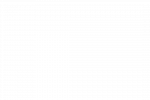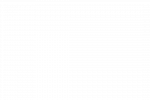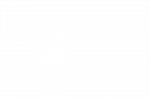Venezuela : sanctionner la dictature, pas la population

Venezuela : sanctionner la dictature, pas la population
Editorial. Les mesures envisagées par la communauté internationale pour sanctionner le simulacre d’élection qui a permis à Nicolas Maduro d’être réélu dimanche devront s’attacher à ne pas accabler une population déjà au bord du gouffre.
Editorial du « Monde ». Depuis la chute des grands totalitarismes du XXe siècle, les dictatures du XXIe siècle aiment se parer des atours du passage par les urnes. Qu’ils soient fascisants, populistes, islamistes, postcommunistes, néorévolutionnaires ou simplement autocratiques, rares sont désormais les régimes politiques – monarchies absolues mises à part – qui ne tentent de s’offrir une façade démocratique.
Réélu dimanche 20 mai à la présidence du Venezuela à la faveur d’une « élection » qui n’en a que l’apparence, Nicolas Maduro a ainsi beau jeu de se féliciter que son mouvement politique, le chavisme, ait remporté 22 des 24 scrutins organisés depuis la prise de pouvoir du fondateur de la « révolution bolivarienne », Hugo Chavez, en 1999.
Certes, le Venezuela n’entre pas, même à l’aune de notre siècle chaotique, dans une catégorie classique de dictature. D’abord, parce que la « révolution bolivarienne » a soulevé, à une époque, l’enthousiasme d’une couche importante de la société. Ensuite, parce que son idéologie, même si elle s’apparente officiellement au communisme du modèle cubain, est en réalité un mélange d’influences diverses et de confrontations avec la réalité.
Il n’en reste pas moins que cette élection présidentielle n’a rien eu à voir avec une quelconque expérience démocratique. Assemblée nationale d’opposition interdite de travaux depuis un an ; opposants emprisonnés, assignés à résidence, et finalement interdits de candidature ; campagne électorale menée par un Etat totalement mobilisé au service d’un parti et d’un homme ; confusion absolue entre aides sociales et participation au scrutin : l’héritier de Chavez n’a rien laissé au hasard.
Revendication d’une élection libre
Comment réagir à un tel déni de droit ? L’opposition démocratique vénézuélienne appelle la communauté internationale à ne pas reconnaître la victoire de Nicolas Maduro et à faire pression pour organiser un scrutin présidentiel à la date initialement prévue, en décembre 2018. Les Etats-Unis s’apprêtent à annoncer une nouvelle série de sanctions économiques. Les partenaires latino-américains de Caracas ont choisi d’éviter les relations politiques. Du côté européen, on songe à renforcer les sanctions individuelles contre les dirigeants chavistes, plutôt que de prendre des mesures qui frapperaient une population au bord du gouffre.
A Caracas, les opposants démocrates sont favorables à ces sanctions ciblées contre le pouvoir maduriste, estimant qu’elles s’attaquent à ce qu’il a de plus totalitaire et de mafieux. On peut en revanche s’interroger sur la question de la non-reconnaissance d’un pouvoir en place : outre l’incohérence qu’elle implique face aux autres régimes autoritaires avec lesquels les démocraties libérales entretiennent des relations, elle comporte le risque de se priver de pouvoir parler avec Caracas.
Il faut soutenir diplomatiquement l’opposition démocratique dans sa revendication d’une élection libre, juste et transparente. Il faut aussi tenter de soulager la souffrance des Vénézuéliens : même si le pouvoir maduriste refuse pour le moment de reconnaître la catastrophe humanitaire que sa politique a infligée au pays, il finira peut-être par accepter le principe d’une assistance, elle aussi ciblée. Car, au bout du compte, ce sont des êtres humains qui paient le prix de ces errements idéologiques, par un exode massif, aux lourdes conséquences pour les pays voisins, mais aussi, trop souvent, par leur vie.