Au Kenya, des réfugiés se racontent pour changer le regard sur l’exil
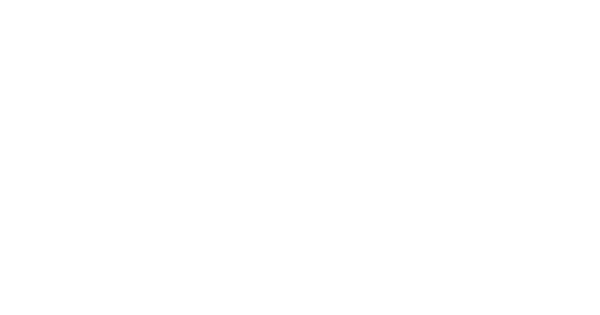
Au Kenya, des réfugiés se racontent pour changer le regard sur l’exil
Par Marion Douet (camp de Kakuma, Kenya, envoyée spéciale)
Stars ou anonymes, des réfugiés ont évoqué leurs parcours – et leurs succès – lors d’une conférence TEDx organisée par le HCR dans le camp de Kakuma.
Le camp de réfugiés de Kakuma, dans le comté de Turkana, au nord-ouest de Nairobi, au Kenya, en janvier 2018. / THOMAS MUKOYA/REUTERS
Ce fut une opération de communication rare et surprenante. Une scène à l’américaine, avec écrans géants et discours travaillés au millimètre, pour mettre à l’honneur des réfugiés. Samedi 9 juin, un événement TEDx, ces conférences se voulant « inspirantes » et venues des Etats-Unis, s’est tenu pour la première fois dans un camp de réfugiés. A l’origine du show, le Haut-Commissariat des Nations unies aux réfugiés (HCR), qui souhaite « changer le discours autour des réfugiés » en montrant que « leurs histoires ne sont pas seulement des histoires de tragédies ». L’organe onusien avait choisi le camp de Kakuma, dans le nord-ouest du Kenya, qui accueille depuis vingt-six ans des Sud-Soudanais, des Somaliens, des Congolais et des Ethiopiens ayant fui la guerre ou les persécutions.
Le camp, immense, accueille 185 000 personnes dans des tentes et des abris plantés au milieu d’une plaine quasi désertique. Un lieu globalement sûr mais difficile, dont il n’est pas aisé de sortir (les réfugiés n’ont pas la liberté de circuler au Kenya). Elevés au rang d’emblèmes, ceux qui tenaient le micro sont nés, ont grandi, ont trouvé leur voix ici. Sous une grande tente blanche dressée au beau milieu d’une cour d’école, ils sont venus – ou revenus – raconter leur vie d’après : leur travail de mannequin, d’humanitaire, d’athlète ou de cinéaste, anonyme ou célèbre, dans le camp ou à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Portraits.
Halima Aden, mannequin, originaire du Kenya
Le 9 juin, c’est une star qui est revenue à Kakuma, où elle est née il y a vingt ans. En mai, Halima Aden faisait, en hijab, la couverture du magazine Vogue au Royaume-Uni. La dernière étape en date d’une carrière fulgurante qui a débuté il y a un an et demi par le concours de Miss Minnesota, où elle a fait sensation en défilant voilée et en burkini. Depuis, tout s’est enchaîné : signature avec l’agence internationale IMG Models, fashion weeks de New York et de Milan, couverture de Vogue mais aussi d’Allure et de Grazia, campagne publicitaire avec Nike…
« Mon nom est Halima, je suis noire, musulmane, somalie et américaine, originaire du Kenya. Et je ne suis pas effrayée à l’idée d’être la première », a déclaré la top-modèle en voile mauve et large jupe bouffante, provoquant des sourires admiratifs parmi les centaines d’invités – officiels, humanitaires, habitants du camp, journalistes – venus assister à l’événement.
Assaillie par les journalistes, veillée par des manageurs qui accordent des interviews au compte-gouttes, la jeune femme dévoile sur la scène un discours fort, du haut de son 1,66 mètre. L’ambassadrice de l’Unicef veut démontrer qu’un camp de réfugiés est aussi « un lieu d’espoir ». « Oui, il y avait des défis, et il m’arrivait d’avoir des crises de paludisme. Mais à Kakuma, il y avait un réel sens de la communauté », a-t-elle raconté, évoquant avec humour le dépaysement à son arrivée aux Etats-Unis, à l’âge de 8 ans. « Je me disais : pourquoi ne parlent-ils pas swahili ? Le swahili est la langue qui unit les gens. »
A travers son image, elle entend changer la perception des jeunes femmes musulmanes. « Je porte un hijab, et ce n’est pas quelque chose que l’on voit dans la mode. C’est nouveau et un peu choquant, a-t-elle récemment déclaré. J’espère que nous allons bénéficier d’une plus grande émancipation, d’opportunités pour essayer de nouvelles choses. Avec un peu de chance, porter un hijab dans un défilé sera peut-être bientôt tout à fait normal. »
Mercy Akuot, humanitaire, originaire du Soudan du Sud
Mercy Akuot sait précisément ce qu’elle veut et ce qu’elle ne veut pas. Cette Sud-Soudanaise élevée en Ouganda ne voulait pas être mariée de force à un grand-oncle au sortir de l’enfance. Violée pendant plusieurs jours, elle s’évade puis est recueillie par un bienfaiteur ougandais, avant d’être retrouvée par sa famille en 2015. Elle décide alors de gagner, seule et à 22 ans, le Kenya. « Pour moi, Kakuma était l’endroit où aller car ici personne ne me connaissait », raconte cette jeune mère d’un petit garçon, aujourd’hui mariée avec un autre réfugié sud-soudanais.
Aussi loin qu’elle s’en souvienne, Mercy Akuot a voulu défendre les femmes des violences imposées par leur propre culture. Et l’a clamé dès son arrivée au camp. « Rapidement, un ami m’a dit qu’il avait vu une offre d’emploi à propos des femmes et des droits. J’ai répondu : “Ce job est pour moi !” J’ai postulé le jour suivant et depuis, je travaille auprès du Conseil danois pour les réfugiés à Kakuma », confie-t-elle.
Sur la scène de TEDx, elle raconte son meilleur souvenir avec son père, un moment innocent d’enfance où ils chantèrent ensemble un refrain du rappeur américain Nas sur fond de La Lettre à Elise : « I know I can/Be what I wanna be/If I work hard at it/I’ll be what I wanna be » (Je sais que je peux/Etre qui je veux/Si j’y travaille dur/Je serai qui je veux). C’était bien avant ce jour où sa famille – qu’elle refuse de blâmer – l’a donnée.
Tout le chemin parcouru depuis ne suffit pas à la satisfaire. Elle veut aller plus loin, pour éviter que de futures générations de femmes soient, comme elle, abusées et empêchées de choisir leur destinée. Mercy Akuot voudrait étudier les relations publiques : « Parce que je veux être capable de communiquer, de défendre ce sujet de manière professionnelle, être vraiment dans la position de changer des choses. »
Yiech Pur Biel, athlète, originaire du Soudan du Sud
En 2016, à 20 ans, Yiech Pur Biel a couru le 800 mètres aux Jeux olympiques de Rio. 1 min, 54 s, 67 sous les flashs et les applaudissements, aux côtés d’athlètes internationaux et dans l’équipement d’une grande marque. Un an plus tôt, ce jeune Sud-Soudanais courrait sa première course – 10 km – à Kakuma. Sans chaussures et sans trop savoir pourquoi. Il finit troisième, les pieds en sang. « Ça a été très très dur mais c’était mieux que de ne rien faire », plaisante Yiech Pur Biel sur scène, en chemisier rouge brodé et baskets noires Balenciaga.
Cette première course suffira à le faire repérer par des entraîneurs et à mettre fin à son séjour à Kakuma. Il y est arrivé en 2005, à 9 ans, après avoir fui les combats qui ont détruit sa région d’origine, Nasir, dans le nord du pays. Il sera secouru par des casques bleus et accueilli à Kakuma dans une famille de réfugiés sud-soudanais. Pour tenter de surmonter « ce qu’ils ont appelé le traumatisme dans [sa] tête », l’adolescent choisit d’abord le football, pour les échanges que ce sport implique avec les autres. « Pendant dix ans, le foot a été toute ma vie, raconte-t-il en marge de la cérémonie. Mais le problème, c’est que c’est un travail d’équipe. Si tu perds le match, tu ne peux pas t’en tenir responsable. Avec la course, je ne dépends pas des autres. »
Sous sa frêle silhouette, c’est un bloc de détermination. Celui qui aime dire qu’il « ne court plus pour fuir la guerre mais pour atteindre un but » appréhende chaque événement comme un défi à surmonter. Même celui, pour un garçon timide, de prendre la parole en anglais, seul et sans notes, devant des milliers de personnes. Une affaire de responsabilité pour celui qui, parallèlement à ses journées d’entraînement près de Nairobi pour les JO de Tokyo, en 2020, veut utiliser sa nouvelle « voix » pour changer la perception sur les réfugiés. « Le fait même d’utiliser le mot “réfugié”, c’est regarder le statut et non pas ce que fait la personne. Quand vous avez un parcours, les gens oublient de vous désigner comme un réfugié : regardez-moi, on ne dit plus de moi que je suis un réfugié mais un athlète olympique. »
Amina Rwimo, réalisatrice, originaire de RDC
Amina Rwimo est sur une brèche ouverte entre infinie tristesse et optimisme émerveillé. Ses yeux délicatement maquillés retiennent une larme dès qu’elle évoque l’absence de sa mère – elle n’en dira pas plus sur sa famille en RDC – mais s’emplissent d’étoiles lorsqu’elle parle de ses projets de cinéma. Ses émotions, la réalisatrice a choisi de les réserver à ses films. Avec succès. Son deuxième court-métrage, It has killed my mother, déjà primé, sera notamment projeté lors du Festival international du film de Zanzibar, du 7 au 15 juillet.
La jeune femme de 24 ans a fait des mots prononcés aux Oscars par son idole, l’actrice Lupita Nyong’o, son credo : « No matter where you are from, your dreams are valid » (Qu’importe d’où tu viens, tes rêves sont valides). Le premier souvenir d’Amina Rwimo, lorsqu’elle arrive, adolescente isolée, à Kakuma, est d’être « totalement, tellement perdue ». Mais le camp offre la sécurité, lui permet d’étudier et de se former à la réalisation grâce à une ONG. Aujourd’hui, « Kakuma est ma maison, mon futur, ma force et mon inspiration. C’est l’endroit où mes rêves sont devenus valides », insiste ce bout de femme élégante, en robe verte bouffante et escarpins noirs.
Pour l’instant, Amina Rwimo a concentré son travail sur des sujets rémanents dans la vie du camp (tourné à Kakuma, It has killed my mother traite du danger de l’excision). « Je veux continuer à faire des documentaires sur des problématiques qui touchent à la vie des réfugiés, raconte celle qui écrit, produit et tourne ses scénarios. Je vais aussi faire des histoires d’amour, des films de divertissement que tout le monde peut vouloir regarder et acheter. »
Avec un associé, également réfugié, elle a fondé une société de production, dont les locaux sont en construction à Kakuma. A terme, elle souhaite monter un studio de musique pour enregistrer et mixer elle-même les bandes-son de ses films. Et, pourquoi pas, ouvrir cet espace aux musiciens du camp et créer un label de musique.











