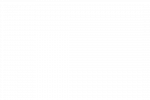Bryan Ruiz : « La plus belle expression de la “Pura Vida” au Costa Rica, c’est l’absence de l’armée »

Bryan Ruiz : « La plus belle expression de la “Pura Vida” au Costa Rica, c’est l’absence de l’armée »
Si le gardien Kaylor Navas est la star du Costa Rica, Bryan Ruiz en est son meneur de jeu et son artiste. Avant d’affronter le Brésil, il raconte son pays souvent considéré comme « la Suisse d’Amérique centrale ».
Surprenant quart-finaliste en 2014, le Costa Rica a mal débuté l’édition 2018, battue 1-0 contre la Serbie dans le groupe. Les Ticos sont déjà condamnés à l’exploit, vendredi à Saint-Pétersbourg contre le Brésil et comptent sur Bryan Ruiz et ses inspirations, parfois géniales. Si le milieu de terrain évolue en Europe depuis douze ans, il reste très attaché au Costa Rica, son mode de vie et garde un œil attentif sur son évolution.
Peut-on considérer le quart de finale de 2014 comme la meilleure page de l’histoire du football costaricien ?
Oui, déjà parce qu’on n’a pas perdu un seul match sur les cinq qu’on a disputés. C’est le tir au but que je rate contre les Pays-Bas en quarts de finale qui nous élimine, mais on est sortis invaincus du tournoi. Quand tu es dans le groupe de trois ex-champions du monde (Uruguay, Angleterre, Italie), tu n’as aucune pression parce que tout le monde s’attend à ce que tu perdes les trois matchs. On a donc pris ce Mondial comme un challenge, on n’avait rien à perdre.
Quand on évoque le Costa Rica, on parle souvent de la « Pura Vida ». Quelle en est ta définition ?
La plus belle expression de la Pura Vida, c’est l’absence de l’armée dans le pays depuis l’indépendance en 1948. Au pays, cette expression est très populaire. On l’utilise même pour dire « Bonjour ! » ou « Tout va bien ! » Quand tu voyages et que tu entends cette expression, tu sais que tu as affaire à un Costaricien (rires). Mon pays a évidemment beaucoup de choses à améliorer, comme n’importe quelle autre nation, mais on ressent clairement le côté amical et pacifique général des habitants.
Le Costa Rica fait partie des destinations touristiques à la mode, mais n’est-ce pas un danger pour les valeurs écologiques que le pays véhicule ?
Le problème principal du pays n’a rien à voir avec le tourisme, c’est le trafic routier. Il est de plus en plus facile d’acheter une voiture, donc, elles se multiplient à une allure folle alors que nous n’avons pas suffisamment de routes, qu’elles ne sont pas en bon état et que nous n’avons ni métro ni train. Dans les embouteillages, il n’y a pas de Pura Vida, surtout que les Costariciens ne sont pas réputés pour leur patience (sourire). Pour préserver notre importante biodiversité, on devrait aussi se tourner vers les voitures électriques, qui ne sont pas encore assez popularisées au Costa Rica. Mais, de manière générale, je pense que le pays doit s’adapter à son développement et s’agrandir dans tous les sens du terme, en construisant un nouvel aéroport, par exemple.
Juste avant les élections présidentielles d’avril 2018, vous avez tweeté un message en faveur de la légalisation du mariage gay. De l’extérieur, il semble que cette question ait constitué le principal axe de débat de la campagne.
Carlos Alvarado, notre président finalement élu, était pour à la différence de son adversaire Francisco Alvarado. Ma volonté avec ce tweet était d’alerter les Costariciens sur l’importance de faire le bon choix. Maintenant, je ne pense pas que ce sujet du mariage gay aurait dû être la clé des élections. C’était évidemment une bonne chose d’en faire prendre conscience aux gens, mais d’autres thèmes tels que le transport, le déficit financier et la sécurité étaient selon moi primordiaux. A cause de cette affaire du mariage gay, tout a été un peu confus et les candidats comme le pays se sont un peu perdus.
Vous avez grandi dans un quartier populaire de San José, la capitale du pays, où la drogue circulait. Comment évite-t-on les problèmes dans ce contexte ?
L’éducation de ma famille nous a sauvés mes frères, mes cousins et moi parce qu’aucun de nous n’a de problème aujourd’hui. On nous a enseigné les bonnes manières, mais je pense qu’on était aussi de bons enfants. Jeune, je ne me rendais peut-être pas compte des dangers de la drogue, mais j’étais obnubilé par le football. Je pense que c’est ça qui m’a aidé à ne pas découvrir la drogue… et à ne pas trop la voir, tout simplement.
De bons amis d’enfance sont tombés dans ce monde et sont devenus des personnes tout à fait différentes. Je vais encore parfois à Napolita pour essayer de les aider. Je sais qu’ils ne vont pas s’attaquer à moi, mais je vois bien que leur état physique et mental est mauvais. Mon aide ne suffit évidemment pas, ces problèmes ne se résolvent pas si facilement.
Votre père a quitté le foyer familial très tôt. Quels souvenirs gardez-vous de lui ?
Aucun, il est parti quand j’avais un an. Ma mère m’a dit que c’était un vrai sportif, un ancien basketteur. Je n’ai jamais vraiment été marqué par son absence parce que j’avais mon grand-père maternel. Il a représenté cette figure paternelle pour moi. Quand j’ai eu 12 ans, mon père nous a téléphoné deux fois à mon frère et moi. Il ne nous a pas expliqué les raisons de son départ. Il vivait aux Etats-Unis et nous appelait parce que sa nouvelle compagne l’y avait obligé.
J’ai appris dernièrement que j’avais deux autres frères et une sœur américains. Quand tu le découvres à 30 ans, ça fait quelque chose. J’ai d’ailleurs rencontré un de mes frères, il a 21 ans. Je lui ai proposé de venir au Costa Rica. On a déjà deux choses en commun : le même père et la méconnaissance totale de ce dernier, qui a aussi fui son foyer américain après sa naissance.
En quoi votre grand-père a-t-il été important dans votre parcours de joueur ?
Lui-même a commencé à jouer au foot à 16 ans à peine, quand il est tombé amoureux du jeu en regardant un match. Il n’a jamais été professionnel, donc, il a reporté ses rêves sur ses petits-fils, dont deux ont réussi (Yendrick, le frère de Bryan, joue à Herediano en D 1 costaricaine). C’est lui qui m’a inculqué une certaine technique en jouant sur des petits terrains de la capitale et en me faisant participer aux tournois régionaux.
L’ascension du Cerro San Miguel (2 035 m, San José culminant à 900 m) faisait aussi partie du programme avec votre grand-père.
On est allé à plusieurs reprises jusqu’à son sommet. Je ne sais plus combien d’heures ça prenait, mais on marchait ! Au-dessus, il y a une croix catholique qui veille sur les quartiers qu’elle surplombe. C’est un symbole important d’Alajuelita pour nous. Je ne sais pas si l’on accomplit quelque chose en atteignant le sommet, mais c’est ce genre de moments privilégiés avec mon grand-père que je voudrais vivre avec mon fils.