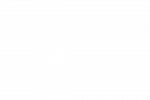De « Dragon Ball » à « One Piece » : « Weekly Shonen Jump » est devenu la machine à hits du manga
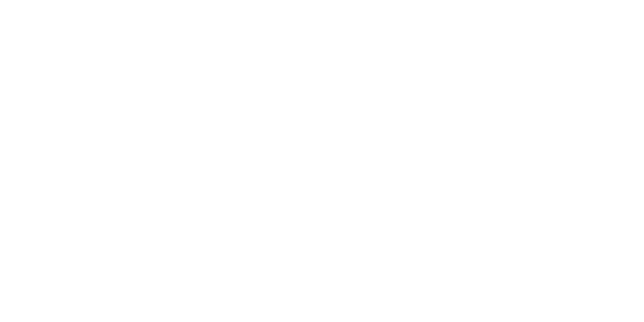
De « Dragon Ball » à « One Piece » : « Weekly Shonen Jump » est devenu la machine à hits du manga
Par Pauline Croquet
Le plus célèbre magazine de mangas fête ses 50 ans au Japon. Avec une méthode bien à lui pour rester au sommet.
Il est le magazine de manga numéro un au Japon. Il a donné naissance aux plus grands succès de la bande dessinée nippone, comme Dragon Ball, One Piece ou encore My Hero Academia. Dans sa période la plus faste, il a été tiré à plus de 6 millions d’exemplaires, attendu chaque lundi religieusement par ses jeunes lecteurs. Cet été, ils ont pu célébrer son cinquantième anniversaire. Son nom est le Weekly Shonen Jump.
Sur l’Archipel, une grande partie des mangas sont d’abord dévoilés sous la forme de feuilletons dans des centaines de magazines de prépublication, avant d’être reliés en un volume, le tankobon.
Le Shonen Jump, souvent abrégé en « Jump », naît une décennie après ses principaux concurrents, en juillet 1968, au cœur d’une bataille que se livrent les grandes maisons d’éditions pour conquérir le lectorat des jeunes garçons (shonen en japonais). Avec pour slogan « la nouvelle voie du manga » et un pirate pour logo, il semble clamer sa liberté et narguer les rivaux.
Dénicher des novices
Même dans la force de l’âge, la parution conserve ses allures de jeunesse. Une couverture aux couleurs criardes à l’effigie de ses héros, des pages imprimées de basse qualité, l’épaisseur d’un gros bottin et un prix modeste (270 yens soit l’équivalent de 2,10 euros) accessible aux écoliers et aux collégiens, son cœur de cible.
A Jimbocho, le quartier des libraires de Tokyo, la petite rédaction du Jump composée aujourd’hui d’une trentaine de personnes continue d’appliquer la recette particulière qui lui réussit depuis des décennies. « C’est l’exemple d’une équipe éditoriale qui connaît son sujet, a un savoir-faire, et s’appuie en plus sur ses lecteurs. C’est une machine de guerre », résume Pierre Valls, directeur de la maison d’édition française Kazé, qui appartient en partie à Shueisha, la maison d’édition-mère du périodique.
La rédaction de « Weekly Shonen Jump » à Tokyo. / ©SHUEISHA Inc.
Tandis que la concurrence incarnée par Shonen magazine (éditions Kodansha) et Shonen Sunday (éditions Shogakukan) a signé les principaux talents de l’époque, Shonen Jump organise des concours pour dénicher des novices et les faire grandir, tout en veillant bien à leur faire signer un contrat d’exclusivité.
Mélange de séries au long cours et d’histoires vite conclues, le magazine s’affranchit aussi des contenus éducatifs que les autres insèrent pour rassurer les parents. Shonen Jump se veut 100 % manga et divertissant, privilégiant ainsi les récits d’action, de sport et de comédie où bagarres et gags grivois sont monnaie courante.
Une ligne éditoriale qui lui réussit dès les premiers numéros avec une comédie très dénudée, Harenchi Gakuen (L’Ecole impudique en français) de Go Nagai, qui s’illustra plus tard avec Goldorak. « Rien de tel pour attraper les élèves des classes primaires à secondaires que cette mise en scène brindezingue de l’infamie, de la débauche, de la barbarie et de l’effronterie en milieu scolaire détraqué », décrit la journaliste Karyn Nishimura-Poupée dans son ouvrage Histoire du manga (édition Tallandier, 2016).
Deux ans après sa création, le magazine passe le million d’exemplaires vendus. En 1971, il se place en tête des magazines shonen et devient la locomotive de l’éminente maison d’édition Shueisha.
Lecteurs et juges
Mais le périodique va réellement innover en plaçant le lecteur-consommateur au cœur de son système. Dans chaque numéro, un bulletin permet au lecteur de renvoyer un classement contre lequel il recevra un petit cadeau de remerciement. Le vote du public décide de la poursuite ou de la mise à mort des séries mais influerait aussi sur l’ordre et le mode d’organisation drastique des séries à l’intérieur du magazine.
« C’est une légende », conteste Hiroyuki Nakano, le rédacteur en chef actuel du Weekly Shonen Jump, avant de nuancer au Monde : « Effectivement, les séries à succès ont tendance à être placées en tête de magazine, mais c’est en fait uniquement pour séparer nettement les séries en fonction de leur genre. Les directeurs assistants de rédaction font très attention, chaque semaine, en créant le magazine, à ce que deux types identiques ne se suivent pas. »
Les sondages entretiennent aussi l’émulation des jeunes mangakas de l’écurie qui ont un trimestre pour faire leurs preuves. « J’étais vraiment intimidé par les autres mangakas, par leur puissance. Je me rappelle avoir pensé qu’il fallait que je leur vole des votes des fans pour pouvoir rester dans le business », confie, dans une interview publiée dans les catalogues de l’exposition anniversaire du magazine, Yoshihiro Togashi qui dessine Hunter x Hunter depuis mars 1998. Les votes peuvent aussi orienter le style d’une série. Akira Toriyama, le père de Dragon Ball, en sait quelque chose :
« A l’origine, je voulais que ce soit un récit de voyage d’aventure pour trouver les boules de cristal. Cependant, mon éditeur n’arrêtait pas de me dire que les résultats des sondages étaient mauvais, donc j’ai dû essayer de mettre les personnages dans un tournoi d’arts martiaux. »
Rien, dans la conception des bandes dessinées du Jump, n’est laissé au hasard. Le processus créateur se cristallise dans la relation étroite que noue chaque mangaka novice avec son éditeur, le tantôsha, aussi garant de la réussite éditoriale que du plan marketing. Les auteurs sont façonnés pour le bon plaisir du lecteur. Les navettes entre la rédaction et les ateliers sont quasi quotidiennes. Des livraisons hebdomadaires obligent les mangakas à tenir un rythme soutenu d’une vingtaine de planches à livrer par semaine. Une charge de travail incomparable avec celle des auteurs occidentaux, et qui prive les dessinateurs de repos parfois pendant plusieurs années.
En véritable machine commerciale, Weekly Shonen Jump joue également « sur la surprise, l’attente, les retournements, les rebondissements pour attraper et fidéliser le lecteur », explique dans son livre Histoire du manga Karyn Nishimura-Poupée.
Incubateur du manga positif
Le magazine s’est orienté très vite sur des récits positifs célébrant une sainte trinité de valeurs : « amitié, effort, victoire ». Par opposition à ses rivaux, Jump se veut grand public et populaire en proposant « des mangas superficiels en apparence mais à même de décomplexer des enfants souvent anxieux pressurés par le milieu scolaire », détaille la journaliste.
Ce style de manga faisant l’apologie du courage, de la persévérance et de l’héroïsme porte un nom : le shonen nekketsu (« zèle, ardeur » en japonais), véritable marque de fabrique du Jump. « On peut presque dire que c’est dans ce magazine que cette forme de manga a été incubée et développée », estime Pierre Valls.
A son lancement en juillet 2014, « My Hero Academia » fait sa première couverture dans le numéro 2273 de « Weekly Shonen Jump ». / ©SHUEISHA Inc.
L’épine dorsale de ces intrigues : le parcours initiatique d’un adolescent avec une faiblesse ou un handicap mais beaucoup de détermination. A l’image du célèbre Naruto, dont le premier épisode paraît dans Jump en 1999 : il met en scène un orphelin qui cherche à devenir le plus grand ninja et le chef de son village, Konoha, pour gagner le respect de tous. Ces valeurs sont toutefois capables d’attirer un public plus large que sa cible, comme les jeunes filles ou les adultes, qu’il n’est pas rare de voir dévorer le magazine dans le métro de Tokyo.
« La Shueisha [la maison d’édition de Shonen Jump] a le savoir-faire pour lancer des blockbusters. Ces séries accrochent les jeunes gens de 8-9 ans et les accompagnent jusqu’au début de l’âge adulte. Ce sont des séries évolutives, avec des prémices bon enfant, naïves et progressant vers du plus sombre, de la romance. La force de cet éditeur japonais est qu’il prend des valeurs simples, universelles », résumait au Monde, en décembre 2017, Ahmed Agne, fondateur de Ki-oon, qui édite My Hero Academia en France.
Les équipes du magazine n’hésitent pas non plus à s’écarter de leur grille habituelle pour prendre certains risques éditoriaux calculés et propulser quelques séries OVNI dans leur sommaire, tel le thriller haletant Death Note, ou plus récemment le surprenant The Promised Neverland.
Tsukasa Hojo, créateur de City Hunter (connu des Français sous le nom de Nicky Larson) et Cat’s Eye, déplore toutefois l’homogénéisation des séries. Il confie dans une interview publiée dans les catalogues de l’exposition anniversaire du magazine :
« L’ancien Jump était un grand magasin où vous pouviez trouver toutes sortes de choses au même endroit. Maintenant, c’est un regroupement d’œuvres du même style. (…) Je pense qu’autrefois le Jump essayait d’attirer toutes sortes de lecteurs ; il s’agissait de voir comment faire grandir le lectorat. Aujourd’hui il est surtout question de se consacrer aux lecteurs que nous avons déjà. »
L’âge d’or des années 1980
Cette ligne éditoriale, qui profite également d’un marché croissant du jeu vidéo et des séries animées télévisées, porte Weekly shonen Jump à son apogée entre 1980 et 1996. Des dates qui coïncident à l’explosion du succès d’Akira Toriyama, arrivé un an plus tôt dans ses pages. Avec d’abord l’extravagante série Dr Slump, qui raconte les aventures d’une mignonne petite androïde, mais aussi, dans la foulée, son œuvre culte, Dragon Ball, le mangaka va tirer les ventes du magazine vers des sommets.
En 1995, le magazine bat le record absolu avec 6,5 millions d’exemplaires face à une vingtaine de magazines shonen ; son tout premier tirage était de 105 000. Attendues aussi chaque semaine par les lecteurs, la série iconique Hokuto no Ken (Ken le survivant) puis, plus tard, celle de basket Slam Dunk, dans laquelle l’artiste Takehiko Inoue raconte les rivalités sportives et amoureuses entre lycéens un brin voyous.
L’âge d’or du Jump prend fin en 1996 avec l’arrêt successif de ces séries phares, mais aussi un contexte économique général plutôt en berne. L’année suivant, le magazine perd 3 millions de lecteurs. Les autres périodiques ne se portent guère mieux. Mais Jump arrive tout de même à limiter la chute des ventes avec le démarrage de One Piece, série qui, à ce jour, a pulvérisé des records de vente dans le monde, dépassant les 400 millions d’albums écoulés. Aujourd’hui, Jump se distribue chaque semaine à 2,8 millions d’exemplaires, ce qui reste très haut par rapport aux autres hebdomadaires de, mangas selon les constatations de Franceinfo.
Le recul des ventes s’explique aussi par les changements d’usages des Japonais, qui désormais passent le temps dans les transports sur leur smartphone au détriment de la lecture. Si le Shonen Jump a mis un peu de temps à épouser ces nouvelles habitudes — elle a ouvert sa rédaction numérique (Shonen Jump +) en 2014 —, elle consacre désormais un tiers de ses effectifs au numérique. Il faut dire qu’au Japon les recettes du manga numérique ne cessent d’augmenter et ont dépassé en 2017 celles des BD imprimées.
En tête d’affiche parmi la vingtaine de séries qu’il propose en 2018, l’indéboulonnable One Piece, My Hero Academia ou encore Black Clover. D’anciennes séries comme Gintama, qui s’apprête à livrer son dernier chapitre, ou Hunter x Hunter, y côtoient les nouveaux venus comme Dr Stone ou The Promised Neverland. Des cinq titres les plus vendus en France en 2017, quatre sont nés dans Weekly Shonen Jump. « Il y a toujours une grande compétition entre les éditeurs français pour emporter les droits des séries phares de Shonen Jump », assure Pierre Valls, de la maison d’édition Kazé. Preuve, s’il en faut, que le pirate continue de braver les flots.