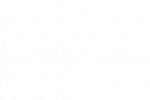Affaire Khashoggi : l’Arabie saoudite joue sa crédibilité, les démocraties aussi

Affaire Khashoggi : l’Arabie saoudite joue sa crédibilité, les démocraties aussi
Editorial. Alors que la crise diplomatique provoquée par le meurtre du journaliste est la plus grave à laquelle soit confrontée Riyad depuis 2001, l’administration Trump fait preuve d’une ambivalence troublante pour ménager son allié saoudien.
Manifestation de soutien au journaliste assassiné Jamal Khashoggi, le 19 octobre, devant la Maison Blanche, à Washington. / JIM WATSON / AFP
Editorial du « Monde ». Trois semaines après sa disparition, les autorités de Riyad n’ont toujours pas fait la lumière sur la mort brutale du journaliste dissident saoudien Jamal Khashoggi, le 2 octobre, dans les locaux du consulat de son pays, à Istanbul.
Après avoir prétendu que le journaliste, âgé de 59 ans, ressortissant saoudien résidant aux Etats-Unis et chroniqueur au Washington Post, avait quitté le consulat par une porte arrière, Riyad a reconnu, au bout de dix-huit jours, que celui-ci était mort, et a avancé l’explication d’une bagarre à coups de poing qui aurait mal tourné. Il a ensuite été question d’un étranglement, toujours accidentel. Le ministre des affaires étrangères saoudien, Adel Al-Joubeir, a fait état, dimanche, sur Fox News, d’une « énorme et grave erreur » commise à l’insu du prince héritier Mohammed Ben Salman, alias « MBS », l’homme fort de Riyad.
M. Al-Joubeir est un familier du petit écran aux Etats-Unis. Après les attentats du 11 septembre 2001, dont quinze des dix-neuf auteurs étaient de nationalité saoudienne, il avait déjà été dépêché par le prince héritier Abdallah, dont il était alors le conseiller, pour tenter de redresser l’image du royaume pétrolier. Cet homme à l’anglais parfait et à la voix suave est décidément l’expert des missions difficiles : la crise diplomatique provoquée par le meurtre de Jamal Khashoggi est la plus grave à laquelle soit confrontée l’Arabie saoudite depuis 2001. Cette crise va bien au-delà de sa relation avec les Etats-Unis.
Pression du Congrès
Le régime saoudien n’est pas le seul à jouer sa crédibilité dans cette affaire ; celle des démocraties est aussi en jeu. L’administration Trump fait preuve d’une ambivalence troublante. Dès le début, le président américain, qui a fait de sa relation privilégiée avec les Saoudiens la pierre angulaire de sa politique au Moyen-Orient pour contrer l’Iran, a tenté de trouver une sortie de crise susceptible d’exonérer « MBS ». L’alliance américano-saoudienne n’est pas nouvelle : elle remonte au pacte scellé en 1945 entre Roosevelt et le roi Ibn Saoud. Mais Donald Trump l’a poussée très loin, en revendique ouvertement les bénéfices économiques et financiers, a fermé les yeux sur le drame du Yémen et sur les méthodes répressives du jeune prince. M. Trump croit toujours aux 110 milliards de dollars (95,3 milliards d’euros) de contrats d’armements que les Saoudiens lui font miroiter.
Le Congrès agitant de plus en plus la menace de sanctions contre Riyad, le président américain s’est montré un peu moins complaisant. Son secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, a renoncé à participer à la grande conférence d’investisseurs de « MBS », prévue le 23 octobre, boycottée par de nombreux Occidentaux. Mais M. Mnuchin se rendra tout de même à Riyad à cette date, afin d’y rencontrer des responsables saoudiens, à deux semaines de l’entrée en vigueur des sanctions américaines les plus lourdes contre l’Iran.
Les Européens, qui ont aussi des intérêts économiques en Arabie saoudite, ont adopté une ligne plus ferme. La France, l’Allemagne et le Royaume-Uni agissent de concert pour réitérer leurs demandes « d’éclaircissements » et ont rejeté les hypothèses avancées par l’Arabie saoudite. La chancelière Angela Merkel a évoqué l’arrêt des ventes d’armes à ce pays. Si les révélations promises par le président turc, Recep Tayyip Erdogan, confirment le scénario de la macabre exécution par un commando envoyé par Riyad, l’ambivalence de Donald Trump ne sera plus tenable. On ne peut pas à la fois prendre des sanctions contre Moscou pour l’empoisonnement d’un agent double et exonérer Riyad de l’assassinat d’un opposant en exil.