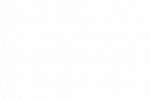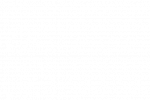Derrière le gigantesque succès de « The Walking Dead », le fragile marché du comics en France

Derrière le gigantesque succès de « The Walking Dead », le fragile marché du comics en France
Par Pauline Croquet
L’offre de comic books en France est plus que jamais foisonnante. Un succès et un emballement à nuancer alors que la quatrième édition de Comic-Con se tient à Paris ce week-end.
Il suffit de se rendre dans les librairies françaises pour constater que les comics, les bandes dessinées d’origine américaine et britannique, ont pris de plus en plus de place sur les étagères ces dernières années. Dans le sillage des historiques Panini, Delcourt puis plus tard Urban comics — le trio de tête —, plusieurs maisons d’édition ont lancé leur label. La grande majorité de ces derniers, qu’ils soient David ou Goliath, vont se côtoyer dans les allées de la Comic-Con Paris, dont la quatrième édition se déroule du vendredi 26 au dimanche 28 octobre, à La Grande halle de la Villette.
Ces derniers sont dans l’ensemble satisfaits de leurs résultats et du dynamisme de leur secteur. « On avait un objectif de rentabilité sur trois ans, on l’a été en huit mois », se félicite François Hercouët, directeur éditorial d’Urban comics, l’éditeur des ultrapopulaires séries « Batman » qui dépend du mastodonte de la BD Dargaud. Chez les indépendants, Bliss a par exemple embauché sa première salariée cette année, soit deux ans et demi après son lancement, et s’offre un stand au Comic-Con de 24 mètres carrés contre six il y a trois ans.
Six cents titres par an
Mais la réalité n’est pas aussi simple. Ce secteur reste le « petit Poucet » de la BD : selon le Syndicat national de l’édition et l’institut de sondage GFK, le chiffre d’affaires global du comics s’élevait, en 2016, à 45 millions d’euros, moins que la moitié de celui généré par le manga. Après avoir connu une explosion des ventes avec une croissance de 275 % entre 2007 et 2017, le marché du comics en France amorce un léger recul.
Avec quelque six cents titres anglo-saxons publiés par an par l’ensemble des éditeurs français, tous s’accordent à dire que le marché est saturé. Mécaniquement, tous les albums n’auront pas la chance de percer ou d’attirer l’attention. « Aujourd’hui, pour une série qui va se vendre relativement bien, on en a dix qui font moins de mille exemplaires vendus », évalue Thierry Mornet, responsable de Delcourt comics.
Si certaines maisons ont décidé de réduire leur programmation, d’autres comme Panini et Urban comics, éditeurs exclusifs en France des majors américaines Marvel et DC, continuent d’inonder le marché. « On a commencé fort, dès notre lancement en 2012, avec une dizaine de titres par mois. C’est une nécessité pour faire exister une marque », estime François Hercouët d’Urban comics. « Nous sommes dépendants de la stratégie et de la volumétrie de publication de Marvel », reconnaît, de son côté, Sébastien Dallain, son homologue chez Panini, à plus forte raison depuis que Marvel a acheté en 1994 l’entreprise italienne, qui s’est rendue célèbre pour ses albums de vignettes à collectionner. Une inflation qui, à terme, peut surtout porter préjudice en bout de chaîne aux librairies, qui n’ont pas une trésorerie illimitée et ne peuvent pas forcément suivre toutes les sorties.
Le carton inattendu de « Rick et Morty »
Car si l’offre s’est étendue, le lectorat n’a pas crû à la même vitesse. Avec actuellement 900 000 acheteurs français de comics, selon le Syndicat national de l’édition — en comparaison des 6,9 millions d’acheteurs de BD franco-belge —, ce marché de niche s’est élargi depuis une petite dizaine d’années.
Date à laquelle les comics se sont vendus en librairies plutôt qu’en kiosques et maisons de presse, son système de distribution originel mais chancelant. L’arrivée massive en librairie s’est aussi accompagnée d’une autre façon d’éditer les comics. Au lieu des fascicules consommables qui se multipliaient au risque de perdre les lecteurs les moins aguerris, les éditeurs ont fait le choix de publier de beaux ouvrages cartonnés, regroupant les séries au complet, avec des chronologies entières ou des compilations d’un même auteur.
C’est ainsi qu’a procédé la petite entreprise Bliss comics qui, depuis 2016, essaie de redonner une visibilité et une cohérence à l’univers de superhéros américains de la maison Valiant (Faith, Bloodshot). « Mon but était de produire des bouquins que j’aurais voulu avoir comme lecteur », explique son fondateur Florent Degletagne.
Ces gros volumes peuvent toutefois coûter une trentaine d’euros, un tarif qui peut dissuader les indécis ou les plus jeunes. Car les comics peinent encore à séduire un très large public, à l’exception de cas très rares comme The Walking Dead. « C’est de très loin le titre numéro un. Aujourd’hui quand on regarde le marché du comics français, on retire son chiffre systématiquement sinon c’est faussé, explique Thierry Mornet, de Delcourt, son éditeur français. On est au-delà du succès, c’est un véritable phénomène avec pas loin de cinq millions d’exemplaires écoulés sur la série de trente tomes. »
L’année 2018 a aussi été marquée par le décollage incroyable de la BD Rick et Morty dérivée de la série animée phénomène. Le tome 1, qui a marqué le lancement en janvier du petit label Hi Comics de la maison d’édition Bragelonne, s’est écoulé à plus de 30 000 exemplaires, et s’est hissé au sommet des ventes françaises, juste derrière The Walking Dead.
« C’est toujours difficile d’expliquer pourquoi une BD marche et pas une autre », estime Basile Béguerie, qui s’occupe de la collection comics Paperback, lancée il y a quelques mois par Casterman. « Dans le comics, le chiffre-clé c’est deux mille exemplaires vendus. C’est le chiffre à partir duquel le titre devient rentable et où il a une raison d’exister », explique Sullivan Rouaud, responsable d’Hi Comics. A trois mille, les éditeurs considèrent que le titre est solide ; à cinq mille ventes, ils commencent à parler de réussite.
Pour toucher le grand public et les lecteurs de BD franco-belge, il est difficile de tout parier sur la sortie d’un film ou d’une série. Les succès de Rick et Morty, de The Walking Dead ou encore Deadpool doivent certes beaucoup à leurs adaptations sur écran, mais cela n’a pas forcément été le cas de Black Panther, malgré son énorme carton au box-office.
« Se tourner vers les lectrices »
Le taux de conversion des spectateurs en lecteurs reste encore faible. Pour Olivier Jalabert, le directeur éditorial de Glénat comics, branche lancée en 2015 en se positionnant sur des œuvres indépendantes, « un des leviers pour sortir du lectorat habituel est de se tourner vers les lectrices ». Une idée qui trotte dans la tête de plusieurs éditeurs d’autant que les catalogues comics comportent des titres avec des héroïnes intéressantes, mais aussi depuis que des études de marché, notamment portées par l’institut de sondage GFK, montrent que ce sont les femmes qui achètent le plus de BD, en général.
Une stratégie qui a aussi poussé les éditeurs à investir autant que possible tous les champs de la BD américaine, bien au-delà des superhéros en slip moulant, et à proposer un foisonnement de genres : roman graphique, tranche de vie, science-fiction, polar, etc.
Parce que les éditeurs sont plus nombreux sur l’échiquier, le prix des licences, notamment d’auteurs indépendants, a flambé « de façon déraisonnable, doublant, voire triplant », assurent tous les acteurs, sans donner de prix. « On peut quelque part parler de boursicotage où des paris sont faits sur des franchises sans être sûrs de leur rentabilité », admet Laurent Lerner, le fondateur de Delirium, petit éditeur indépendant qui s’évertue à republier l’œuvre de Richard Corben, Grand Prix de la ville d’Angoulême 2018. Ce dernier estime ne pas avoir les moyens ou l’envie de rentrer dans ce genre de compétition : « Les ayants droit américains cèdent au plus offrant, c’est ainsi que ça marche. »
Difficile pour les maisons d’édition à un ou deux salariés d’exister depuis qu’elles se voient concurrencées sur les catalogues de titres indépendants ou confidentiels par de grands groupes de BD. « On est en concurrence non seulement les uns avec les autres, mais surtout avec les autres formes de divertissement comme les plates-formes de VOD [vidéo à la demande]. Car pourquoi aller acheter un tome à 15 euros quand, pour 10 euros par mois, tu as un abonnement illimité ? », complète Basile Béguerie, de Casterman. « La leçon qu’il faut retenir, selon Olivier Jalabert de Glénat, c’est que contrairement à ce que pourrait faire croire l’effet Hollywood, nous ne sommes pas dans un Eldorado du comics. »