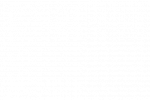Au Cameroun, faute d’aide alimentaire, des réfugiés « s’en sortent » grâce à l’agriculture
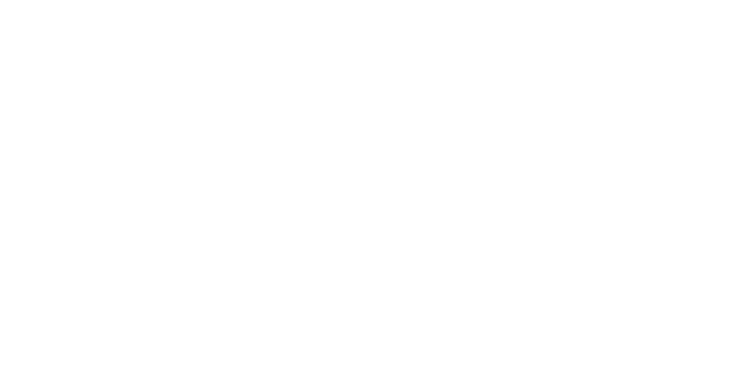
Au Cameroun, faute d’aide alimentaire, des réfugiés « s’en sortent » grâce à l’agriculture
Par Josiane Kouagheu (Borgop, Cameroun, envoyée spéciale)
Les Nations unies n’ont pas les moyens de nourrir les dizaines de milliers de Centrafricains regroupés dans des camps dans l’est du pays.
Des réfugiés centrafricains du camp de Borgop, dans l’est du Cameroun, en novembre 2018. / Josiane Kouagheu
Faucher l’herbe, retourner la terre. A quelques kilomètres de la frontière avec la République centrafricaine, dans la région camerounaise de l’Adamaoua, les houes sont à l’œuvre. Mètre après mètre, les plans de manioc remplacent les carrés d’herbes folles. Là, des hommes et des femmes répètent à l’infini le geste qui demain les nourrira. « Cette année la production sera bonne. On aura de quoi manger », sourit Etienne, en jeans et chemise trouée, les pieds nus dans la terre meuble.
Comme lui, quelque 450 des 12 000 réfugiés centrafricains du camp de Borgop cultivent manioc, maïs, arachides, tomates, carottes, laitues ou oignons, juste pour ne pas mourir de faim. « Sans l’agriculture, je n’aurais pas de quoi nourrir mes quatre enfants et mon épouse. Ces légumes nous permettent de vivre à peu près décemment », poursuit Etienne, désignant de la main gauche les personnes qui l’entourent.
En Centrafrique, il était agriculteur. Lorsque la guerre a éclaté en 2013, il a abandonné ses champs et ses récoltes stockées au grenier pour se mettre en sécurité au Cameroun avec sa famille. Au début, il vivait de l’aide alimentaire fournie par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). « Mais je savais que cela allait prendre fin un jour », susurre-t-il, fataliste. Faute de donateurs, en effet, l’agence onusienne a réduit ses rations alimentaires, les a réservées aux plus vulnérables. Du fait de ce ciblage, des milliers de réfugiés dans les camps ne perçoivent plus rien.
Système D
Selon les calculs de l’ONU, 700 264 personnes auraient besoin d’assistance humanitaire au Cameroun. Parmi elles, 267 813 sont centrafricaines, 101 404 nigérianes. A ces réfugiés des pays voisins s’ajoutent des déplacés de la crise sociopolitique qui secoue les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest : environ 20 % de la population ont déserté ces zones depuis deux ans. Selon Allegra Maria Del Pilar Baiocchi, coordonnatrice des Nations unies dans le pays, les besoins humanitaires du Cameroun, qui fait face à trois crises majeures, sont ceux bénéficiant du « moins de financements au monde ».
Crise anglophone : pourquoi le Cameroun s’enflamme ?
Durée : 05:39
« Tout le pays souffre du manque d’argent, insiste-t-elle, mais la crise dans l’est [où se trouvent les réfugiés centrafricains] fait l’objet d’encore moins de financements que les autres. Cela a amené les agences qui travaillent sur le terrain à réexaminer les vulnérabilités. Aujourd’hui, on ne cherche plus les vulnérables, mais les plus vulnérables des vulnérables. »
Face à la pénurie, les réfugiés ont mis en place un système D sur lequel le HCR et ses partenaires (gouvernement, ONG, autorités traditionnelles) misent aussi. Le petit commerce, la couture, l’agriculture ou encore l’élevage des petits ruminants se développent un peu partout dans les camps.
A Borgop, le gouvernement et les chefs traditionnels ont alloué plus de 60 hectares aux rescapés du conflit centrafricain. « On a donné des champs communautaires à parcelle individuelle. Cela veut dire qu’une parcelle de cinq hectares est divisée entre les bénéficiaires et que chacun cultive son lopin », précise Rostand Abdoul Katawa, le superviseur chargé de la sécurité alimentaire du camp pour l’ONG Lutheran World Federation. Des réfugiés triés sur le volet reçoivent tout le nécessaire pour démarrer leur activité : des sommes d’argent, des houes, des machettes, des boutures et autres semences.
« Louer une petite parcelle »
Beaucoup s’organisent même en groupements, comme Etienne. Depuis trois ans, lui et les dix membres de sa coopérative maraîchère « ne [tiennent] même plus compte de l’aide du HCR ». Ils emploient plusieurs autres réfugiés pour les récoltes et le sarclage. « L’argent gagné nous permet d’acheter les fournitures scolaires, les vêtements et de nourrir nos familles », se réjouit Etienne.
Au-delà des champs communautaires, certains négocient directement avec la population locale pour disposer de terres. C’est le cas d’Adamou. Arrivé au camp de Borgop en 2014 avec ses trois femmes et ses quinze enfants, ce quinquagénaire a vu sa ration « diminuer de mois en mois ». Alors, un jour de 2015, il s’est rendu au village voisin pour « louer une petite parcelle, et on a accepté ».
Au fil des années, Adamou a agrandi ses champs. Il cultive aujourd’hui des salades, des choux, des carottes, du persil, des poireaux, du maïs, du manioc et des arachides sur près de deux hectares. « En six mois, j’obtiens entre dix et quinze sacs de 100 kg. J’en vends une partie et j’en conserve une autre pour notre consommation », détaille-t-il.
Si Etienne, Adamou et les autres parviennent à « s’en sortir » au Cameroun grâce à l’agriculture, le rêve de beaucoup d’entre eux est de retourner dans une République centrafricaine « en paix ». « Là-bas, on était agriculteurs, éleveurs, enseignants, commerçants… On avait nos maisons, tous nos biens », soupire Etienne. En attendant, autour de lui, des hommes et des femmes continuent de sarcler les champs de manioc.