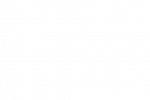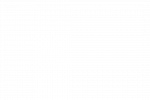« La nuit est à elles » : cinq reines de la nuit parisienne

« La nuit est à elles » : cinq reines de la nuit parisienne
Par Renaud Machart
Des archives audiovisuelles, accompagnées d’un très bon texte de narration, évoquent quelques figures de la vie artistique du Paris de l’entre-deux-guerres.
Quand, valise à la main, elles débarquent à Paris de leur province ou de l’étranger, c’est encore le petit jour. Mais il leur faudra attendre le soir car, rappelle le texte de narration de cet excellent documentaire de Carole Wrona : « Les femmes règnent sur la nuit puisque le jour, en ce début des années vingt, est encore une affaire d’hommes. »
Cinq femmes, parmi tant d’autres artistes – dont certaines sont évoquées marginalement – vont emblématiser le monde de la nuit parisienne, celui des revues, des cabarets et des « boîtes » : Marie Elise Gabrielle Caire, dite Gaby Deslys (1881-1920) ; Jeanne Florentine Bourgeois, dite Mistinguett (1875-1956) ; Suzanne Marion, dite Suzy Solidor (1900-1983) ; Sarah Alice Bloch, dite Marianne Oswald (1901-1985) ; Joséphine Baker (1906-1975), la seule à avoir gardé son nom, du moins celui de son deuxième mari.
La première va servir de modèle ou de référence aux autres : Gaby Deslys, ni vraiment chanteuse, ni vraiment danseuse, ni vraiment jolie, mais dotée d’un abattage à nul autre pareil, va mettre le monde entier – y compris les Etats-Unis et l’Angleterre, où elle se produit beaucoup – à ses pieds.
Elle prône une liberté des femmes, ne veut pas du mariage et se produit avec l’un des premiers jazz-bands qu’on entend à Paris lors de la revue du Casino de Paris « Laisse-les tomber », présentée dans une éruption plumassière. Jean Cocteau écrira de « cet ouragan de rythmes et de tambour » qu’il est « une sorte de catastrophe apprivoisée ».
Un exemple de liberté féministe
Mistinguett attendra la mort de la grande Gaby pour déplumer à son tour des hordes d’autruches, lèvera la gambette et jouera très tard les jeunettes avec la gouaille qu’on connaît.
Joséphine Baker est elle aussi un exemple de liberté féministe qui ne s’en laisse pas conter par les hommes et la morale : « Je savais que j’aurais en France la liberté d’esprit et de corps. » Elle ouvre son cabaret, « Chez Joséphine Baker », où elle fait des apparitions remarquées et attendues le soir après ses spectacles.
Suzy Solidor n’a pas le soprano flûté et mutin de Baker : sa voix est celle d’un baryton. Son physique est proprement androgyne et elle ne cache pas sa préférence – qui n’est pas exclusive – pour les dames, qu’elle fait rougir quand elle leur ronronne sa chanson Ouvre : « Ouvre les plis de tes rideaux, ouvre ton lit que je m’y traîne. »
Marianne Oswald est la moins sophistiquée du groupe : elle a la voix cassée, un physique un peu cabossé, les cheveux rouges, elle chante des textes engagés. Les nazis approchant, Oswald, qui est juive, s’exile aux Etats-Unis tandis que Solidor ouvre son cabaret aux Allemands ; Baker restera aussi mais sera résistante.
D’autres figures sont aussi évoquées, Marie Dubas la gouailleuse, les plus « chics » Lucienne Boyer et Cora Madou. Cette dernière, interprète de l’intime devant un simple piano, dira : « Une chanson, c’est une confidence, on ne gonfle pas la voix pour 3 000 personnes… »
Carole Wrona raconte tout cela au fil d’un texte – méticuleusement documenté – qui accompagne une riche couture d’images d’archives puisées dans les actualités et dans des films de cinéma de l’époque. Avec, pour la bonne bouche, quelques extraits retrouvés d’un film muet perdu pendant un siècle, avec Gaby Deslys, sur un scénario de Marcel L’Herbier, présentés pour la première fois. Le tout forme un ensemble idéalement fluide, instructif et divertissant.
La nuit est à elles, Paris 1919-1939, documentaire de Carole Wrona (France, 2018, 1 h 31 min). www.arte.tv