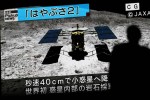« Eric Clapton. Life in 12 Bars » : « God » redescend sur terre

« Eric Clapton. Life in 12 Bars » : « God » redescend sur terre
Par Bruno Lesprit
Le documentaire sans complaisance montre le musicien en baby-boomeur sauvé par le blues.
L’affiche d’Eric Clapton. Life in 12 Bars est trompeuse : un montage associe une fresque murale du musicien britannique, dans la posture du guitar hero avec sa Fender Stratocaster, et le graffiti qui fit naître sa légende dans les rues de Londres, au milieu des années 1960 : « Clapton is God » (« Clapton est Dieu »).
Or, le mérite de ce documentaire, présenté au Festival de Toronto en 2017, est bien d’en finir avec cette divinité. A hauteur d’homme, les images dressent sans complaisance le portrait intime d’un baby-boomeur sauvé par le blues, avant d’être happé par ses addictions (héroïne puis alcool) et, finalement, de les vaincre. Schéma d’un grand classicisme s’agissant d’une rockstar septuagénaire.
En confiance, Clapton a ouvert ses archives à son amie la productrice Lili Fini Zanuck, réalisatrice, en 1991, de Rush, un film sur deux flics devenus toxicomanes en infiltrant le milieu des dealeurs. « Slowhand » (son autre surnom) avait composé la bande originale, comprenant la chanson Tears in Heaven, une de ses plus belles et douloureuses mélodies, écrite en mémoire de son fils, Conor, mort à 4 ans. Cette tragédie, qui aurait dû anéantir Clapton, précéda son triomphe avec l’album Unplugged et ses impeccables versions acoustiques de standards de blues.
Passé de junkie
Dans son autobiographie parue en 2007, Clapton ne se ménageait pas, ne cachant rien de son égoïsme ni de ses lâchetés. Life in 12 Bars le montre parfois « minable », comme on dit pour les alcooliques. On le voit hagard, le regard perdu, renifler de la blanche pendant ses années de réclusion (1970-1973) dans sa propriété du Surrey, on l’entend se faire rudoyer par un spectateur et sa diatribe éthylique contre les « négros et les bamboulas », lors d’un concert à Birmingham, en 1976, n’est pas passée sous silence.
Avec un luxe de détails est relaté comment il a convoité puis séduit Pattie Boyd, femme de son grand ami George Harrison. Heureusement, le film s’attarde aussi sur la conséquence artistique de cette relation triangulaire : Layla, cet hymne rock dévoré par la passion, qui est aussi le titre d’un double album du groupe Derek and the Dominos, formé autour d’Eric Clapton et publié en 1970 – le sommet de la carrière du guitariste.
Pour expliquer ses difficultés relationnelles avec les femmes comme son passé de junkie, le récit, chronologique et articulé autour de témoignages et de documents sur le modèle de The Beatles Anthology, s’autorise deux flash-back un peu grossiers, renvoyant la responsabilité à la mère. Clapton crut longtemps que celle-ci était sa sœur – de seize ans son aînée, elle l’a abandonné pour fonder une famille – alors qu’il était élevé par ses grands-parents. Il n’a jamais rencontré son père, un soldat canadien rentré au pays. C’est dans l’écoute monomaniaque d’autres victimes de rejet que l’adolescent trouvera foi et réconfort. Ils se nomment Muddy Waters, Big Bill Broonzy, Blind Blake ou Little Walter, ils sont bluesmen.
Blanc-bec à coupe afro
L’ascension du prodige est la partie la plus intéressante de Life in 12 Bars, celle qui justifie ce titre se référant à ces 12 mesures, canon du blues. Autocentré et adulé, Clapton est en même temps si peu confiant en lui-même qu’il se fond dans l’identité de groupes sans s’y éterniser, The Yardbirds, les Bluesbreakers de John Mayall, Cream, puis Blind Faith. Le film aurait pu se focaliser sur ces premières années quand le blanc-bec à coupe afro, dans l’improvisation et la distorsion, devient un passeur intégriste et décisif du blues.
Au moins cet amour inconditionnel pour la musique des descendants d’esclaves trouve-t-il bonne place. D’autres moments de son parcours sont curieusement sacrifiés, à commencer par son renoncement à la virtuosité au profit de la simplicité du country rock, après la rencontre, en 1969, de Delaney & Bonnie – dont le nom n’est pas même mentionné.
Une ellipse survole la décennie 1970 (Clapton fit tout de même connaître J.J. Cale, dont il s’inspira largement, comme le reggae, avec sa reprise, en 1974, du I Shot the Sheriff, de Bob Marley), l’intéressé affirmant ne plus rien pouvoir écouter de cette période (« J’entends à quel point j’étais ivre », dit-il). Seule lui importe alors sa victoire contre ses démons, qui devient le sujet principal, quitte à reléguer la musique au second plan.
Bande-annonce Eric Clapton : Life in 12 Bars
Durée : 01:40
Documentaire britannique de Lili Fini Zanuck (2 h 14). Sur le Web : www.facebook.com/orsansdistribution et www.ericclapton.com