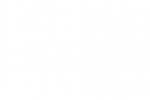Université : « Jouer la gratuité contre un retour au pays plutôt qu’augmenter les inscriptions »

Université : « Jouer la gratuité contre un retour au pays plutôt qu’augmenter les inscriptions »
Par Eric Crubézy et Luc Allemand
Il faut revoir notre coopération avec l’Afrique dans le domaine de l’enseignement supérieur et la recherche, estiment Eric Crubézy et Luc Allemand.
Sur les grilles de l’université de Tolbiac, à Paris, le 5 décembre 2018, des étudiants ont installé un panneau prônant la solidarité avec les étudiants étrangers. / THOMAS SAMSON / AFP
Tribune. L’annonce de l’augmentation des droits d’inscription dans les universités françaises pour les étudiants étrangers, annoncée par le premier ministre Edouard Philippe le 19 novembre 2018, est vécue comme une catastrophe par nombre de jeunes Africains francophones. Elle l’est aussi pour nombre d’universités françaises qui pratiquaient largement, au niveau master et doctorat, parfois sous couvert de coopération, le brain drain (la fuite des cerveaux).
Les conclusions du colloque Young African Scientists in Europe - Jeunes chercheurs africains en Europe, qui s’est tenu à Toulouse en juillet 2018, permettent de dénoncer des anachronismes invoqués pour justifier ces augmentations. Elles permettent aussi de proposer de nouvelles bases pour les relations entre la France et l’Afrique pour l’enseignement supérieur.
Manque de débouchés en Afrique
La France a entretenu pendant longtemps des relations ambiguës avec la formation des étudiants africains. Officiellement, nous cherchions le développement des pays du Sud en y injectant des crédits, mais nous captions en fait une bonne partie de leurs élites intellectuelles qui ne revenaient pas forcément au pays une fois leur doctorat obtenu.
Alors que la coopération devait permettre le développement des pays du Sud, nous formions dans nos universités et dans nos centres de recherche des docteurs, dont les travaux profitaient à nos institutions : les sujets étudiés étaient choisis ici, intégrés aux problématiques définies par nos laboratoires, et publiés pour leur compte. En outre, nombre de ces jeunes docteurs restaient ensuite en Europe, par manque de débouchés chez eux, ou faute d’en connaître de suffisamment attractifs.
Au cours des dernières années, le nombre d’étudiants et leur profil ont largement évolué. Il est loin le temps où seuls des enfants de diplomates fortunés venaient se former chez nous. Ces derniers vont désormais dans les grandes universités anglo-saxonnes dont les diplômes sont jugés plus prestigieux, ou tout simplement dans les grandes universités privées africaines.
La classe moyenne et urbaine francophone qui se développe envoie désormais à son tour ses enfants en France pour recevoir une formation de qualité. Les fourches caudines de Campus France et les difficultés d’obtention des visas sont actuellement autant de barrières contre ce que certains considèrent comme une « immigration cachée ».
Une cible à démarcher
Au moment où la France s’apprête à élever ces barrières, via des droits d’inscription impossibles à régler pour elle, cette classe moyenne qui essaie de se développer devient une cible à démarcher par d’autres universités francophones (québécoises notamment) ou anglophones. Toutes n’ont pas des frais d’inscription exorbitants, et certaines sont prêtes à fournir des bourses, ou à en faciliter l’obtention, afin de maintenir ou d’accroître leurs nombres d’étudiants et de doctorants dans leurs laboratoires. N’oublions pas que l’Afrique est le continent où la croissance démographique est la plus forte : selon l’ONU, un tiers des 15-29 ans de la planète seront africains en 2050.
Si nous ne voulons pas finir de nous détourner totalement de ce continent et de la francophonie, nous devons accueillir les étudiants, tout en les aidant à trouver un avenir dans leurs pays. Ces derniers ont en effet besoin, quel que soit le modèle de développement qu’ils choisissent, de bénéficier du « dividende démographique » de leur jeunesse.
Une première piste est donc de continuer à largement leur ouvrir nos formations, mais de le faire en relation avec les universités de leurs pays d’origine. D’abord, il ne sert à rien d’inciter des jeunes à venir se former « chez nous », s’ils ont chez eux des filières équivalentes. Cela exige un effort de connaissance, d’évaluation et d’harmonisation à l’échelle, sinon du continent, du moins de grandes régions.
Préparer les jeunes chercheurs au retour
Ensuite, nombre de pays africains donnent désormais des bourses à leurs ressortissants pour aller dans des pays voisins se former en licence ou en master, d’où ils postulent alors pour un master ou une thèse en France – parfois avec une bourse de leur pays. Plutôt que de rester spectateur de ces filières, il faudrait mieux les « profiler », de façon équilibrée avec nos partenaires.
Une fois en France, l’étudiant en master ou en thèse doit rester en contact avec les formateurs de son pays. Il y a encore trop, en France, de doctorants étrangers sans inscription dans une université de leur pays d’origine, ni co-encadré par un enseignant-chercheur de celui-ci. Cette situation les défavorise en les coupant pendant de nombreuses années des milieux universitaires et professionnels africains, dans lesquels ils ont vocation à s’insérer à la fin de leur formation.
De ce point de vue, il serait aussi de l’intérêt des universités et des organismes de recherche français (et même européens) de préparer très concrètement ces jeunes chercheurs au retour, en partenariat avec leurs partenaires africains. Au cours de leurs cursus, il faut leur faire connaître les réalités des marchés de l’emploi, les conditions de travail, et renforcer leurs capacités à construire des projets de recherche ou de création d’entreprises en Afrique. La thèse « sandwich », au cours de laquelle des périodes en France (pour bénéficier d’équipements expérimentaux spécifiques, par exemple) s’intercalent avec des périodes dans un pays africain, est aussi à généraliser.
Un investissement mineur
Les grandes entreprises françaises, largement présentes sur le continent, pourraient aussi être incitées à s’engager dans l’organisation de filières de « formation, recrutement » via l’octroi de bourses. Google a récemment recruté un chercheur sénégalais formé en France pour diriger son nouveau centre de recherche au Ghana. IBM cherche dans le monde entier, notamment en Europe, des talents pour ses laboratoires de Nairobi et de Johannesburg. Pourquoi Véolia, Saint-Gobain, Total ou encore Orange, pour ne citer que ces entreprises, ne suivraient-elles pas ces exemples ?
Plutôt que d’augmenter les frais d’inscription, il serait bien plus judicieux pour la France, et pour ses partenaires africains, de mettre en place la gratuité pour ceux qui s’engageraient à revenir dans leur pays d’origine, après quelques années, de faciliter l’obtention de visas d’étude, et de mobiliser des ressources pour créer des bourses. Les étudiants qui prendraient un emploi chez eux seraient de formidables atouts pour l’enseignement supérieur français et la coopération avec l’Afrique. Ce serait un investissement mineur au vu du budget total de la coopération, et un avenir majeur pour l’Afrique et pour nous.
Le colloque Young African Scientists in Europe - Jeunes chercheurs africains en Europe a fourni de nombreuses pistes, voire des solutions, pour revoir avec l’Afrique notre coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur et la recherche. S’engager dans cette voie plutôt que de se couper des classes moyennes africaines émergentes et de ralentir dans ces pays l’ascenseur social, est une fantastique occasion à saisir.
Eric Crubézy est professeur à l’Université Paul-Sabatier de Toulouse.
Luc Allemand est directeur d’Afriscitech.com.