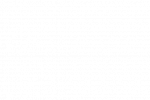« Le mal-être étudiant existe, les dispositifs de prévention sont dérisoires »

« Le mal-être étudiant existe, les dispositifs de prévention sont dérisoires »
Etudiant en master, Réda Mérida témoigne de la détresse psychologique rencontrée par certains étudiants de son entourage. Selon lui, les moyens pour prévenir et soigner ces épisodes ne sont pas suffisants.
Les bureaux d’aide psychologique universitaire peuvent apporter un soutien aux étudiants en difficulté. / Philippe Turpin / Photononstop / Philippe Turpin / Photononstop
Chronique de Réda Mérida, étudiant en master. A la jeunesse étudiante, on accole souvent un imaginaire fantasmatique de bonheur, de construction de soi et d’insouciance. Ce n’est qu’une vision des choses. Une étude de la Smerep publiée en juin 2018 a montré qu’un étudiant sur cinq avait déjà eu des pensées suicidaires au cours de sa vie. En France, le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes de 15 à 24 ans. Cela peut ahurir plus d’un : comment des personnes au printemps de leur vie peuvent arriver à un point de désespoir tel que mettre fin à leurs jours semble être l’unique solution ?
Il m’a suffi d’interroger mon entourage, dont l’âge moyen ne dépasse pas 35 ans, pour me rendre compte que quasiment tout le monde a été touché directement ou indirectement par des épisodes de mal-être psychologique. Pour quelles raisons ? La transition adolescent-adulte rassemble des réalités individuelles si diverses qu’il est difficile de trouver des causes communes. Souvent, c’est à ce moment que l’on s’émancipe du cercle familial, qu’on se confronte à la réalité du monde, qu’on se construit socialement en tant qu’individu… Et qu’on fait des choix décisifs pour sa vie, ou du moins c’est ce que beaucoup d’étudiants pensent.
J’ai rencontré Raphaël, étudiant en master de droit à Aix-en-Provence, autour d’un café. Il a fait une dépression clinique il y a deux ans qui lui a valu des hospitalisations : « J’ai commencé par me sentir vide, triste tout le temps et je ne pouvais plus sortir. » Les symptômes qu’il décrit, quand ils s’étalent dans le temps et commencent à affecter les fonctions biologiques, ne sont pas anodins. « Puis, j’ai arrêté de manger, j’ai perdu une dizaine de kilos, continue-t-il à me raconter. Je me suis évanoui plusieurs fois à la fac. C’est ce qui a mis la puce à l’oreille de mes profs, avant d’être convoqué par l’infirmerie. Mes parents pensent que ce sont des histoires d’enfant gâté, des caprices pour attirer leur attention, donc je ne leur en parle plus. »
A la question s’il allait bien aujourd’hui, il me répond que pas totalement, il rechute dès qu’il arrête les médicaments. Il évoque une enfance difficile et des relations conflictuelles avec ses parents, « puis, j’ai été harcelé durant toute ma scolarité à cause de mon poids ; je n’ai jamais pu m’adapter, j’ai zéro ami ». Il détourne son visage du mien et s’arrête en tentant de retenir ses larmes. « Depuis que j’ai une copine, ça va un peu mieux, je ne me sens plus seul comme avant, poursuit-il. Et puis elle est compréhensive. » Par ailleurs, il est enthousiaste quant à la fin prochaine de ses études longues et fastidieuses de droit, qui, selon lui, l’isolaient encore plus à cause de la charge de travail nécessaire.
Les étudiants en médecine paraissent particulièrement exposés à ces difficultés. En juin 2017, quatre syndicats d’étudiants en médecine publiaient une étude sur l’impact des études sur les futurs professionnels de santé. On apprenait ainsi que, sur 22 000 répondants, 28 % souffraient de dépression, 66 % d’anxiété (contre 26 % dans la population française) et que 23 % d’entre eux avaient déjà nourri des pensées suicidaires. Ces chiffres n’étonnent pas Ninon, étudiante en maïeutique. « J’ai vu des étudiants sages-femmes vriller, raconte-t-elle. Certains faisaient des crises d’angoisse en cours, d’autres prenaient des kilos à cause de la boulimie et d’autres abandonnaient. J’ai surtout vu l’indifférence de l’administration et des professeurs. Comme si, pour eux, tout ça fait partie de la formation. » Younes, un ami étudiant en quatrième année de médecine à l’université Paris-Descartes, se rappelle également de cette atmosphère. Dès l’entrée en première année commune aux études de santé (Paces), « on réorganise toute sa vie autour de la médecine, tout ce qui peut y avoir en dehors ne compte plus », me dit-il. La pression du concours, la compétition entre étudiants et la charge de travail demandée font que « tout le monde est en état second ».
Les carabins ne sont pas les seuls à être concernés. Dalila, fraîchement diplômée en architecture, se rappelle de ses années de cours très chargées, de la remise en question constante quant à son avenir professionnel, du manque de bienveillance des profs. Elle se rappelle de ses soirées avec Vincent, son ami : « On buvait pour oublier. On prenait des drogues aussi. » Vincent s’était réorienté trois fois dans ses études avant d’atterrir en architecture. Une voie qui ne lui correspondait pas non plus. Eloigné de sa famille, il sombra dans une dépression qui lui arracha la vie, il mit fin à ses jours l’année dernière.
Sentiment d’illégitimité
Dans de nombreux cas, il semble que ce mal-être renvoie à un mal-être social. Pour celles et ceux qui viennent d’un milieu modeste, occuper les bancs de certaines écoles s’accompagne d’un sentiment d’illégitimité, à l’image de Sara, originaire de Haute-Savoie, et dont les parents sont employés dans un supermarché. Brillante dans sa scolarité, ses professeurs de lycée l’incitent à tenter les grandes prépas parisiennes. Elle postule « sans même trop savoir à quoi à quoi ça correspondait », m’explique-t-elle. Admise à Louis-le-Grand, à Paris, elle fut impressionnée par le vieil établissement, les dorures, la cour intérieure et les noms à particules qui l’habitent. Mais très vite, elle commence à se sentir étrangère à ce nouveau milieu. « C’était compliqué d’être boursière, il y avait un regard porté sur nous, même dans le comportement des profs, se rappelle-t-elle. Je me suis rendu compte que je n’avais rien en commun avec les autres. » Cette expérience d’étudiante transclasse, Sara la résume à une colère et une déception : « J’avais l’impression d’être une imposture. »
En deuxième année de prépa, elle se retrouve à habiter à une heure de Louis-le-Grand, car le Crous ne pouvait lui proposer une chambre proche de son établissement. Parallèlement à tout ça, elle cumule deux jobs pour subvenir à ses besoins. « C’était hyperdur physiquement mais j’ai tenu. » Quelques mois plus tard, une rupture amoureuse devient l’élément déclencheur d’un burn-out. Toute la pression et le stress des années d’avant lui retombent dessus. Son médecin la met sous traitement durant un an, à cause de « pulsions suicidaires ». N’ayant pas les moyens de se payer un suivi psychologique, elle s’adresse au bureau d’écoute psychologique universitaire (BAPU), qui propose un service gratuit pour les étudiants. Elle ne rencontre un psychiatre que deux mois plus tard, faute de place. Comment peut-on faire attendre autant des étudiants en détresse ? Une employée d’un BAPU de Paris évoque le manque de personnel et la demande croissante.
Le BAPU, Antoine l’a connu aussi. Il y a six ans, ses parents le rejettent alors qu’il n’avait que 18 ans. « Ils avaient des doutes sur mon homosexualité depuis longtemps. Un jour, mon père m’a clairement posé la question. Je n’ai pas répondu, il a compris », se rappelle-t-il. Ils ne m’ont pas mis à la porte mais ont tout fait pour que je quitte la maison, et quand je suis parti, ils ont arrêté les virements bancaires après quelques mois. » Tout l’entourage d’Antoine était catholique : « En un an, j’ai perdu tout mon monde, ma famille et tous mes amis d’avant. Dans ces milieux, tout se sait… » Il enchaîne les jobs étudiants mais peine à vivre : « Je me privais de manger pour payer le loyer, je mangeais un repas par jour, un jour, je dînais et, le suivant, je déjeunais. » Il s’est adressé au BAPU quand il a commencé à avoir des idées sombres. « Je travaillais comme livreur, et dès que je prenais la moto, j’avais une voix dans ma tête qui me disait de braquer le guidon en pleine autoroute pour que tout s’arrête. » Le conseiller du BAPU le dirige également vers une assistante sociale. Aujourd’hui, à 25 ans, la voix qui lui parlait s’est éteinte grâce à la dizaine de professionnels qui l’ont suivi durant trois ans.
La dépression, qui est une affection de la santé mentale courante, n’est ni un coup de blues ni un spleen. C’est une maladie, elle ronge les émotions de l’individu, mais aussi son corps et toutes ses fonctions biologiques. C’est une maladie qui, selon l’OMS, est la première cause de morbidité et d’incapacité dans le monde. Face à sa prégnance chez les étudiants, les dispositifs de prévention et de diagnostic semblent dérisoires. Aucune des personnes ayant témoigné dans cette chronique n’a bénéficié d’une action de prévention au cours de sa scolarité.
(*) Tous les prénoms ont été modifiés.
Reda Mérida, 23 ans, est étudiant en master « Mégadonnées et analyse sociale » du Conservatoire national des arts et métiers. Il suit également le master « Psychanalyse, philosophie et économie politique du sujet » de l’université de Toulouse Le Mirail à distance. Il publie régulièrement des chroniques de la vie étudiante sur « Le Monde » Campus.