Arts : acheter local, directement à l’artiste, le credo du collectionneur africain
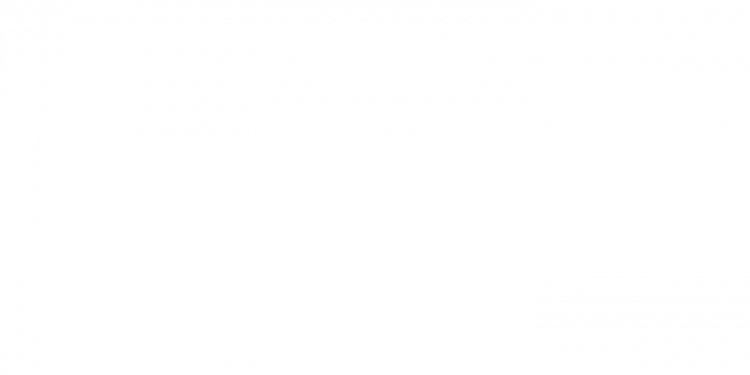
Arts : acheter local, directement à l’artiste, le credo du collectionneur africain
Par Roxana Azimi
Si la production africaine est encore prisée en Europe, un marché continental se dessine, comme le montre la fréquentation de la Foire 1:54 qui se termine à Marrakech.
La Foire 1:54 de Marrakech se tient les 23 et 24 février 2019 à l’hôtel La Mamounia. / Foire 1:54
Cela fait vingt ans que le Sénégalais Oumar Sow achète de l’art contemporain. D’abord des artistes du cru, et depuis peu des peintres marocains. Voilà deux ans, le patron de la Compagnie sahélienne d’entreprises, spécialisée dans les travaux publics, s’est offert une résidence secondaire à Marrakech, où il a accroché une trentaine d’œuvres de sa collection. Alors, « tout naturellement », il s’est rendu le 21 février au vernissage de la Foire 1:54, dont la greffe marocaine se tient à l’hôtel La Mamounia. Oumar Sow l’admet, il s’était juré de ne rien y acheter : il est encore en train de digérer ses dernières emplettes artistiques. Pourtant, il a craqué devant une œuvre de l’Ivoirien Armand Boua sur le stand de la galerie Cécile Fakhoury.
Des collectionneurs comme Oumar Sow n’étaient guère nombreux à l’inauguration de la Foire 1:54, où se sont surtout pressés des acheteurs français et européens. C’est dire si le boom des artistes africains repose encore sur le marché occidental. Le marchand Jean-Philippe Aka, qui a lancé en 2015 le rapport annuel Global Africa Art Market Report, recense à peine 300 à 400 amateurs actifs en Afrique. Une paille à l’échelle d’un continent de 1,2 milliard d’habitants.
Une manière différente de collectionner
« Beaucoup de collectionneurs africains sont simplement moins visibles que leurs collègues européens ou américains parce que leur rôle et leur façon de collectionner sont différents, module toutefois Touria El Glaoui, énergique fondatrice de la Foire 1:54. Leurs relations avec les artistes sont souvent plus directes et, comme la grande majorité collectionne des artistes de leur pays ou de la sous-région, on ne les trouve pas aux grands rassemblements internationaux du monde de l’art comme la foire de Bâle ou la Biennale de Venise. »
La plupart des amateurs achètent effectivement local, directement auprès des artistes. « Collectionner tout l’art africain, ce n’est pas possible, confie Bassam Chaitou, homme d’affaires sénégalais d’origine libanaise. Il y a tellement de courants, ne serait-ce qu’au Sénégal, que je n’ai pas réussi à en faire le tour vingt ans après. » Son compatriote et ami Sylvain Sankalé, qui possède quelque 250 œuvres, s’est lui aussi restreint au périmètre national, « par manque d’espace, de fortune, et par souci de cohérence ».
Les transports coûteux et complexes, ainsi que les taxes à l’importation parfois rébarbatives, douchent aussi les appétits. A cela s’ajoute une méfiance généralisée envers le marché de l’art mondialisé. « On a le sentiment que le marché de l’art africain est opaque et téléguidé par l’Occident qui détermine les prix », avance le collectionneur ivoirien Kablan Porquet, qui préfère se concentrer sur les arts classiques. Et d’ajouter : « C’est comme si on me demandait de parier au PMU sur des chevaux qui courraient à Paris ou à Londres. »
L’Afrique du Sud en première ligne
Ce constat est bien sûr à nuancer selon les pays. L’Afrique du Sud, qui possède un écosystème structuré de galeries et de foires, compte le plus gros contingent d’acheteurs, souvent chevronnés, comme Jochen Zeitz, qui a ouvert un musée au Cap. Mais la collectionnite y reste bien souvent un privilège d’homme blanc. « On ne peut pas faire abstraction de l’histoire. Ce n’est que maintenant qu’on voit émerger une classe moyenne noire en Afrique du Sud et elle s’intéresse de plus en plus à l’art », souligne la collectionneuse Pulane Kingston. Au Nigeria, acheter de l’art est entré dans les mœurs. Mais, remarque l’amateur nigérian Yemisi Shyllon, « notre société est portée par l’argent et les gens achètent principalement pour investir. »
Quant au Maroc, le marché se distingue, selon Jean-Philippe Aka, « par la volonté au plus haut sommet de l’Etat d’établir un soft power avec l’art et la culture, ce qui a un impact sur la grande et moyenne bourgeoisie locale ». Le roi Mohamed VI est réputé amateur d’art, mais un épais mystère entoure sa collection. Si quelques grands patrons ont poussé leurs sociétés à collectionner, à l’instar d’Abdelaziz Tazi de la Société générale Maroc ou de Mohamed Bouzoubaa de la TGCC, toute la société civile ne s’est pas mise à leur diapason.
C’est qu’acheter de l’art contemporain n’a rien d’une évidence. Premier écueil, le faible nombre de musées, centres d’art ou galeries dans la plupart des pays d’Afrique. Comment s’intéresser à des œuvres qu’on ne voit pas ? « L’éducation, c’est le nerf de la guerre, insiste le collectionneur belge Pierre Lombart, à l’initiative du Southern African Foundation for Contemporary Art pour promouvoir les artistes de son pays d’adoption. Si on ne veut pas que l’art reste entre les mains des Occidentaux et qu’on en soit au même point dans vingt ans, il faut le mettre au cœur de la jeunesse. »
« C’est un acte politique »
Yemisi Shyllon l’a bien compris. Cet homme d’affaires de 66 ans, qui possède quelque 7 000 œuvres, finance la construction d’un musée privé qui devrait ouvrir en octobre sur le campus du Pan-Atlantic University, à Lagos, au Nigeria. Son objectif : laisser un héritage et galvaniser les générations futures. Bassam Chaitou, qui a exposé ses œuvres en 2007 au musée de l’Ifan, à Dakar, ne dit pas autre chose lorsqu’il décrète que « collectionner, c’est un acte politique, une manière de refléter l’identité locale, une responsabilité vis-à-vis de l’histoire ».
Cette responsabilité reste néanmoins difficile à mettre en œuvre dans des contextes politico-économiques instables. « Dans nos pays, nous ne sommes pas à l’abri d’une crise, soupire Kablan Porquet. Les gens achètent des bijoux qu’ils peuvent revendre si ça va mal. Mais quand on doit quitter un pays en urgence, comment emporter des tableaux sous les bras ? »
D’autres barrières, plus sociales, sont à surmonter, comme le poids des religions, qui ne voient pas forcément l’art d’un bon œil, et la polygamie. « Quand vous avez plusieurs épouses, une vingtaine d’enfants et plusieurs maisons, ce n’est pas la même chose que lorsque vous avez un chez-vous avec des œuvres que vous mettez en valeur », explique Sylvain Sankalé. Et de préciser : « Les gens ne s’approprient pas les maisons de la même façon. Beaucoup de Sénégalais ne vont jamais dans leurs salons, qu’ils n’ouvrent que pour des hôtes de marque. Toute une façon de vivre qui n’est pas compatible avec la présence d’une collection. »
Emergence d’une « génération d’acheteurs »
Ces freins se doublent souvent d’une culture du secret. « En Côte d’Ivoire, il faut être tout petit, avoir tout le poids du monde sur soi. Il faut émouvoir avant de faire envie », soupire Kablan Porquet. « Il y a encore cinq ans, c’était impensable qu’un privé marocain montre sa collection. C’était comme ouvrir les portes de chez soi à tout le monde », ajoute Othman Lazraq, président du Musée d’art contemporain africain Al Maaden (Macaal) à Marrakech, premier musée privé marocain fondé par son père, le magnat de l’immobilier Alami Lazraq.
Pourquoi tant de mystère quand les Africains les plus riches exhibent volontiers belles cylindrées ou vêtements griffés ? « Il y a au Maroc une terreur d’être épinglé par le fisc puisque le prix des œuvres est connu de tous et que l’art, in fine, est un signe extérieur de richesse », commente Meryem Sebti, rédactrice en chef de la revue d’art marocaine Diptyk. Malgré tout, Cécile Fakhoury, qui a ouvert deux galeries à Abidjan et à Dakar, a vu émerger en cinq ans « une génération d’acheteurs africains qui souhaitent comprendre, apprendre, acheter. C’est en construction ». Lentement, mais sûrement.







