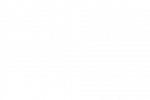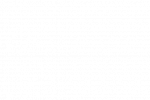L’univers de Jules Verne, une fascinante fabrique à images

L’univers de Jules Verne, une fascinante fabrique à images
Par François Angelier (Collaborateur du "Monde des livres")
Des premières versions illustrées des éditions Hetzel aux adaptations théâtrales et surtout cinématographiques, en passant par les objets usuels, le rayonnement planétaire de l’œuvre de Jules Verne doit autant à son génie littéraire qu’à la poésie visuelle qui en dérive.
Illustration de Léon Benett pour « Les Tribulations d’un Chinois en Chine », de Jules Verne (1879). / FRANK PELLOIS / MUSÉE JULES-VERNE DE NANTES
Cas unique parmi les grands classiques littéraires, l’œuvre de Jules Verne entretient, et cela depuis les tout débuts de sa carrière de romancier, un lien véritablement siamois et fusionnel avec l’univers visuel qui en dérive. Situation qui fait que, au nom de Verne, ce ne sont pas des citations ou des textes qui viennent à l’esprit, mais des images, un intarissable flot d’illustrations, d’affiches flamboyantes, d’objets ludiques et de produits publicitaires, de scènes théâtrales et d’extraits de films.
Cette gémellité images-textes, on la doit d’abord, bien sûr, au fabuleux univers gravé en noir et blanc, rarement en couleur, déployé dans les versions illustrées des 62 romans et 18 nouvelles publiés par Hetzel père et fils entre 1865 et 1910, en pré-original dans Le Magasin d’éducation et de récréation, puis en volumes cartonnés et armoriés, illustrations signées Bennett, Roux, Férat, Riou, de Montaut, de Neuville, etc.
Images dont certaines se substituent au texte dans la mémoire collective telles celles du salon du capitaine Nemo, du calamar géant dans Vingt Mille Lieues sous les mers, du véhicule ailé de Robur-le-Conquérant ou de l’éléphant barrissant sa fumée dans La Maison à vapeur. Des visions qu’aucun film ni bande dessinée n’ont pu supplanter. Témoignera de ce rayonnement l’influence qu’elles auront sur des auteurs aussi différents que Gracq ou Claudel.
Grand spectacle
Autre moment-clé dans la diffusion du monde vernien : le théâtre. Ayant fait de foisonnants débuts d’auteur sur les scènes parisiennes, dramatiques et musicales, dans les années 1840, Verne les retrouve entre 1874 et 1883 pour une série d’adaptations à grand spectacle de quatre de ses romans : Le Tour du monde en quatre-vingts jours (avec son train à vapeur et son éléphant vivant), Les Enfants du capitaine Grant, Michel Strogoff et Kéraban-le-Têtu.
Des mises en scène géantes créées à Paris, et dont la diffusion internationale, de New York à Saint-Péterbourg, assurera la fortune et la célébrité mondiale de Verne, générant également tout un monde d’affiches, de programmes, de photos.
Produits dérivés
Le monde intime, quotidien, des jeux de société et des objets usuels a permis une popularisation sans doute tout aussi grande. Ainsi timbres-poste, vignettes promotionnelles et autres images attrayantes incluses dans les emballages familiarisent-elles le consommateur avec un écrivain dont c’est souvent le visage même qui est mobilisé, un visage dont la physionomie hugolienne renforce l’image de pédagogue serein et de conteur intarissable.
Jeu de l’oie, découpage en couleur, cartes à jouer… ces premiers objets dérivés, voués à la pure consommation, portent une dimension familiale importante, encore renforcée par les cadeaux que constituèrent, une génération après l’autre, modèles réduits ou maquettes, le plus souvent des personnages romanesques les plus mythiques (Phileas Fogg, Passepartout et leur éléphant, entre autres exemples), mais également de l’écrivain lui-même, saisi en plein travail, assis à son bureau.
Vertige du cinéma
Le cinéma constitue le troisième temps majeur du rayonnement planétaire de Verne. Verne à l’écran (et de son vivant), c’est bien sûr Méliès avec quatre films dont les truquages dépassent encore en intensité visionnaire, en illusion, les prouesses du théâtre : Le Voyage dans la Lune (1902, avec sa mythique planète éborgnée), Le Voyage à travers l’impossible (1904, rare pièce de théâtre de Verne où il nous invite à voyager à l’intérieur de son œuvre, en brassant les lieux et les personnages), Vingt Mille Lieues sous les mers (1907) et A la conquête du pôle (1912). Vingt Mille Lieues sous les mers qui connaîtra, dans le futur, deux adaptations importantes : celle de Stuart Paton en 1916 (avec les premières prises de vues sous-marines) et ce bijou réalisé par Richard Fleisher pour Disney avec Kirk Douglas, Peter Lorre et surtout James Mason en Nemo (1954), film marquant notamment pour le traitement du Nautilus, l’assaut que lui donne le calamar géant et la lutte titanesque qui l’oppose à l’équipage.
Le cinéaste tchèque Karel Zeman, bien loin de productions commerciales boursoufflées et anodines, offrira au créateur des « Voyages extraordinaires » ses dernières grandes incarnations poétiques à l’écran, usant comme cadre non un réalisme de studio mais l’univers même des illustrations Hetzel, créant, notamment dans Aventures fantastiques (1958), Le Dirigeable volé (1967) et L’Arche de Monsieur Servadac (1970) une intense poésie visuelle où se mêlent puissance de la lecture et vertige du cinéma. La télévision nous a laissé aussi quelques belles adaptations verniennes, notamment celles des Indes noires (1964) et du Secret de Wilhelm Storitz (1967).
Ainsi va le monde vernien, sur ces deux rails aussi parallèles que permanents que sont le texte et l’image. Une progression conjointe où ils semblent se renvoyer la balle et solliciter simultanément l’attention d’un lecteur qui tangue entre la captivante magie d’un texte écrit et réécrit par l’auteur et son tuteur-éditeur et la fascination pour des images qui surent trouver d’emblée, entre gouffre et lumière, la tonalité précise, celle du savoir et de l’aventure.