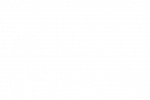« Tel Aviv on Fire » : éloge du bricolage artistique en terre palestinienne

« Tel Aviv on Fire » : éloge du bricolage artistique en terre palestinienne
Par Jacques Mandelbaum
Le réalisateur palestinien d’origine israélienne Sameh Zoabi sort un nouveau film marqué par son habituel mélange d’humour surréaliste et de trivialité.
Les films israéliens se suivent, mais ne se ressemblent pas. Synonymes, de Nadav Lapid, mercredi 27 mars, fugue brutaliste d’un artiste de cinéma issu de l’establishment ashkénaze. Tel Aviv on Fire, de Sameh Zoabi, ce mercredi, comédie douce-amère d’un réalisateur palestinien de nationalité israélienne. Les plus férus de nos lecteurs en matière cinématographique auront d’ores et déjà identifié cet oiseau rare, auteur d’une première comédie, Téléphone arabe, sortie sur les écrans français en 2012.
On repérait alors en Sameh Zoabi un épigone du somptueux Elia Suleiman (Intervention divine, 2002). Même origine (Nazareth et ses environs), même attention au sort très particulier de la communauté « arabe-israélienne », même humour surréaliste taillé dans la trivialité la plus sordide, même quête d’une normalité ontologiquement inatteignable dans l’univers israélien. Après la recherche effrénée de l’âme sœur que mettait en scène ce premier long-métrage, dont il y avait lieu de penser qu’il nous racontait quelque chose de la jeunesse de l’auteur, Zoabi, 44 ans aujourd’hui, poursuit sur sa lancée en chroniquant les vicissitudes d’un aspirant scénariste entré dans l’âge mûr, lequel n’a toujours pas trouvé chaussure à son pied.
Le personnage, subtilement interprété par Kais Nashif, se nomme Salam et semble sous influence directe, en matière de flegme endurant et facétieux, de La Panthère rose. Notre héros, au départ, est une sorte de zéro. Habitant à Jérusalem, il fait quotidiennement le trajet pour Ramallah, capitale administrative de l’Autorité palestinienne, où il sert d’accessoiriste et d’homme à tout faire sur un soap opera produit par son oncle Bassam, Tel Aviv on Fire. Une vedette du cinéma français (Lubna Azabal, jouant du charme qu’on lui connaît) y interprète une espionne palestinienne mandatée par son amant, un cadre du renseignement palestinien, pour dérober par tous les moyens, y compris ceux de la séduction, les plans d’une offensive imminente – on est en 1967 – détenus par un général israélien.
Une question « linguistique »
Partagé entre la reconstitution kitsch du feuilleton (Mata Hari de bazar, général israélien à l’accent arabe à couper au couteau, poster de la mer en toile de fond) et les aléas ineptes qui entourent un tournage complètement fauché, le film est un éloge du bricolage artistique et du romantisme populaire qui rassemble dans une même passion, des deux côtés de la frontière, les femmes palestiniennes et israéliennes. Seul élément mobile entre les deux univers, Salam finit, non sans risques, par tirer les marrons de ce feu.
Son irrésistible ascension commence par une intervention linguistique modeste, mais qui met le feu aux poudres. Plus familier de l’hébreu que tous les membres de l’équipe en place, il fait discrètement remarquer sur le plateau qu’il lui semble improbable que le général israélien présente à son entourage comme une « bombe » l’espionne palestinienne qui l’a séduit sous les atours d’une propriétaire de restaurant français. Remarque particulièrement mal prise par le dialoguiste, puis par la scénariste, au point que, rééditant des interventions de plus en plus attentatoires à la dignité de cette dernière qui finit par claquer la porte, Salam lui piquera miraculeusement la place.
Au prix fort, toutefois. Car notre héros, désireux de vérifier son intuition linguistique auprès de ses concitoyens hébrophones, ne trouve rien de mieux à faire que de demander son avis, quant au bon usage du terme « bombe », à une garde-chiourme du checkpoint qui sépare Israël de la Cisjordanie. Ejecté aussi sec de son véhicule, Salam fait alors connaissance avec l’officier en charge dudit checkpoint, Assi (Yaniv Biton), un individu irascible qui se radoucit lorsqu’il apprend que Salam, qui n’est à ce stade du récit qu’un grouillot, est le « scénariste officiel » de Tel Aviv on Fire, dont la femme d’Assi est justement friande. Ce pieux mensonge destiné à sortir au plus vite d’un checkpoint par lequel il doit hélas passer quotidiennement se referme comme un piège sur Salam. Car Assi, désireux d’impressionner sa femme, qui le méprise pour son manque de « romantisme », se met en tête de s’impliquer à fond dans l’écriture de la série.
Fuite hors de la réalité
C’est ainsi que Salam promu entre-temps scénariste – et qui par ailleurs tente de ramener à lui une ex-petite amie, la belle Mariam, laquelle le tient en piètre estime – devient une sorte de triple agent de sa propre cause, jonglant dangereusement entre les diktats d’Assi (l’espionne doit tomber amoureuse du général), la cinéphilie de son oncle qui voudrait rendre hommage au Faucon maltais, et les objurgations des investisseurs du film qui se montrent assez stricts sur la défense de la cause palestinienne (elle doit se faire exploser). Tout cela – qui s’enlève sur le cauchemar politique que l’on sait – semble d’autant plus délicat.
C’est que face à l’insoutenabilité de l’histoire, Sabeh Zoabi se déplace sur le terrain de la métahistoire. La guerre des Six-Jours – advenue il y a soixante ans – requalifiée à l’aune d’un suspense sentimental. La guerre des récits nationaux transformée en rivalité scénaristique. Sans doute pourrait-on reprocher à Sameh Zoabi cette fuite hors de la réalité. Il nous semble, au contraire, que la justesse de son point de vue consiste à montrer que l’empoisonnement qui touche ce territoire relève précisément de l’antagonisme des imaginaires. Aussi bien pourrait-on le remercier, en appréciant l’immense mérite qui lui revient à la place qui est la sienne, d’y apporter cette touche de réconfort et d’amabilité.
TEL AVIV ON FIRE - Bande annonce
Durée : 01:53
Film israélien de Sameh Zoabi. Avec Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv Biton (1 h 37). Sur le Web : hautetcourt.com/film/fiche/342/tel-aviv-on-fire