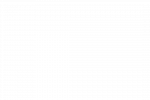A Ségou, on perpétue la tradition du bogolan malien
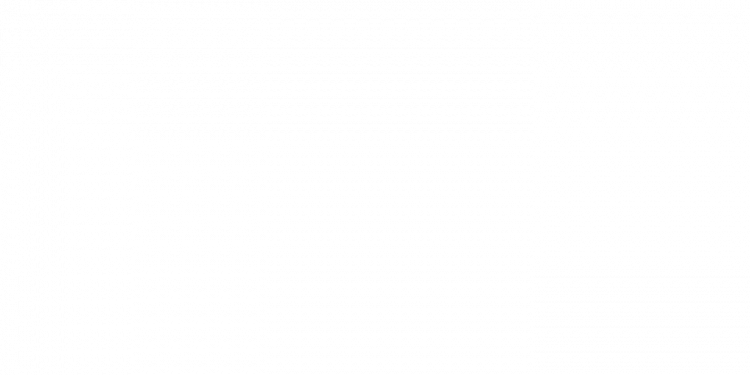
A Ségou, on perpétue la tradition du bogolan malien
Par Morgane Le Cam (Ségou, envoyée spéciale)
Salif Keïta et Beyoncé en ont porté sur scène. Le tissu à motifs géométriques, pilier du patrimoine culturel du Mali, revient au goût du jour grâce au travail de passionnés.
Vendeuse de bogolans à Bani, dans les environs de Djenné, dans le centre du Mali. / OWN WORK/CC 2.0
Assis sous le préau, une dizaine d’hommes appliquent de l’argile sur des tissus. Le silence est d’or, les motifs précis. « Ça, c’est un drapeau breton, version bogolan », sourit l’un d’entre eux, dessinant une hermine.
Au Centre Ndomo, une entreprise école de fabrication de bogolan à Ségou, au centre du Mali, pinceau et pipette sont les seules traces de modernisme dans la confection traditionnelle de ce tissu aux motifs sombres tracés à l’argile du fleuve Niger. « Avant nous, les artisans peignaient avec un bout de fer forgé », explique Boubacar Doumbia, le directeur du centre, que ses élèves (quatre ou cinq jeunes par an) et sa vingtaine de salariés surnomment « le gardien de la tradition ».
Depuis 1990, son école entreprise fait de la résistance face à l’expansion des teintureries chimiques et des fabriques de tissus synthétiques. « Ici, tout est traditionnel, insiste-t-il, en faisant le tour de son atelier. L’objectif est de créer de l’emploi pour les jeunes en leur enseignant les techniques traditionnelles de teinture sur coton. Le Mali est le premier producteur africain de coton, mais nous en transformons seulement 2 %, alors que nous avons des techniques traditionnelles uniques. Il faut valoriser notre potentiel ! »
Art de vivre mandingue
A l’arrière de l’atelier de décoration, un vieil homme peint une écharpe à l’argile en attendant que les tissus jaunes, bleus et rouges placés face à son pupitre sèchent au soleil. Ces couleurs sont le résultat de teintures naturelles, obtenues à partir d’arbres locaux : feuilles de bouleau et d’indigotier, écorces de raisin sauvage. « Le fixateur aussi est naturel, on le trouve directement dans la plante », ajoute M. Doumbia. Au centre Ndomo, tout est naturel et recyclé, du savon aux bois des teintures en passant par l’eau. Tout ce qui ressort est distribué aux maraîchers des environs ou directement réutilisé pour fabriquer de nouveaux bogolans.
Professeur à la pédagogie bien rodée, M. Doumbia est aussi et surtout un chef d’entreprise. Etats-Unis, France, Japon, Espagne, le Centre Ndomo qu’il dirige exporte ses bogolans dans une dizaine de pays. Chaque année, lui et ses salariés achètent environ 15 millions de pièces de tissus qu’ils revendent sur place, dans la boutique du centre ou à l’extérieur, sur commande. La légende veut d’ailleurs que ce soit ici, dans la région de Ségou, que ce tissu soit né il y a plusieurs siècles. Un chasseur malien voulant ramasser la proie qu’il avait tuée dans un bras du fleuve Niger serait rentré chez lui tout taché de boue. « Sa femme a lavé son boubou, mais une tache noire est restée. A partir de là, elle a commencé à dessiner sur les habits en coton de son mari, avec de l’argile », raconte M. Doumbia.
Cette tradition s’est ensuite ancrée et perpétuée grâce aux femmes mandingues qui se sont servies du bogolan comme d’un instrument de communication. Elles inventèrent une quinzaine de symboles, représentant des notions aussi bien abstraites que concrètes comme par exemple la droiture, le carrefour, le soutien… Une fois dessiné à l’argile sur les vêtements de coton de leur mari, ce langage leur permettait de donner de véritables leçons de savoir-vivre à toute leur communauté.
« Ça, c’est le signe le plus important dans notre culture. C’est celui de la famille. Il symbolise tout ce qui est précieux », explique-t-il en crayonnant sur le sol un point entouré d’un cercle. Le directeur ne plaisante pas avec le bogolan. Car, à l’instar des femmes créatrices de ce langage, le bogolan est pour lui bien plus qu’un tissu. C’est un art de vivre, ancestral et typiquement mandingue, empreint de valeurs qu’il s’efforce de diffuser dans son centre de formation.
A l’entrée du lieu, construit par ses soins à partir de matériaux locaux, un imposant masque à cinq cornes accueille les visiteurs. C’est le Ndomo, qui, en langue locale, symbolise l’étape d’initiation des jeunes maliens bambara. Un rite observé à l’âge de 11 ou 12 ans et qui permet aux jeunes d’intégrer le savoir-vivre nécessaire à leur entrée dans l’âge adulte. Chacune des cornes du masque représente une valeur : le travail, le logement, le foyer, l’épargne et le chemin à emprunter dans la vie. « Nous avons transposé cela à l’artisanat. Mes élèves sont placés sous la tutelle de maîtres artisans. Ils ne sont pas seulement chargés de les diriger dans l’apprentissage du bogolan, ils les accompagnent dans la vie en leur inculquant ces cinq piliers. Aujourd’hui ces valeurs se perdent. Beaucoup de jeunes fuient en Europe en pensant qu’ils pourront aller ramasser l’argent par terre. Il faut lutter contre cela », poursuit M. Doumbia. Dans la cour du Centre Ndomo, un musée expose toute l’histoire et les valeurs du bogolan.
Chez lui, le temps de travail est minutieusement calqué sur le mode de production traditionnel des agriculteurs maliens. Comme ces derniers, le matin, les élèves du Ndomo travaillent pour le compte de la collectivité. Comme au champ, leur après-midi est consacrée au travail individuel. Aussi, l’argent tiré des tissus qu’ils confectionnent après quatorze heures leur revient-il. « C’est comme ça qu’on réussit à épargner. C’est comme ça que j’ai pu acheter ma maison », s’enthousiasme Hamidou Barro.
Ce maître artisan est l’un des quatre premiers jeunes que les familles de la région ont commencé à confier à M. Doumbia, dans les années 1990. L’élève est par la suite devenu formateur au centre. Comme les 500 apprentis qu’il a formés ces trente dernières années, M. Barro n’avait pas eu la chance de terminer sa scolarité, faute de moyens. « Le bogolan m’a tout donné. Maintenant j’ai tout ce dont j’ai toujours rêvé : je suis marié, j’habite ma propre maison, j’ai de l’argent et des valeurs », souligne-t-il, en levant son pinceau de sa serviette.
Bogolan africain contre wax hollandais
M. Barro a vu le bogolan revenir à la mode. Il se souvient, ému, d’une de ses premières commandes privée de bogolan, réalisée dans les années 1990 pour l’ancienne ministre de la culture, Aminata Dramane Traoré. Et puis, il y a eu le célèbre couturier malien Chris Seydou. « C’est lui qui a remis le bogolan à la mode, jusqu’à sa mort, en 1994 », raconte M. Barro avant de se lever saluer un client.
La poignée de main est chaleureuse. Thiémoko Dembélé est l’un des plus fidèles et anciens clients du centre. Le directeur général des hôtels Kanaga est venu récupérer des chemins de lit et des rideaux pour l’un de ses complexes basés en Espagne. « Tous les meubles viennent d’une grande entreprise européenne, mais les tissus, ils sont de chez nous ! », s’enorgueillit-il en montrant des photos de son établissement. « C’est important pour moi d’acheter un produit malien. C’est bio et cela me permet de contribuer à l’économie locale, au développement de mon pays. La qualité de ces bogolans, c’est comme du “made in France” », sourit-il en regardant les tissus. Sur les cotons de l’hôtelier, de nouveaux motifs, très graphiques, ont remplacé les anciens symboles mandingues.
Comme M. Dembélé, de plus en plus de commerçants, de stylistes et de personnalités achètent du bogolan traditionnel pour revendiquer un patrimoine africain qu’il faut conserver et aussi moderniser. Sur scène, Beyoncé et Salif Keïta en ont porté. En politique, la nouvelle ministre des affaires étrangères malienne, Kamissa Camara, en raffole. La styliste malienne Mariah Bocoum a confectionné les costumes en bogolan d’un des derniers spectacles de Salif Keïta. Pour cet ancien mannequin, présente sur tous les défilés de feu Chris Seydou, la popularité du bogolan est le signe d’un retour aux sources en Afrique : « Je pense que les gens en ont marre du pagne wax, car ils se sont rendu compte que ce n’était pas un tissu de chez nous. C’est fait pour les Africains, mais c’est hollandais ! Aujourd’hui, les Africains se rebellent un peu. »
Derrière la styliste, les portants de vêtements sont encore vides. Son showroom, implanté à Bamako, est en travaux. Il sera, dans quelques jours, rempli de pièces en bogolan, son tissu favori. Le Centre Ndomo est l’un de ses principaux fournisseurs. « J’essaie d’innover, je change les motifs pour que les jeunes apprécient le bogolan, explique-t-elle. Beaucoup pensent encore que c’est un tissu pour les vieux. » En parallèle, Mariah Bocoum s’est fixé un autre challenge : habiller le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), en bogolan. « Le président est toujours en bazin, regrette-t-elle, le sourire aux lèvres. Mais ça va venir ! »